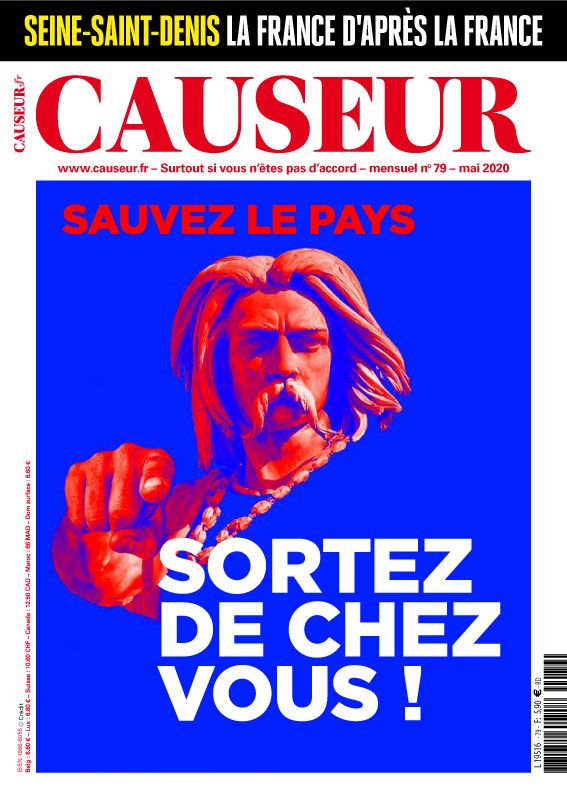Il y a autant de façons d’être juif que de Juifs. D’une synagogue à l’autre, entre bienveillance et observance, les tribulations d’un Juif égaré, nostalgique d’une tradition qui le dépasse.
Quand j’étais petit, on disait le « temple », même mon copain Ari qui s’y rendait beaucoup plus souvent que moi. Aujourd’hui, j’entends dire la « syna ». Je n’y arrive pas, je n’y vais pas assez souvent pour être aussi familier, je dis la « synagogue ». Et il y a peu de chances pour que je me mette à l’appeler par son petit nom parce que j’y vais de moins en moins. On y allait déjà très peu, quand j’étais jeune, on accompagnait ma grand-mère une fois par an pour l’etzger de mon grand-père, l’anniversaire de sa mort, dans une synagogue classique, normale pour des juifs normaux, ni orthodoxes ni libéraux, avec les femmes en haut, les hommes en bas et les enfants qui se courent après dans les allées.
Ségrégation consentie
Adolescent, je me promettais chaque fois d’aller m’asseoir en haut avec les femmes, par solidarité et pour ne pas cautionner cet archaïque apartheid des sexes, mais je me dégonflais à chaque fois, le sens du ridicule m’empêchant toujours à la dernière minute de faire ma Rosa Parks. Ici la ségrégation était largement consentie, et les femmes semblaient préférer l’entre-soi et ses bavardages aux lectures et aux prières masculines.