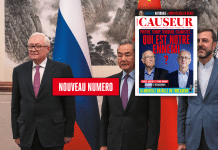« Dans cet état de choses, la nature ne peut atteindre son but qu’en faisant naître chez l’individu une certaine illusion, à la faveur de laquelle il regarde comme un avantage personnel ce qui en réalité n’en est un que pour l’espèce, si bien que c’est pour l’espèce qu’il travaille quand il s’imagine travailler pour lui-même […] Cette illusion, c’est l’instinct »
(Le Monde comme volonté et comme représentation, chap. XLIV, « Métaphysique de l’amour »)
Pour Schopenhauer, la passion amoureuse est une ruse, une ruse de la nature, créée pour mystifier les hommes afin qu’ils servent la cause de l’espèce en croyant servir la leur.
Pour ma part, je nourris depuis longtemps l’idée qu’il existe, de manière analogue, et plus véridiquement, une ruse de la technique ; une ruse qui, alors que l’homme croit travailler à l’amélioration de sa condition, ne cesse de retourner contre lui ses efforts, au profit de nouvelles extensions du système technicien.
Humanisation de la machine / Artificialisation de l’homme
Les craintes liées à un coup d’État cybernétique, ou à une révolte de l’intelligence artificielle, me semblent toujours foncièrement enfantines, dans le goût qu’elles transpirent pour le mélodrame. Il me semble évident, en effet, que l’IA n’aura jamais à prendre ainsi le pouvoir : d’une part, parce qu’une telle théâtralité ne serait guère son registre ; et d’autre part, plus fondamentalement, parce que, le moment venu, nous la placerons nous-mêmes à notre tête.
L’origine de ces peurs, à cet égard, me rappelle le mécanisme à l’œuvre, selon Feuerbach, dans la naissance de l’idée de Dieu : à savoir un processus de transfert – i.e. de dessaisie et d’externalisation –, sur une tierce figure ainsi rendue transcendante, d’attributs ou d’aspirations humaines absolutisées – en l’occurrence, le secret désir de confier à une entité inorganique, parfaitement rationnelle, le soin de nous gouverner.
Ces craintes liées à un 18 brumaire cybernétique me paraissent d’autant plus déplacées que nous appliquons d’ores et déjà le programme que nous redouterions de nous voir imposer. Un programme de réification dont nous pouvons trouver l’un des plus clairs exposés chez Frederick W. Taylor, dans ses Principes du management : « Par le passé, l’homme était premier ; à l’avenir, le système doit l’être ».

Cet ordre de priorité, que nous déclinons déjà quotidiennement, devrait-il en effet nous effrayer, simplement parce son impulsion serait confiée à une autorité plus méthodique ? Après tout, l’homme n’a-t-il pas apporté, avec la Première Guerre mondiale, la preuve éclatante de ses aptitudes cybernétiques, en réduisant, non son ennemi, mais ses administrés, mais sa jeunesse masculine, à l’état de simple matière première de sa machine de guerre, une machine de guerre organisée, suivant les mots de Jünger, sur le modèle du « fonctionnement précis d’une turbine alimentée en sang humain » ?
Dans la marche vers l’intelligence artificielle, nous nous rencontrerons beaucoup plus près de cette dernière que nous ne le croyons. La machine aura certes progressé un peu vers l’intelligence ; mais nous aurons bien davantage progressé vers l’artificialisation.
Renforcement technique / Appauvrissement vital
L’un des traits les plus frappants de notre époque, à cet égard, réside dans la disproportion croissante entre l’extraordinaire puissance technique dont nous disposons et la mesquinerie de nos réalisations, qui redouble généralement leur laideur intrinsèque ; comme si, à mesure que nos moyens se renforçaient, nous ne cessions paradoxalement de nous appauvrir – l’emploi de matières nobles plutôt que leur ersatz, une certaine libéralité dans la distribution de l’espace, des embellissements même mineurs, nous devenant de plus en plus inaccessibles, de moins en moins imaginables, comme le notait Baudoin de Baudinat.
A lire aussi, Olivier Rey: IA: la puissance et la régression
Chaque supplément de tekhnè semble ainsi se payer, non d’une augmentation, mais d’une réduction de nos marges, comme s’il devait être échangé contre un supplément d’âme que nous aurions pu donner à nos ouvrages. Pour le dire avec les catégories de Vaneigem : chaque progrès technique que nous opérons dans le domaine de la survie s’accompagne désormais automatiquement d’une régression analogue dans l’ordre de la vie elle-même.
J’ai pensé, à cet égard, qu’au-delà d’une ruse, il existait une malédiction de la technique. Et que les pays du tiers-monde, Chine en tête, qui s’y sont convertis sans réserve afin de prendre leur revanche sur l’Occident, auraient également à en méditer les fruits amers. Connaîtraient eux aussi l’épuisement vital des sociétés lessivées par sa poursuite.
Le surinvestissement dans la technique carbonise les peuples.
Des naufragés de la condition humaine
Jacques Lacarrière, traitant des anachorètes chrétiens des premiers siècles, avait forgé, pour les désigner, cette belle épithète : des « athlètes de l’exil ». De gré ou de force, nous devenons, nous aussi, chaque jour un peu plus, de tels marathoniens.
Notre exil, toutefois, a bien changé. Nous ne partons plus, comme Antoine ou Pakôme, fuir le monde profane dans les sables d’Égypte ou de Syrie ; et comment le pourrions-nous ? Le nihilisme moderne a étendu partout ses filets, et nous évoluons déjà dans un désert, un désert dont le sable nous est livré à domicile, par des légions d’infatigables coursiers.
Ô, combien Nietzsche avait raison ! « Le désert croît », et ce n’est pas fini. Le sable est dans le cœur des villes, et dans le cœur des hommes, à l’instar d’une marée.
Nous sommes des exilés de l’intérieur. Des expatriés de l’humaine condition.
Extension du domaine de la laideur
Sur le plan esthétique, cet exil prend la forme de ce qu’on pourrait appeler, en référence à Houellebecq, une extension du domaine de la laideur ; ou, pour être plus arendtien, un régime de la banalité du laid – au sens où l’enlaidissement est une manière de porter atteinte à l’âme des choses, et dès lors, de travailler à l’extension du désert.
Cette prospérité de la laideur me semble particulièrement frappante dans la manière dont elle a pénétré les deux principales places fortes qu’on pouvait espérer en préserver : nos campagnes d’une part, avec la périurbanisation et leur envahissement éolien ; et nos plus beaux monuments d’autre part, avec la dégradation de leurs abords et la colonisation croissante de leurs façades par la publicité – comme si rien, décidément, ne devait plus pouvoir échapper au marché.
Pour beaucoup, toutefois, cette banalisation de la laideur n’a rien d’un athlétisme, et tout d’un délassement. Le tort de la beauté, sans doute, c’est d’avoir des devoirs, et d’exiger qu’on lui en rende. La laideur, elle, vient sans servitude. Là où la beauté intimide, là où l’on ne peut jamais être tout à fait à l’aise avec elle, on est toujours, immédiatement, et dans le pire des cas, de plein pied avec la laideur.
Les avant-postes du post-humain
Pour ma part, pour paraphraser Schopenhauer, je nourris depuis longtemps l’idée que l’indifférence d’un être à la laideur (au sens donné précédemment d’une modalité d’avilissement des choses) est en raison inverse de sa sensibilité, et par conséquent peut en donner la mesure approchée.
Aussi rien ne signale-t-il plus, à mes yeux, l’euthanasie d’une âme, la zombification d’un individu, que sa capacité à évoluer sans déplaisir, voire avec agrément, dans l’un de ces déserts urbanisés dont La Défense est l’archétype.
Le propre de ces espaces, en effet, c’est d’être des no man’s land paradoxalement grouillant d’hommes – ou du moins de quelque chose qui en a l’apparence, à la manière des assemblages de manteaux et de chapeaux sur lesquels méditait Descartes – ; des zones, conçues dans une hostilité fondamentale à ce qui nous rend humains, et pourtant dédiées à la stabulation de notre espèce.
Ces déserts urbains, en effet, n’ont pas vocation à ce que nous y déambulions, mais à ce que nous nous y pressions, à la manière de vilaines blattes, sur des macadams interlopes d’une uniforme laideur, évoquant la stérilité absolue des tarmacs d’aéroport, choisis pour leur seule modicité, à l’achat comme à l’entretien, en dehors de toute autre considération.
On y éprouve un sentiment de suffocation vague, né généralement de la pesanteur du béton et du dallage dont on est environné de toute part, sans possibilité de respiration. Dans les lieux extérieurs, comme à La Défense, cette impression d’étouffement est complétée par une sensation d’écrasement liée au gigantisme des constructions, qui permet d’annuler la trouée qu’offrirait autrement le ciel.
Le futur appartient aux zombies
Les tours sont comme les miradors de ces no man’s land. Plus encore que par leur gigantisme, elles me frappent ainsi, à l’instar de Baudrillard, par l’impénétrabilité de leurs façades de verre, plus hermétiques, « plus infranchissables que n’importe quelles murailles de pierre ». Mais le qualificatif exact que j’ai en tête est : autisme. Ces édifices me saisissent avant tout par leur nature fondamentalement anti-sociale, leur caractère clos sur elles-mêmes, la manière dont leur conception ne marque aucune velléité d’intégration quelconque à un paysage ou à un ensemble, mais au contraire une volonté de les dresser là, comme autant de monades se lançant les unes aux autres des ultimatums stériles.

Les tours de bureaux, bien que s’y apparentant par la forme, sont ainsi l’antithèse des monastères des Météores. Leur érection n’est le résultat d’un travail conçu comme une prière, mais la démonstration sévère et aride de la puissance de la technique, une réfutation minérale de toute idée de mystique. Le pouce de César, à cet égard, dans le like autistique que le post-humain semble ainsi s’adresser à lui-même, comme pour se féliciter du nouveau degré atteint en matière de concrétisation des dystopies, est proprement l’emblème de La Défense, et de toutes les autres zones désertées par l’esprit.
A lire aussi: IA fais-moi peur
Dans ces Azkaban à ciel ouvert, les aspirations de l’âme ne rencontrent aucun écho ; au contraire, ces espaces, par leur fonctionnalisme glacé, s’attachent à nous signifier combien ces revendications seraient ici déplacées et hors de propos. Leur sévérité carcérale se veut programmatique : l’orgueil que nous attachons à la qualité d’homme, en même temps que les caprices irrationnels que celle-ci occasionne, sont autant d’archaïsmes intempestifs qu’il s’agit d’abandonner. L’avenir – et l’on sent toute la vérité de cette proclamation – sera à des légions d’automates à visage humain, mangeant leurs graines et dormant dans leurs capsules, auxquels tout sera mesuré, et, par-là, rappelés chaque instant à leur caractère surnuméraire. Demain, oui, l’étouffement de sa sensibilité, l’hébétude de sa vie intérieure, seront des avantages évolutifs. Le futur appartient aux zombies.
Ghosts in their shells
La personnification de cette euthanasie sensorielle, dans l’œuvre de Baudrillard, c’est la figure du jogger américain – qui, comme tout bienfait transatlantique, n’a pas manqué depuis d’essaimer sur nos rivages. « Les milliers d’hommes seuls qui courent chacun pour soi, sans égard aux autres, avec dans leur tête le fluide stéréophonique qui s’écoule dans leur regard, ça, c’est l’univers de Blade Runner, c’est l’univers d’après la catastrophe. N’être même pas sensible à la lumière naturelle de Californie, ni à cet incendie de montagnes poussé par le vent chaud jusqu’à dix milles au large, enveloppant de sa fumée les plates-formes pétrolières off-shore, ne rien voir de tout cela et courir obstinément par une sorte de flagellation lymphatique, jusqu’à l’épuisement sacrificiel, c’est un signe d’outre-tombe. » « Rien n’évoque plus la fin du monde qu’un homme qui court seul droit devant lui sur une plage, enveloppé dans la tonalité de son walkman, muré dans le sacrifice solitaire de son énergie ».
Le jogger de Baudrillard, évidemment, excède la figure du sportif autiste et halluciné. Le zombie, à d’autres moments de son existence lobotomisée, a d’autres occupations et porte d’autres tenues. Les tours de bureaux, typiquement, en abritent la journée de très larges colonies. Mais l’idée centrale est ailleurs. L’important, c’est que l’apocalypse n’est pas un désastre à venir, mais un effondrement déjà là. Un écroulement non pas technologique, mais un écroulement téléologique, un écroulement de toute idée des causes dernières, comme le notait déjà Chesterton. La catastrophe, en l’occurrence, ne survient pas parce que l’activité cesse, elle survient parce que la finalité qui sous-tendait l’activité s’évapore, sans que cette dernière, précisément, n’en vienne à s’interrompre ; parce qu’alors, en effet, c’est l’automate qui prend le dessus. Dans cette perspective, la disparition de la machine ne menace rien ; c’est, au contraire, la totalisation dans la machine qui menace tout.
Je conclus avec Michel Houellebecq :
« Bientôt les êtres humains s’enfuiront hors du monde.
Alors s’établira le dialogue des machines
Et l’informationnel remplira, triomphant,
Le cadavre vidé de la structure divine ;
Puis il fonctionnera jusqu’à la fin des temps. »
PS : Cette dynamique d’escamotage des fins dernières, d’évacuation de toute idée de destination terminale, est singulièrement à l’œuvre dans le domaine politique. Les appellations données à certains mouvements récents, tels qu’En Marche, ou encore Horizons, en particulier, sont symptomatiques de cette évolution ; En Marche, tout spécialement, bien que le mode de locomotion reste encore un peu lent, est proprement l’intitulé d’un parti de joggers baudrillardiens. (Peut-être, d’ailleurs, est-ce la raison pour laquelle une telle sollicitude leur fut manifestée en période de confinement…) Mais je parle de parti, pour être compris, alors qu’en l’occurrence, ce n’est plus à de telles scories que nous avons affaire, mais à des marques, nettoyées de toutes références idéologiques, avec chacune leur produit phare à placer sur le grand marché démocratique des élections. Il serait injuste, toutefois, de dire que ces marques n’ont pas de programme, mais elles ont toutes le même, quoique le packaging change à chaque fois. Ce programme se résume à un mot d’ordre : l’efficacité, c’est-à-dire le cri de ralliement des machines du monde entier.
Price: 22,00 €
18 used & new available from 13,59 €
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !