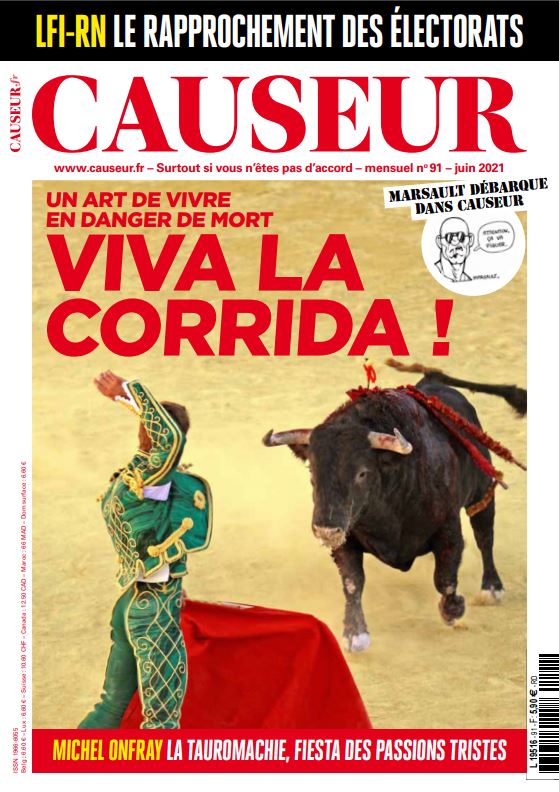Le Sahel n’est pas l’Afghanistan et si la France décide de retirer ses forces de la région, une marée montante de djihadisme irrigué par le trafic de drogue risque d’engloutir l’Afrique de l’Ouest, du Sénégal au Nigeria en passant par la Côte d’Ivoire.
« Il est temps d’organiser le retrait des troupes françaises au Sahel. » (Le Point, 18 avril 2021.) Pour Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël, Emmanuel Macron devrait s’inspirer de la décision de Joe Biden de retirer les forces américaines d’Afghanistan et mettre fin à une guerre qu’il qualifie d’ingagnable. Comme l’esclavage et le racisme, la politique africaine de la France est présentée à travers un prisme américain : une guerre est forcément soit un Vietnam, soit un Afghanistan. Sans surprise, il préconise donc des solutions américaines. La mort du président tchadien Idriss Déby, pilier de la coalition qui, sous direction française, déploie des efforts militaires et politiques au Sahel, a certainement contribué à convaincre le diplomate chevronné que l’opération Barkhane était un échec patent et irrémédiable et qu’il valait mieux arrêter les frais. La réalité est peut-être moins tranchée. Avec des moyens dérisoires, comparés à ceux mobilisés par les États-Unis en Afghanistan (et, il est vrai, des ennemis moins puissants), la France arrive souvent à ralentir considérablement et parfois à endiguer la déstabilisation de l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest par le narco-djihadisme, synthèse locale de l’islamisme et de la narco-criminalité.
À lire aussi: La France au Sahel: quels objectifs pour quelle guerre?
Un immense espace d’échanges
Depuis aussi longtemps qu’on s’en souvienne, les routes du Sahel constituent un immense réseau de flux marchands, transportant du sud au nord et du nord au sud matières premières et produits transformés. Sel, or, dattes montent vers le nord (l’Afrique du Nord et l’Europe), tandis que les produits manufacturés redescendent vers le sud. Un immense territoire aride, loin, très loin d’une organisation administrative quelconque, si ce n’est tribale, ethnique voire religieuse ; la vie y est rythmée par un incessant chassé-croisé de populations, de bétails, de caravanes et de marchands et donc, évidemment, de trafiquants.
Jusqu’à la deuxième moitié du xxe siècle, il n’existait ni Mali ni Niger, pas plus que de Tchad. Il n’y avait pas de frontières à l’exception des dunes et des pistes connues des seuls caravaniers et dont les tracés se transmettaient de façon ancestrale, sous la tente ; ni boussole ni GPS, rien d’autre que la connaissance des oasis, l’observation du ciel et la nature des vents de sable. Et bien sûr les destinations : les