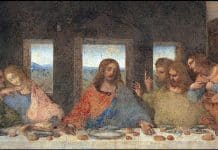Notre patrimoine religieux est aussi innombrable qu’inestimable. Depuis un siècle, la Sauvegarde de l’Art français se bat pour protéger, non pas tant de vieilles pierres que ce qu’elles incarnent. En défendant la place de la spiritualité dans notre paysage, elle promeut aussi la présence de la beauté.
La France est probablement le pays qui compte le plus d’associations. 1,3 million de structures sont régies par la loi du 1er décembre 1901. Parmi elles, une sur cinq déclare avoir un objet culturel et, dans cet ensemble, 35 000 relèvent de l’action en faveur du patrimoine. Si l’action de la Fondation du patrimoine est primordiale, celle de ces associations de terrain – riches de leurs mécènes et surtout de leurs bénévoles – s’avère indispensable pour entretenir un héritage architectural religieux considérable. Dans ce domaine, et depuis un siècle, la Sauvegarde de l’Art français s’est imposée.
À l’origine
Au début du xxe siècle, les nouveaux riches Américains s’entichent d’art gothique. En quête d’histoire et de racines, ils achètent puis démontent – au sens propre – des éléments d’abbayes ou des cloîtres entiers, pour les remonter dans leur jardin, en Californie ou dans le Massachusetts. Le musée des cloîtres, à New York, témoigne de cette razzia. (De nos jours, les milliardaires chinois ont le « bon goût » de copier en béton armé des châteaux de la Loire pour les planter dans leurs vignobles importés du Bordelais.)
À la veille de la Première Guerre mondiale, ce dépeçage lucratif pour les antiquaires et propriétaires peu scrupuleux inquiète les défenseurs du patrimoine. En 1912, les menaces d’exportation en pièces détachées qui pèsent sur le portail du palais épiscopal d’Alan (Haute-Garonne) alertent Édouard Mortier, duc de Trévise. Cet érudit, amateur d’art et collectionneur, souhaite sensibiliser le plus grand nombre à ce « brocantage des monuments ». La Grande Guerre reporte son initiative mais, dès 1920, avec les convoitises que suscitent notamment les vestiges des abbayes de Bonnefont (Haute-Garonne) et de Flaran (Gers), le duc redouble d’efforts pour mobiliser d’abord ses amis, puis des mécènes et des collectivités pour mettre fin à ce pillage. À l’instar de l’abbé Grégoire qui a inventé le mot « vandalisme », le duc de Trévise crée l’« elginisme », néologisme inspiré de lord Elgin qui a dépecé le Parthénon pour vendre ses frises au British Museum. Et c’est au nom de la protection de l’art et du paysage que naît en 1922 son association :