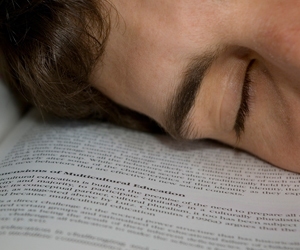J’ai publié en 2002 La Littérature sans estomac pour réagir aux choix d’une certaine critique établie, qui accordait une importance démesurée à des livres à mon sens sans intérêt, alors que la littérature compte beaucoup d’auteurs passionnants que l’on ne mentionne pas assez. Il s’agissait aussi, tout simplement, de regarder de près les textes au lieu de parler d’autre chose, et de prendre plaisir à la pratique d’un genre littéraire assez peu fréquenté : la satire.
Je m’attendais, bien sûr, à de vives réactions. Je me préparais à ce que la critique soit, en toute justice, critiquée. Dans ma naïveté, je ne prévoyais pas qu’il s’agissait, pour certains, de tout autre chose : non pas de lui répondre sur le plan des textes et des idées, mais bien de lui dénier toute légitimité, et de jeter sur elle la suspicion, sur le plan idéologique ou moral. Si les soutiens ont été nombreux, de nombreuses répliques ont visé au-dessous de la ceinture. Surtout, elles ne se sont pas manifestées ouvertement. Pour l’essentiel, elles ont consisté en menaces épistolaires envers mes soutiens, lettres d’insultes (notamment de la part de Monique Atlan, animatrice de télévision), manœuvres pour faire supprimer des articles de moi, ou à mon sujet. Tout cela avec un certain succès. Ces faits ont été détaillés dans Petit Déjeuner chez tyrannie, écrit avec Eric Naulleau, pour bien faire sentir à quel point le petit monde du journalisme littéraire fonctionnait trop souvent sur l’intolérance et le sectarisme. Peine perdue. Depuis, rien n’a changé. Bien au contraire, c’est un déni tranquille qui s’est installé. Ainsi, dans son autobiographie, Josyane Savigneau, l’ancienne responsable du Monde des livres, s’estime victime de la « calomnie ». Ce terme de « calomnie » est repris par presque tous les chroniqueurs (notamment par Nathalie Crom dans Télérama, la critique avisée qui prenait les textes authentiques recueillis dans le Jourde et Naulleau pour des pastiches) comme s’il relevait de l’évidence. Josyane Savigneau n’a pas été évincée de la direction du Monde des livres parce qu’elle piétinait joyeusement toute déontologie, mais parce qu’elle vient de la province et qu’elle est une femme (ce dont on ne s’était pas aperçu, sans doute, avant de lui attribuer son poste). C’est bien évident. Les injures, les menaces, les interdictions diverses, de la part de Josyane Savigneau, dont ont été victimes ceux qui m’ont soutenu, sans même parler de moi, n’ont donc pas existé, rien de tout cela n’est vrai, quand bien même cela serait avéré. On pourrait le hurler continûment, exhiber les lettres, les textes, cela ne servirait à rien.
La liste de ces interdits serait longue, ils ont été très nombreux depuis six ans. Je me contenterai d’en évoquer deux récents : une page portrait devait paraître dans le journal Le Monde, et a été supprimée sur intervention d’une journaliste du supplément littéraire. A la rentrée 2008, Claire Devarrieux, responsable du supplément littéraire de Libération, a déclaré à l’attachée de presse des éditions Balland qu’elle ne publierait jamais d’article sur un auteur qui a critiqué des écrivains défendus par Libération. Bien plus, l’interdiction s’étend aux auteurs publiés dans la même maison que le coupable, Balland et l’Esprit des péninsules. Ils paient pour lui.
Inutile de chercher à dénoncer ce sectarisme. On vous répondra que vous n’êtes quand même pas si malheureux, que si on vous entend, c’est bien la preuve qu’il n’y a pas de censure, que tout cela n’est pas grave, on n’est pas en URSS, et il y a mieux à faire que de se plaindre. Comment répondre à cela ? Bien sûr, on est entendu, bien sûr on est publié, on existe, une forme de reconnaissance finit par advenir. Mais les pressions constantes, les interdits en sous-main, les petites censures répétées, les injures, tout cela doit être considéré comme normal, il ne faut pas les dénoncer. L’existence même d’un tel sectarisme, chez des journalistes qui ont toujours le mot de liberté sous la plume, est considérée la plupart du temps avec indifférence.
En fait, non seulement dénoncer ce genre de pratiques ne sert à rien, mais bien plus, on finit par être soi-même regardé comme douteux. Soit on vous reproche de vous poser en victime, soit, c’est encore plus fréquent, on relève avec dégoût les faits que vous rapportez, en déclarant que cette agitation de marigot ne grandit pas la littérature, et ne concerne qu’un petit milieu assez répugnant. Autrement dit, on peut toujours s’évertuer, le seul résultat en sera que l’on sera mis dans le même sac que ceux à qui l’on s’attaque, et sali par cela même qu’on leur reproche. Soit ce que l’on dit est faux, sans discussion, sans appel, sans même examen du dossier, soit, vrai ou faux, l’on en est de toutes façons déconsidéré : le mieux serait de se taire.
Depuis six ans, grâce, en partie, au soutien moral apporté par de nombreuses manifestations de solidarité, j’ai pu poursuivre, sous diverses formes, ce travail satirique sur la littérature. Mais les effets pervers ont fini par devenir difficiles à endurer. Le plaisir critique, l’audience et la sympathie de quelques esprits ne suffisent plus, en tous cas, à les compenser.
Il est fatigant, d’abord, de se voir systématiquement identifié à la seule polémique. On devient le méchant, le cogneur de service. On vous réclame des éreintements. On vous demande tous les ans de participer à l’éternelle dénonciation de l’éternelle corruption des prix littéraires. On commente tous vos livres, même des romans exempts de polémique, en fonction de ce seul aspect. Bref, on est folklorisé. On peut avoir publié, aux environs de la cinquantaine, trois livres consacrés à la satire sur un total de trente, consacrer les neuf dixièmes de son temps à des romans ou à des essais littéraires, rien n’y fait. Le violon d’Ingres critique masque tout le reste.
On peut avoir écrit maints articles d’éloge, avoir consacré beaucoup d’énergie à une petite revue qui publiait de jeunes auteurs, des poètes d’avant-garde ou des artistes, pour certains, on sera, jusqu’à la consommation des siècles, celui qui n’aime pas la littérature de son époque. On peut donner toutes les preuves du contraire, rien n’y fera. Il y a surtout une profonde lassitude à se voir opposé à l’infini les mêmes arguments, quand bien même on s’est échiné à y répondre. Ces arguments sont reproduits inlassablement, par des universitaires, des journalistes, des écrivains, des « bloggeurs » ou des lecteurs. Tentons d’en donner rapidement la teneur.
La plus fine psychologie s’y allie à une sociologie de haut niveau : le critique est aigri, envieux, plein de ressentiment (Philippe Lançon dans Libération), il se venge de sa médiocrité. C’est l’argument le plus fréquent, le cliché obligatoire, il est ressassé à l’envi, c’en devenu un automatisme. Variantes : il veut se faire connaître, sur le dos des autres. Il ne fait jamais que chercher des places, il agit par « dépit de ne pas avoir un strapontin » parmi les Beigbeder et Rolin (Sébastien Lapaque dans Le Figaro). Eternelles beautés de la psychologie… Dernièrement, Pierre Bergé, dans l’émission de François Busnel, a agressé Eric Naulleau, à propos du Jourde et Naulleau, sur l’air : vous attaquez les autres pour vous faire connaître. Pierre Bergé censeur (il a fait interdire dans son magazine Têtu la publication d’un entretien gênant pour Mme Savigneau, à la demande de celle-ci), Pierre Bergé mafieux (il décerne un prix Décembre alors que Sollers, éditeur du lauréat, figure dans le jury) considère que la critique est répugnante : c’est dans l’ordre des choses. Dans l’ordre des choses aussi, aussitôt après cette sortie, l’éloge de Pierre Bergé dans Le Monde sous la plume de la prévisible Savigneau. Pour ces gens-là, ce ne sont pas les textes qui comptent, ce sont les relations sociales et le pouvoir. L’amour universel de la littérature est un alibi commode.
Donc, le critique « crache dans la soupe » (ce qui connote une certaine ingratitude, quand bien même on ignore de quelle soupe au juste il s’agit). Il éprouve de la haine pour tel ou tel auteur, il poursuit d’obscures vengeances. Les universitaires le désapprouvent : polémiquer ne sert pas la littérature. Même l’excellent ouvrage La Littérature française au présent vous expédie le pamphlétaire en deux lignes : son livre n’a été écrit que pour « régler des comptes ». Quels comptes ? Quel arriéré ? On ne sait pas. Même si la personne du critique est jugée sympathique, il semble louche qu’il se livre à une telle activité, cela dénote un côté Jekyll et Hyde dont il faudrait se méfier, du moins si l’on en croit Didier Jacob.
Géographiquement, c’est un provincial qui dénonce la corruption parisienne, ou c’est un puritain qui se prétend incorruptible et joue les chevaliers blancs, ou bien au contraire un arriviste prêt à tout pour qu’on le voie à la télé. Il est tout aussi pourri que les autres. C’est, comme le dit bien Etienne de Montety, du Figaro, un « faux rebelle ». D’ailleurs, précisent d’autres, il fait ça pour de l’argent, la motivation de ses livres est commerciale (oui, cela aussi a été écrit). Si on le voit à la télévision, si on l’entend, si on le lit, cela montre bien qu’il est corrompu, « vendu au système », et que son seul but était de faire parler de lui. Si on ne le voit pas, eh bien il n’existe pas, et c’est au fond ce qu’il a de mieux à faire. D’un côté, certains journaux s’emploient à lui refuser la parole, autant que possible, de l’autre, de braves lecteurs sourcilleux sur l’éthique s’offusquent qu’il paraisse ici ou là, ce qui leur semble une marque de compromission.
Politiquement, il est bien entendu réactionnaire. Variantes : lepéniste, poujadiste, populiste, abondamment attestées, voire pétainiste, dans Le Monde, à propos de Pays perdu, car « la terre ne ment pas » ; ou encore, si l’on en croit Edwy Plenel, « ennemi de la liberté ». Car il est réactionnaire, semble-t-il, de préférer Novarina, Chevillard ou Cadiot à Darrieussecq et Delerm. Cette idée du caractère réactionnaire de la critique est, elle aussi, universellement répandue. (Jean-Philippe Domecq, en son temps, a déjà été assimilé aux nazis) Elle vient d’être récemment reprise par Michel Abescat, dans Télérama, à propos du Jourde et Naulleau. Ce poujadisme littéraire qu’on lui impute n’empêche nullement, d’autre part, de considérer qu’en manifestant son peu de goût pour des auteurs largement reconnus, le critique prouve son mépris du public.
Tantôt il choisit la facilité en attaquant des auteurs inconnus (ou en défendant des auteurs célèbres), tantôt il fait preuve d’élitisme en attaquant des gens connus (ou en défendant des inconnus). Les deux idées ont été souvent exprimées, parfois simultanément. S’il s’en prend à des célébrités, des auteurs de best-sellers, c’est là aussi trop facile, car alors il « enfonce des portes ouvertes », et de toutes façons cela ne sert à rien, les lecteurs de ces écrivains ne le liront pas. Pour certains, il faudrait ne s’attaquer qu’aux grands auteurs. Pour d’autres, aux petits. S’il attaque des femmes, il est sexiste. De toutes façons, il ne critique jamais le bon écrivain (c’est toujours celui qu’il ne commente pas qui aurait été le bon), ni le bon livre, ni le bon passage, puisque, bien entendu, il ne commente que des « citations détachées de leur contexte », quand bien même la citation en question ferait deux pages. D’ailleurs, il est trop simple de se pencher sur le détail du texte, à ce compte-là, on ferait passer les plus grands génies pour des imbéciles.
D’une manière générale, la satire est indigne d’un véritable écrivain, qui reste au-dessus de ces vils combats pour ne se consacrer qu’à son œuvre. Elle est, idée martelée, une « perte de temps ». Non seulement parce qu’elle ne sert à rien et ne change rien, mais parce qu’il y a tant de bons auteurs et si peu de temps qu’il est vain de dénoncer les mauvais : ne parlons que de ce qui est bon (entendu mille fois).
Si l’on consent à admettre la légitimité d’un ouvrage critique, celle-ci est refusée pour le deuxième. Là, le critique se répète. Il fait toujours la même chose, il « exploite le filon ». Encore une fois, il ferait mieux de changer d’activité.
Ce n’est pas la violence, la malhonnêteté ou la bassesse de certaines attaques qui ébranlent vraiment, mais la puissance d’inertie qui semble prédominer, jusque chez des gens de bonne foi, convaincus que, dans le champ littéraire, toute polémique est soit inutile, soit un peu sale. On peut avoir développé une argumentation nourrie pour répondre, montré qu’on n’a rien de « réactionnaire » et qu’on est un grand amateur de littérature contemporaine, peine perdue, tout cela reviendra en boucle. Le martèlement l’emportera sur le raisonnement. Alors, même si on ne se sent pas spécialement victime, la fatigue finit par l’emporter. On n’a plus envie d’argumenter, et l’on se dit qu’en effet, ils ont raison, tout cela est inutile, autant s’arrêter. Il y a quelques pages polémiques dans mon dernier ouvrage, Littérature monstre, et je les regrette presque. Je me prépare à entendre l’antienne : exploiter le filon, cracher dans la soupe, réactionnaire, régler des comptes, aigreur, parler des bons livres, enfoncer des portes ouvertes, etc. Je ne parviens plus à trouver la force de répondre. C’est un piège : on n’en finit pas, toute l’énergie passe à se justifier sans fin d’exercer une activité au fond normale. Mais je l’ai toujours considérée comme annexe. Alors, à quoi bon ? J’avoue que j’y regarderai, désormais, avant de me lancer dans la satire ou la critique négative. En fait, il est fort probable que je suspende sine die la pratique ces sports. D’aucuns, bien entendu, ne manqueront pas d’interpréter cela comme une tactique de qui cherche des places ou s’intègre au système. On finit par éprouver le sentiment de ne rien pouvoir faire contre de tels automatismes mentaux, contre ce bétonnage de la pensée, cette manière d’aller toujours au plus bas, comme s’il y avait une évidente universalité de ces sortes de sentiments.
Certains continuent, ici et là, à pratiquer un genre devenu marginal dans le monde de la promotion et de la prudence. D’autres auront peut-être l’audace de s’y lancer. Je leur souhaite bon courage.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !