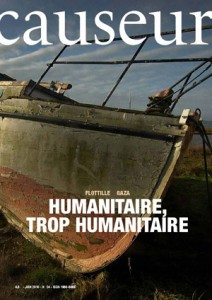Commençons par le dernier rebondissement dans le feuilleton de la crise : la baisse de la note de la dette espagnole. La détresse du marché espagnol du crédit foncier rappelle à notre bon souvenir la dette privée, question occultée depuis un moment par celle des dettes souveraines. Est-ce que cela repart comme en septembre 2008 ?
Vous insistez sur un fait central occulté par les économistes médiatisés et les journalistes. La crise des dettes publiques européennes se situe dans le sillage d’une crise historique des dettes privées qui a son épicentre aux États-Unis, pays de 300 millions d’habitants et première économie mondiale. Cette crise des dettes privées, symbolisée par l’effondrement du « subprime rate », trahit le surendettement des ménages dans différents pays occidentaux : États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, mais aussi Australie, Irlande, Portugal, Hongrie, Estonie. Elle est la cause directe de ce que nos amis Américains nomment aujourd’hui la « Grande récession » pour marquer la singularité de la crise actuelle dans l’ensemble des récessions de l’après-guerre. Or, la Grande récession a dévasté les comptes des États, y compris de ceux dont la situation apparaissait bonne, voire excellente. Et cela, de trois façons : en réduisant mécaniquement les recettes fiscales ; en transférant vers certains Trésors publics les pertes des banques nationalisées ou secourues par ces Trésors ; en incitant certains gouvernements à des mesures palliatives de soutien de l’activité, prises dans le souci de ne pas voir la récession tourner à la dépression.
Mais l’Espagne représente une illustration parfaite de cette liaison dangereuse entre la dette privée et la dette publique. Les ménages espagnols sont tout aussi endettés que leurs homologues américains. L’effondrement de l’économie locale, qui a supprimé plus de deux millions d’emplois, les rend largement insolvables, cependant que l’effondrement des recettes détruit le crédit de l’État espagnol. Point remarquable : il y a trois ans encore, cet État était encore excédentaire et affichait un niveau de dette largement inférieur à celui de la zone euro. Mieux encore, il a bénéficié un instant de conditions d’emprunt meilleures que l’État allemand. En 2006, le « benchmark » européen, c’était l’Espagne !
[access capability= »lire_inedits »]
Quelles répercussions possibles pourrait avoir ce problème sur les autres pays européens, et particulièrement sur les banques françaises et allemandes ? Risquons-nous, par le jeu de la titrisation des dettes espagnoles, une crise des subprimes européenne ?
Oui, les prêteurs sur le marché espagnol ont largement recouru à la titrisation. Ainsi, le risque de défaut de paiement de nombreux débiteurs a été transféré vers d’autres prêteurs, essentiellement en Europe. À ce jour, les chiffres disponibles indiquent que les banques françaises détiennent 194 milliards de dettes privées et publiques espagnoles (soit 10 % de notre PIB) et les banques allemandes 240 milliards (près de 10 % du PIB allemand). Les banques européennes, dont on a vu qu’elles s’étaient dangereusement aventurées sur un marché de la dette américaine qu’elles ne connaissaient pas, sont aussi surexposées sur les marchés de la dette publique et privée des pays les plus fragiles de la zone euro. Nous avons là, en germe, un nouveau risque systémique.
Dans ce contexte, est-ce le moment d’adopter des mesures d’austérité comme celles qui ont été infligées à la Grèce et adoptées par l’Espagne et le Portugal (et peut-être bientôt par la France) ?
Les plans d’austérité trahissent la conjonction de trois facteurs. Premier facteur : tenter de rassurer les opérateurs des marchés qui sont appelés à souscrire les emprunts émis par les Trésors publics concernés (faute de souscripteurs, la faillite des États serait effective). Deuxième facteur : le fait que de nombreuses banques européennes soient « collées » par leurs détentions d’emprunts publics (qu’elles ont d’ailleurs achetés avec l’argent gratuit que leur prêtait la BCE…) conduit lesdites banques à exercer une pression collective pour que « l’assainissement » des comptes grecs, portugais, irlandais, espagnols, voire français ou italiens, « garantisse » la valeur des titres qu’elles détiennent et continuent d’ailleurs de les comptabiliser comme s’ils étaient totalement sûrs). Troisième facteur : la volonté allemande de soumettre, par l’intermédiaire de la Banque centrale de Francfort, l’ensemble de la zone euro à une discipline budgétaire qui n’est jamais parvenue à se mettre en place à partir de la Commission de Bruxelles.
La réduction des déficits semble s’imposer comme un nouveau dogme, mais ne s’agit-il pas, de nouveau, de priver l’État, dans un moment crucial, d’un outil de politique économique de premier ordre ?
Je pense d’abord que les apôtres de la réduction des déficits agissent comme des marionnettes de leur idéologie collective. La dette publique est malsaine, elle est dangereuse : c’est un axiome dans leur esprit. Qu’importe que les déficits se soient creusés sous l’effet de la récession ou de la volonté de secourir les banques en difficulté ou en faillite, qu’importe que certaines restrictions de dépenses aient pour effet mécanique de réduire la consommation, mais aussi les recettes fiscales : il faut tailler dans les dépenses.
Je suis sûr par ailleurs que la récession et ses malheurs constituent, aux yeux de nos ayatollahs, une occasion historique de solder les États-providence. Denis Kessler l’a dit à sa façon brutale, mais franche : « Il faut démanteler le programme du Conseil national de la résistance » dont est issu notre grand système de protection sociale. Alain Madelin s’est réjoui publiquement de la disparition de l’État-providence grec, en attendant bien sûr, celle des autres pays européens. Une question s’impose dès lors : comment se fait-il que la crise ait pris son essor à partir du pays, les États-Unis, qui semblait au contraire avantagé par l’absence d’une protection sociale coûteuse ?
On nous dit à propos de la crise actuelle − et DSK le répète à qui veut l’entendre − que sans l’euro, cela aurait été encore pire. Qu’en pensez-vous ?
Le propos de Dominique Strauss-Kahn évoque irrésistiblement l’argument des derniers défenseurs du système soviétique entré en agonie à partir des années 1970 : « La crise que nous subissons provient de la crise du capitalisme ; sans notre organisation socialiste, elle serait bien pire. » Nous pouvons sans difficulté infirmer ce propos.
Premièrement, avec ou sans l’euro, nous avons été les victimes et nous aurions été les victimes de cette crise de la dette privée qui est au fondement de nos malheurs économiques et sociaux : la liberté d’acheter sur le marché − avec l’euro ou une quelconque autre monnaie − des créances toxiques a permis la transmission des risques bien au-delà du marché d’origine.
Deuxièmement, l’euro a joué un double rôle négatif qui apparaît aujourd’hui dans toute sa gravité. Les pays les moins compétitifs à l’échelon international ont été protégés par leur appartenance à la zone euro : ils n’ont plus ressenti le besoin de réajuster leur compétitivité, puisqu’ils étaient protégés de la cessation de paiements extérieurs par leur rattachement à la monnaie du pays le plus excédentaire au monde, l’Allemagne. Les États proprement dits, même quand ils ne pouvaient pas s’appuyer sur des économies fortes, ont pu financer leurs déficits à des conditions très favorables, celles de l’Allemagne ou des Pays-Bas, à très peu près : cette situation, qui a prévalu jusqu’en janvier 2009, a leurré les gouvernements les plus directement concernés. Au total, l’euro a joué un double rôle pernicieux d’inhibiteur des déséquilibres externes et internes.
Quel bilan pour la France, dix-huit ans après Maastricht et huit ans après l’entrée en circulation des euros fiduciaires ?
Le bilan français s’avère d’autant plus difficile à établir que nous ignorons l’épilogue de l’aventure ! La France dispose de nombreux atouts économiques du fait de la diversification encore importante de son appareil de production : nous ne sommes pas appuyés sur un secteur immobilier ou des services financiers pléthoriques. Néanmoins, nous devons constater l’érosion progressive de notre base industrielle, qui s’est traduite par un basculement de notre commerce extérieur vers le déficit à partir du début 2004. Cette évolution négative procède de la concurrence de l’Asie émergente mais aussi de la surévaluation de l’euro, sensible à partir du milieu de la décennie. Il suffit de voir que les prévisions des entreprises françaises se sont améliorées dès que l’euro est tombé au-dessous de 1,3 dollar (c’est le seuil de rentabilité d’Airbus sur le marché international).
Au raisonnement que nous faisons, les économistes de la vulgate opposent le fait que la part des exportations françaises au sein de la zone euro a fortement décliné ces dernières années. Mais cette chute est l’effet mécanique de la montée relative des exportations allemandes dopées par la réduction drastique des coûts du travail outre-Rhin ; durant le dernier mandat Schröder, les partenaires sociaux ont réalisé « les trente-cinq heures à l’envers ». Les salariés allemands travaillent plus sans gagner plus ou en gagnant moins. Or, la dévaluation interne du travail est un substitut de la dévaluation externe de la monnaie.
La monnaie unique a-t-elle été une vraie rupture ? Avec le fameux « Serpent monétaire » (le dispositif des années 1970 qui limitait les fluctuations de taux de change entre les pays membres), suivi par le Système monétaire européen des années 1980, la France ne s’était-elle pas engagée dans la voie qui mène inéluctablement à l’euro ?
Vous avez raison d’évoquer le Système monétaire européen aujourd’hui presque oublié. Les concepteurs du SME n’avaient pas encore en tête le projet de monnaie unique, qui procède plutôt d’une volonté d’aller vers une organisation fédérale implicite de l’Europe. Leur souci, entièrement légitime, était de remédier, au sein de l’Europe communautaire d’alors, au charivari des monnaies issu de l’effondrement du système de Bretton Woods. Reconstituer un système dont les monnaies seraient stables et, dans certaines conditions, ajustables : telle était leur intention. Ce faisant, ils ont procédé à une novation d’une grande portée, bien plus féconde que la monnaie unique, en inventant un étalon abstrait, sous la forme d’une monnaie-panier, l’écu.
La bifurcation vers la monnaie unique a entraîné la fin du SME et de l’étalon qui en constituait le socle. Elle a placé les économies dans une nasse monétaire dont les plus fragiles n’ont pu s’accommoder. Elle a imposé une politique monétaire uniforme à des économies aussi différentes que l’irlandaise et l’autrichienne, la finlandaise et la grecque, l’allemande et l’espagnole. Elle a enfin porté atteinte au marché unique, puisque les monnaies des pays restés à l’écart de l’euro fluctuent fortement vis-à-vis de la monnaie unique : depuis l’automne 2008, la livre sterling s’est dépréciée de 22 à 23 % par rapport à l’euro !
Justement, ne s’agit-il pas d’abord d’une question de nature politique, à savoir quelle Europe et quels États voulons-nous, et seulement, dans un deuxième temps, d’un problème économique (des États-Unis d’Europe ont besoin d’une monnaie unique, tandis qu’un marché bien intégré d’États souverains peut en faire l’économie) ?
Tous les choix essentiels procèdent de la volonté politique, à partir de critères variables. Il est vraisemblable que la monnaie unique a été décidée dans une intention politique, celle de préparer le fédéralisme économique et, par voie de conséquence, le fédéralisme politique. Mais pourquoi cela a-t-il été décidé au moment précis où l’Allemagne commençait sa réunification ? Les Français, qui ont joué un rôle déterminant dans la signature des accords de Maastricht, ont craint l’avènement d’une Allemagne surpuissante lors même qu’elle était instantanément accablée par le fardeau représenté par ses régions orientales. En imposant la monnaie unique, ils ont fait preuve d’un aveuglement coupable.
Il est vrai que nous avons désormais besoin d’une Europe coopérative. Par cette formule, nous entendons non seulement une Europe qui réalise des projets communs, comme le projet Galileo, mais aussi et surtout une Europe où les États ne sont pas tentés de faire cavalier seul avec l’alibi de la compétition mondiale, comme l’Allemagne en donne le triste exemple par sa politique déflationniste qui aggrave le marasme de ses voisins, sans profit à long terme pour elle-même. Or, cette question, celle de l’Europe coopérative, se pose avec ou sans monnaie unique.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !