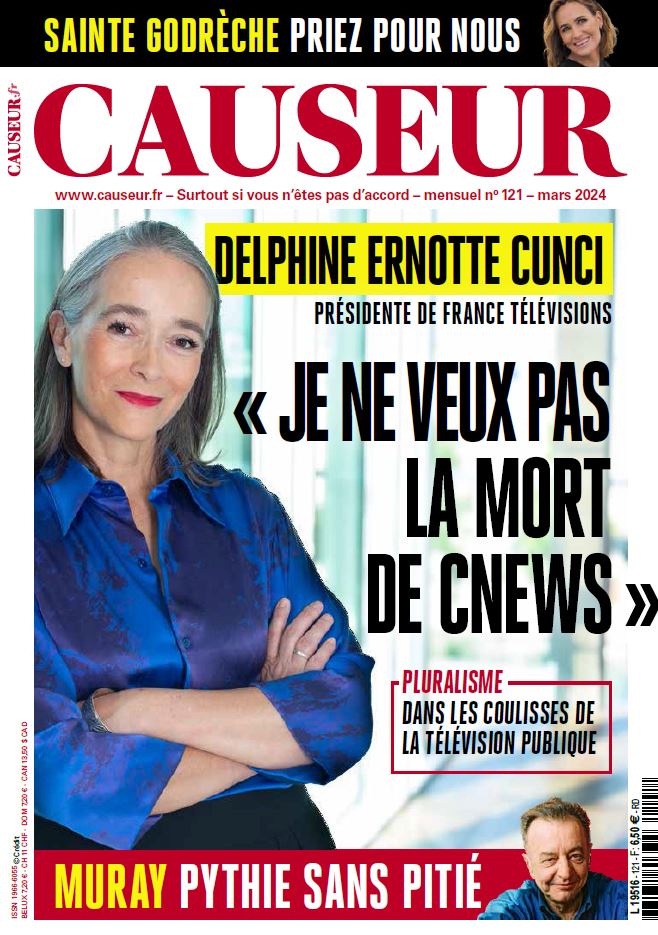Les ultimes volumes du Journal de Philippe Muray sont enfin parus. Cette chronique de l’effondrement du monde contemporain n’épargne personne. Muray y relève les symptômes d’une mutation anthropologique en cours et annonce ses effets ravageurs. Selon l’essayiste Georges Liébert, qui a été son éditeur, cette démonstration d’humour et de lucidité se double d’une superbe férocité.
« Si vous ne craignez pas de lire un écrivain, c’est rare par nature et “clivant”, au lieu de choisir un auteur parmi les centaines que charrie chaque rentrée dite littéraire, alors prenez le dernier Muray. Vous passerez de très bons moments et, en plus, vous rirez ! »
On imagine ce conseil donné par un libraire à l’ancienne, n’exerçant pas comme tant de ses confrères bien-pensants la censure aujourd’hui privatisée à l’endroit des ouvrages suspects.
Pourtant, ce n’est pas d’un roman posthume de Muray qu’il s’agit, mais de l’ultime volume de son plantureux Journal. En dépit de Postérité et de On ferme, Muray dans ce genre n’était pas à son meilleur. Il faut dire que ses débuts en littérature dans les années 1960-1970, à Tel Quel, l’organe de l’avant-garde parisienne, ne l’avaient pas préparé à y briller.
Impossibilité du roman
La linguistique était la discipline reine, amalgamée à la psychanalyse (lacanienne), au néo-marxisme d’Althusser et à la « nouvelle critique » de Barthes et consorts. Marx, Nietzsche et Freud étaient métamorphosés en « philosophes du langage ». Il fallait rompre avec les « codes » établis ; le sujet était en procès ; le signifiant guerroyait avec succès contre le signifié. L’« écriture », concept clef, issu du structuralisme, relevait de la Théorie (titre d’une collection phare des éditions du Seuil). Devant elle, le philosophe, suivant Derrida, devait se défiler dans « une incessante rature ». D’où l’impossibilité du roman, sauf sur le mode expérimental illustré par Sollers, ou non romanesque de Robbe-Grillet.
La vigoureuse disposition critique dont Muray était nativement pourvu s’aiguisa donc encore, au point de quasiment l’inhiber, comme on le voit dans le premier volume du Journal. Stimulé par une vaste culture littéraire et par l’ambition de réussir là où son père, voué, après sa naissance, aux travaux alimentaires, avait échoué, son irrépressible désir d’écrire s’y débat, presque comiquement (pour le lecteur), avec des prolégomènes à l’écriture et des circonvolutions dilatoires sur « les conditions de possibilité du roman ». Pour le réhabiliter pleinement et se lancer toutes voiles dehors, un défaut de lucidité lui manquait : ce point aveugle d’où jaillit la création, en toute immunité.
Mutation