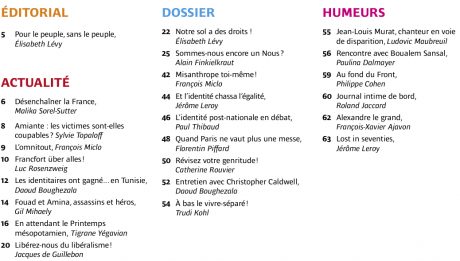Vient toujours, dans la vie d’un homme, un moment où il comprend qu’il doit vivre sa vie et non celle que ses parents ou que ses proches ont voulue pour lui. Pour Mori Ogai, ce moment coïncide avec son départ pour l’Allemagne.
Jusqu’alors, il était un petit prodige, étudiant sans répit, ayant pour seul but de respecter les dernières volontés de son père et d’obéir à sa mère. À 20 ans, il a déjà terminé ses études de médecine, appris l’allemand et le français. À l’armée, il impressionne tellement ses supérieurs qu’ils décident de l’envoyer en mission à Berlin.
Après tout, pourquoi pas ? se dit-il. Jusqu’à sa vingtième année, il n’en est que trop conscient, sa mère s’est employée à le transformer en encyclopédie vivante, alors que ses maîtres visaient à faire de lui une incarnation de la loi. « À la rigueur, note-t-il, dans ses journaux intimes, je pouvais accepter d’être une encyclopédie vivante, mais il m’était insupportable d’incarner la loi. »
C’est dans cet état d’esprit que le lieutenant Mori Ogai, 22 ans, embarque le 22 septembre 1884 à Yokohama.[access capability= »lire_inedits »] Imaginons, d’après les récits de l’époque, l’ambiance qui régnait sur le paquebot. Toutes les nationalités y étaient représentées, et les silhouettes des hôtes à bord caricaturaient la majeure partie des animaux connus : « On se serait cru dans un jardin zoologique », note ironiquement un voyageur. Mais très vite, par une forme triviale de proximité ethnique, les Blancs frayent avec les Blancs et les Jaunes avec les Jaunes. Les premiers jouent toute la journée au deck-tennis ou au deck-golf, sur le pont, cependant que les seconds installés dans le fumoir avec les officiers du navire s’affrontent au jeu de go.
Après avoir passé les premières nuits cloîtré dans sa cabine, Mori Ogai se risque sur le pont et est sidéré par le spectacle qu’offrent six sœurs, les filles d’un pasteur, se divertissant en échangeant des balles sur l’unique table de ping-pong. Elles avaient la même natte de cheveux blonds comme les blés, les yeux d’un bleu délavé et les légères touches de son qui grêlaient leur visage donnaient à leur charme juvénile une vibration de pastel. Le fringant lieutenant Ogai devint un spectateur fervent de leur passe-temps favori et, pour marquer son intérêt, proférait des exclamations admiratives. Cette seule vision suffisait à son bonheur et il songeait qu’à Berlin, peut-être, il aurait l’occasion d’observer de plus près le corps d’une de ces divinités qui, par ailleurs, ne lui prêtaient pas la moindre attention. Car si les Japonais méprisaient les Chinois, les blondinettes, elles, tenaient les Asiatiques pour des êtres inférieurs qu’il convenait, avant de leur concéder une parcelle d’humanité, d’évangéliser, ce qui était précisément la mission de leur père, un vieillard à l’aspect austère qui n’aurait pas toléré le moindre écart d’une de ses ravissantes fillettes.
Mori Ogai, peu attiré par les Européennes plus âgées − il leur trouvait un menton proéminent, un nez démesuré et une voix criarde −, prit son mal en patience. Le soir, il recopiait des pages des carnets de voyage de Ryûhoku qui, dix ans avant lui, avait entamé le même périple, tout en y ajoutant des commentaires personnels. Tout comme Ryûhoku, Ogai trouvait ridicule l’expression publique d’émotions profondes. Dès lors qu’un geste suffisait, pourquoi s’abandonner sur le port de Yokohama à de grossières lamentations ou à d’interminables étreintes au moment du départ ? Tout cela manquait singulièrement de classe. Il n’avait d’ailleurs pas tenu à ce que sa mère l’accompagne. Un homme qui se respecte se reconnaît à la parfaite maîtrise de ses émotions. Et à son absence totale de servilité. C’était d’ailleurs là le principal reproche, outre leur vulgarité, que Ryûhoku, tout comme Ogai et Soseki, formulaient à l’encontre des Chinois. Ils n’éprouvaient pas une once de compassion pour les peuples vivant sous le joug colonial. Il allait de soi pour eux que c’est parce que les indigènes n’avaient pas réussi à moderniser leur pays que les Européens assumaient cette tâche. Tâche qui leur échoirait dès lors que le Japon serait suffisamment fort pour affronter les Blancs et redonner aux peuples asservis un peu de dignité. Tel était le sens de la mission de Mori Ogai, qui se rendait en Allemagne pour y étudier la médecine militaire tandis que Soseki entendait mieux connaître la mentalité anglaise. Autant dire que pour l’un comme pour l’autre, ce fut un échec. La littérature fut leur bouée de sauvetage.
Quatre ans plus tard, lorsque Mori Ogai retourne au Japon, il n’est plus le même : il a, écrit-il, découvert qu’il était bien difficile de se fier aux sentiments des autres et que même ceux de son propre cœur pouvaient aisément varier. Quelques années plus tard, Natsume Soseki, après son séjour à Londres, tiendra à peu près les mêmes propos. L’Occident leur a tendu un miroir. Ce qu’ils y ont vu les a conduits à devenir des écrivains, l’un par remords et nostalgie, l’autre pour ne pas sombrer dans la folie.
Pour Mori Ogai, le remords a un nom : Élise Weinert. Il l’évoque dans La Danseuse : « Ce remords s’est coagulé au fond de mon cœur, rien qu’une simple tache sombre, mais qui, chaque fois que je lis quelque chose, chaque fois que je regarde quelque chose, fait surgir une nostalgie sans borne, comme une ombre se reflétant dans le miroir, comme une voix renvoyée par l’écho, et qui déchire sans cesse mon cœur. »
Ce remords, moi aussi, je l’ai éprouvé après avoir abandonné une jeune Iranienne pour laquelle je croyais être prêt à sacrifier ma vie, devant les grilles d’un hôpital psychiatrique lausannois. Mori Ogai avait pris la fuite devant le spectacle d’une adolescente berlinoise qu’il avait tant aimée, mais que la folie avait métamorphosé en véritable cadavre vivant. J’avais été un lâche et un salaud. Mori Ogai aussi. Mais ne faut-il pas l’être pour survivre ?[/access]
Mori Ogai : La Danseuse. Éd. du Rocher.
Mori Ogai : Vita sexualis. Éd. Gallimard.
Donald Keene : Les journaux intimes dans la littérature japonaise. Éd. du Collège de France.
Cet article est issu de Causeur magazine n ° 41.
Pour acheter ce numéro, cliquez ici.
Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !