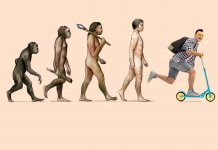Le romancier Jonathan Coe publie Billy Wilder et moi (Gallimard, avril 2021)
Je venais de revoir, en DVD, Fedora, l’avant-dernier film, crépusculaire, de Billy Wilder, le réalisateur tant célébré de « Certains l’aiment chaud » ou « Sunset Boulevard », quand on m’a offert le dernier roman de Jonathan Coe, qui est certainement l’un des plus grands romanciers britanniques contemporains (comment, vous n’avez pas lu Testament à l’anglaise ? Courez l’acheter !).
Billy Wilder et moi raconte donc le tournage de ce film que j’avais vu à sa sortie en 1978. Pour Wilder, certes, dont j’avais admiré cinq ans auparavant « Avanti ! », chef-d’œuvre absolu conspué par la critique de l’époque, mais aussi pour William Holden (le chef de « la Horde sauvage », de Sam Peckinpah, dont j’ai parlé par ailleurs), et pour Marthe Keller : je n’avais pas la télévision, dans les années 1970 (et toujours pas aujourd’hui), j’avais échappé à « la Demoiselle d’Avignon », mais j’avais vu « Elle court, elle court la banlieue » avec Keller et Higelin, « Marathon Man », où elle tient un rôle secondaire, et surtout « Bobby Deerfield », avec Al Pacino — dont elle devint la compagne pour quelques années.
Non, je ne confonds pas Causeur et Gala : ce couple Keller / Pacino apparaît à plusieurs reprises dans le roman de Coe — où Pacino, Américain jusqu’au bout des dents, s’acharne à commander des hamburgers et des cheeseburgers dans les très bons restaurants où on l’entraîne et où les chefs proposent des plats délectables. Tout le septième art des années 1950 à 1980 est convoqué par l’auteur — qui fut critique de cinéma et a écrit une très belle biographie de Humphrey Bogart.
La narratrice (Ciel ! Une appropriation de la féminité par un auteur mâle blanc de presque 60 ans), compositrice de musiques de films, et à ce titre sommée de regarder et noter les navets en lice pour les BAFTA Awards, se remémore les années 1970, où elle était une jeune quiche ignorante au point de ne pas savoir que « Nobody’s perfect » est l’ultime réplique-culte de « Some like it hot », l’un des onze films que Wilder co-écrivit avec I.A.L. Diamond — qui tient dans le roman une place éminente.
Anglo-Grecque, elle est embauchée par Wilder comme traductrice lors du tournage de « Fedora » à Corfou, et elle suivra la production en Allemagne et à Paris — ce qui lui permet de se livrer à un éloge dithyrambique du Brie de Meaux et de Melun.
A lire aussi, Jérôme Leroy: Le Brexit raconté par Jonathan Coe
Ce genre de digression vaudra sans doute à Coe les sarcasmes d’Askolovitch, qui a jadis qualifié de « pétainiste » la rubrique d’un gastronome bien connu qui exaltait le camembert au lait cru : parler du terroir c’est, paraît-il, en revenir aux slogans de la Collaboration, du type « la terre ne ment pas » — et d’ailleurs, elle ne ment pas, la terre, et elle sait faire la différence entre un fromage fermier et les objets plâtreux vendus par Lactalis.
En Allemagne justement, lors d’un repas rassemblant des gens de la production, infiltrés de révisionnistes niant la Shoah, Wilder raconte qu’il avait été engagé en 1945 pour bâtir un documentaire sur les camps de concentration à partir des images récoltées par l’armée américaine au fur et à mesure de sa progression en Allemagne. Et qu’il avait regardé des centaines de kilomètres de pellicule, cherchant désespérément à identifier sa mère, disparue dans l’Holocauste, parmi les survivants faméliques ou les victimes entassées à la pelleteuse.
Et vers la fin du livre, regardant « la Liste de Schindler », dont il avait cherché à acheter les droits, il la cherche encore dans le film de Spielberg. « Je ne regardais plus les acteurs. Je regardais toutes ces silhouettes à l’arrière-plan. J’avais l’impression de contempler… la chose elle-même, en train de se produire, et je me suis rendu compte que j’étais toujours en train de la chercher. J’étais toujours en train de guetter son visage. » Ainsi devient-on l’un des cinéastes les plus drôles d’Hollywood : il n’y a pas d’humour sans une profonde tristesse.
Parce que Billy Wilder s’appelait Samuel Wilder, à l’origine, et il était né en Pologne — tout comme I.A.L. Diamond se nommait Itzek Domnici (d’où son surnom de « Iz ») et venait de Roumanie. Nombre des très grands réalisateurs américains des années 1930-1940 étaient des Allemands réfugiés, des Juifs exilés, survivants d’une Europe mise à feu et à sang par qui vous savez. C’est ainsi que Wilder a commencé sa carrière comme co-scénariste de Ernst Lubitsch, pour lequel il a écrit Ninotchka (rappelez-vous : « Garbo rit ! »), autre Allemand parti plus tôt que les autres — avant Fritz Lang par exemple. Comme Manó Kertész Kaminer, devenu Michael Curtiz (Casablanca), Charles Vidor (Gilda) ou Fred Zinneman (le Train sifflera trois fois).
Comme Coe le fait dire à Wilder, « ce sont les pessimistes qui ont atterri à Beverly Hills avec une piscine dans leur jardin, et ce sont les optimistes qui ont fini en camp de concentration. »
« Fedora » est l’un des films testamentaires d’un certain cinéma « civilisé » (c’est le mot de Coe) dont il est de bon ton de se moquer en ces années 1970 — et aujourd’hui alors, je ne vous dis pas.
A lire aussi, Roland Jaccard: La philosophie du « comme si »
Dès le début, en 1976, Wilder se moque des « films à requin » (les Dents de la mer vient de sortir) et des « barbus » (Coppola, Spielberg, Scorsese) qui tiennent désormais le haut du pavé. Il est d’une autre époque. « Fedora » est donc le dernier feu de ce cinéma crépusculaire, qui s’efface alors devant « Taxi Driver » et autres histoires de sang et de sexe. Wilder salue une dernière fois cette civilisation dont il sent bien qu’elle va sur sa fin.
Et Jonathan Coe, via le cinéma, salue cette littérature — la sienne — dont il sent bien qu’elle disparaît sous l’indécence de l’autofiction et autres dégueulis imprimés. Il y a deux ans paraissait Le Cœur de l’Angleterre, où il fustigeait avec une certaine rage les Brexiters soucieux de se séparer de l’Europe — que Coe voit comme une manne culturelle, pas comme un « grand marché ».
C’étaient ses adieux à la France. Billy Wilder et moi, ce sont ses adieux à un monde d’humour, d’amour, de qualités humaines et de common decency, comme disait Orwell. Toutes choses que l’inflation nombriliste, l’indécence du « tout pour ma gueule » et la suffisance du selfie anéantissent très vite, pour les remplacer par une soumission aux diktats de l’instant, du politiquement correct et du prochain totalitarisme.
Tenez, en ces temps de confinement larvé, présent ou à venir, au lieu de vous focaliser sur les « séries » télévisées, voyez ou revoyez « Assurance sur la mort », « le Gouffre aux chimères », « Sabrina » ou « Ariane », des films merveilleusement incorrects alors que sévissait le Code Hays, et qui le sont encore davantage aujourd’hui, où sévit la dictature « woke ».
Jonathan Coe, Billy Wilder et moi, Gallimard, « Du monde entier ».
Billy Wilder, “Fedora”, DVD, Carlotta Films.