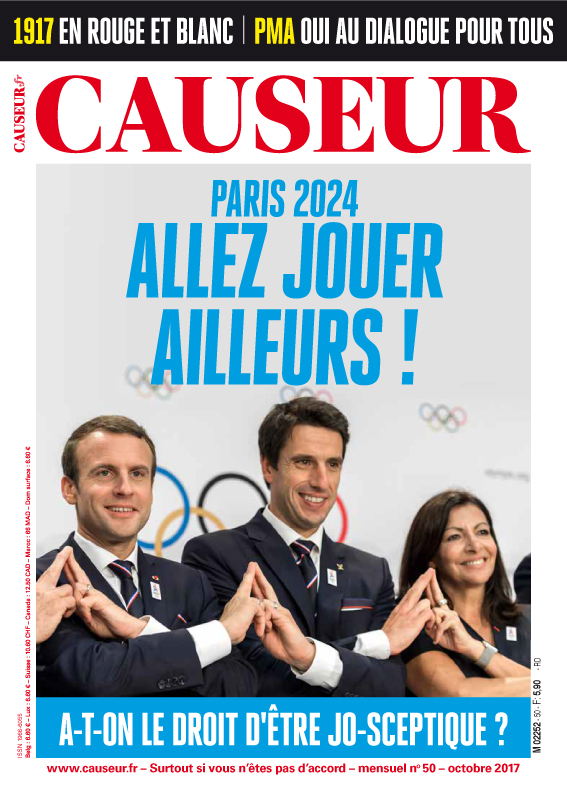Connaissez-vous le syndrome de la robe de mariée? On prétend que cette dépense somptuaire est raisonnable, car la chose resservira ensuite pour d’autres grandes occasions. Ce qui, bien sûr, n’est jamais le cas. Exemple typique: les équipements sportifs hors de prix bâtis par les villes qui accueillent les JO.
Amsterdam, le 12 mai 1970. Après une longue campagne pleine de rebondissements et deux tours de vote, le Comité international olympique (CIO) choisit Montréal comme ville hôte des Jeux olympiques d’été 1976. De retour chez lui, une petite semaine plus tard, Jean Drapeau, maire de l’heureuse élue, tient à rassurer les journalistes, plutôt sceptiques, ainsi que ses administrés. Les Jeux seront placés sous le signe de la simplicité, promet-il, répétant inlassablement qu’autofinancés par les revenus générés, ils « ne coûteront pas un sou aux contribuables ». Mieux encore, assure-t-il, « les Montréalais seront plus riches d’un stade et ça n’aura rien coûté ». Et l’édile de conclure par cet engagement aussi solennel qu’imagé : « Il est aussi impossible pour les Jeux olympiques de Montréal de produire un déficit que pour un homme de devenir enceinte ».
Montréal, 720% de dépassement
Un peu en avance sur son temps, l’éternel maire de Montréal (1954-1957, puis 1960-1986) n’avait pas complètement tort : l’homme enceint(e) n’est plus qu’une question de temps et le dépassement des