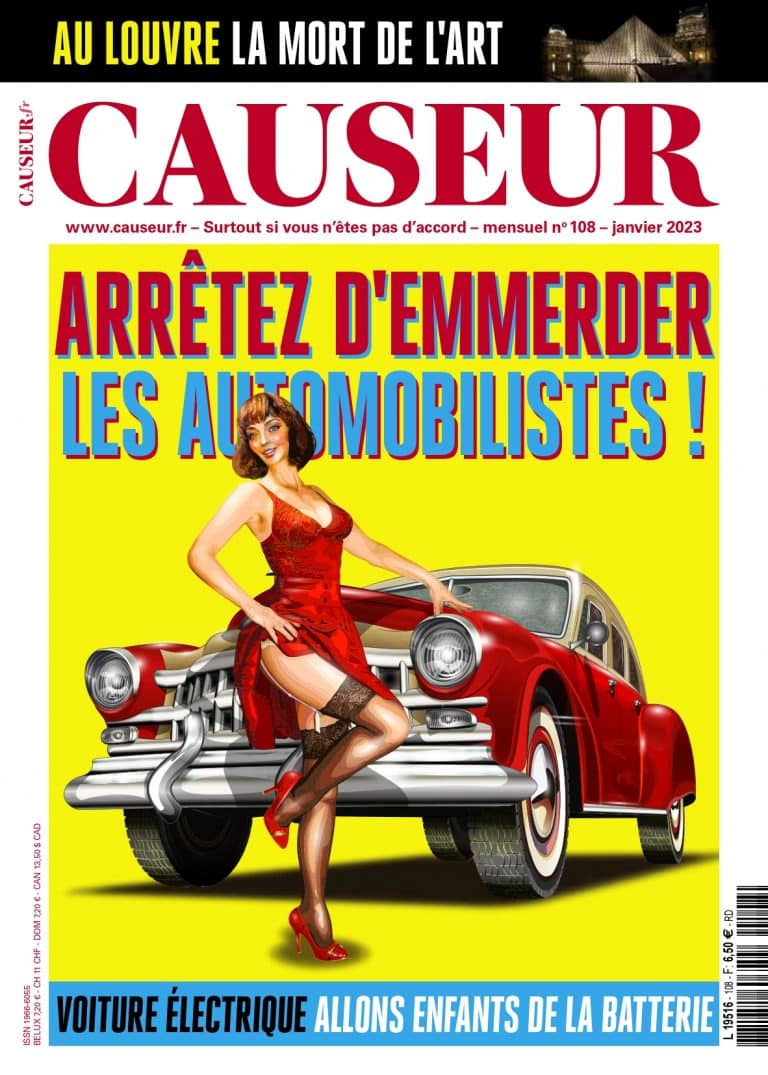La réédition du monumental roman Les Horreurs de l’amour, par Le Dilettante, nous amène à faire un constat simple. Il est temps de considérer Jean Dutourd (1920-2011) pour ce qu’il est: un des plus grands écrivains du XXe siècle.
On nomme purgatoire, dans l’histoire littéraire, cette période où l’écrivain, à peine mort, tombe dans un trou noir de la postérité. Ce n’est pas forcément très grave, le purgatoire, c’est même un moyen comme un autre d’oublier des auteurs dispensables qui ont encombré le paysage de leur vivant. Certains ont occupé le devant de la scène en laissant dans l’obscurité les génies qui ont comme seule consolation de croire à leur génie. Prenez Stendhal, qui répond à Balzac, un des rares lecteurs de sa Chartreuse de Parme, en 1840 : « Je mets un billet de loterie dont le gros lot se résume à ceci : être lu en 1935. » C’était plutôt bien vu.
Le Dilettante, courageux éditeur
Jean Dutourd, qui est mort en 2011, était un stendhalien. Il reçoit d’ailleurs le prix Stendhal pour son premier livre paru en 1946, Le Complexe de César, qui est, ça tombe bien, un manuel d’égotisme, c’est-à-dire le contraire du nombrilisme. Dutourd fait le tour de lui-même et de son époque en préférant la thématique au chronologique : « De la lecture », « De la paresse », « De la conversation », « De la politique », « De l’amour »…
A lire aussi: Si Paucard m’était conté
Jean Dutourd n’a pas éprouvé le besoin de « mettre un billet de loterie ». Il a peut-être eu tort. Certes, il est bien oublié aujourd’hui. Son époque qu’il s’était fait une profession de détester l’avait pourtant gâté. Il a été un écrivain à la mode, il a même sans doute été un des premiers écrivains médiatiques. Les plus de 50 ans, aujourd’hui, qui s’intéressent un peu à la chose écrite n’ont pas échappé à Dutourd. Ses romans se vendaient bien, il écrivait un billet quotidien dans France-Soir, il était un invité régulier d’« Apostrophes », il a recueilli les lauriers de quelques grands prix et… il a été un pensionnaire régulier des « Grosses Têtes », époque Bouvard. Il y a apporté son inimitable ironie, sa science de la distance amusée et, au