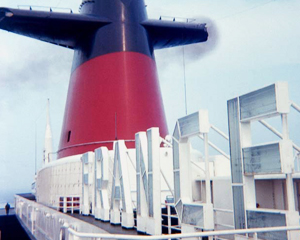J’ai abandonné depuis longtemps mes rêveries chevènementistes – en vrai, Chevènement himself m’y encouragea brutalement en les reniant lui-même avant moi et, en plus, devant moi. Plus précisément, en nous expliquant à la Mutualité, entre la présidentielle et les législatives de 2002, que nous n’étions plus les joyeux lutins qui avaient renvoyé Jospin à la niche au premier tour, mais des degauches respectables, dont l’ultima ratio était de sauver le siège de député du 11e arrondissement de Georges Sarre. Il encourut pour cela une sévère mise au point d’Elisabeth Lévy qui lui rappela, devant 2000 témoins, dont une grosse moitié l’applaudit à tout rompre, les termes initiaux de notre contrat de mariage. Et croyez-moi, quand Elisabeth se sent trahie, mieux vaut ne pas être l’unique objet de son ressentiment, car les mots pour le dire lui viennent aisément.
Bon tout ça pour vous expliquer que, contrairement par exemple à mon meilleur ami (Basile de Koch, à l’heure où je vous parle et depuis 15 ans) et à la plupart de mes proches, je ne suis pas souverainiste, ni même un authentique patriote. Pour tout dire, je ne me sens pas toujours français. Peut-être tout d’abord parce que je n’ai pas toujours été français, ayant été naturalisé à l’âge de 10 ans (je me souviens encore en train de hurler à mes copains, photocopie en main : « Ça y est, j’ai été nationalisé ! »). Avant ça j’étais italien, sans jamais avoir foutu les pieds en Italie. En fait, j’étais un petit juif égyptien foutu à la porte du pays où étaient nés tous ses aïeux depuis au moins des siècles, à cause d’histoires compliquées entre juifs et arabes dont vous avez sans doute entendu parler. Italien, juif, égyptien, en 1965, ça faisait un peu beaucoup pour mes petits camarades de CP de l’école Joliot-Curie d’Ivry-sur-Seine, alors fort peu cosmopolite, qui eurent donc vite fait de me rebaptiser « l’Américain ». Le surnom me resta assez longtemps, très exactement jusqu’à la troisième, où je devins, et pour de longues années, « Max », à la suite d’un exposé – que je jugerai, avec le recul, pour le moins unilatéral – en cours d’histoire à la gloire de Maximilien Robespierre, du Comité de Salut Public et de la Terreur.
De fait, comme quelques dizaines de millions d’humains de par le monde, mon attachement viscéral à la France fut d’abord engendré par l’aventure tragique et christique des suppliciés de Thermidor. Aujourd’hui encore, j’ai tendance à penser (au grand dam de mon amie Elisabeth) que les aristocrates déclassés Robespierre, Saint-Just, Couthon, Lebas eurent raison dans leur erreur, leur horreur, leur Terreur. Entre nous, c’est quand même la dernière fois que ce pays a été gouverné par des honnêtes gens, plaçant, tels Louis XI, Henri IV ou Louis XIV, (et aussi Winston Churchill, Fidel Castro ou Ariel Sharon) l’intérêt supérieur de leur patrie au-dessus de toute autre considération, notamment politique.
N’empêche, avec les années, je me suis rendu compte, que mon patriotisme était souvent superficiel, pour ne pas dire schizophrène. La musique, la littérature, le cinéma que j’aimais venaient tous d’Amérique. Et pour ne rien vous cacher, je préférais toujours un cheeseburger arrosé de coca et suivi d’un carrot-cake chez Joe Allen à toute autre forme de déjeuner. Ajoutez à cela une pointe de désillusion sur la Révolution française. Comme je suis snob, elle ne vient pas, comme tout le monde, de la lecture de François Furet, qui reste pour moi, un remake marxophobe d’Albert Soboul, le sérieux en plus et la verve en moins. Non, finalement, c’est plutôt la découverte du martyre d’André Chénier qui m’a décillé. Et cette phrase de Kleber Haedens, dans Une introduction à la littérature française que je cite de mémoire, qui explique que Jean-Jacques Rousseau sème des pâquerettes et récolte des têtes.
Une fois brisé le tabou robespierriste, les autres verrous sautent sans difficulté majeure. Même pas besoin de savoir que c’est la Chambre issue du Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, ni d’avoir lu les Récits de la Kolyma. On sait d’avance qu’il y a un loup dans l’Histoire.
Donc, mon patriotisme a cessé depuis bien longtemps d’être gothique flamboyant. En 1963, Garaudy et Aragon, pour faire pièce aux canons du réalisme socialiste de Jdanov, avaient hasardé l’heureuse formule : « Pour un réalisme sans rivages ». Mon patriotisme est de cette race-là. Il s’est, dirons-nous pour le fun, « métissé ». En fouillant bien on y trouvera des traces :
– d’occidentalisme primaire (mais version XXL, de Valparaiso à Tokyo, en passant bien sûr par Jérusalem, on n’est pas des pédés) ;
– de cynisme : j’ai bien sûr fait campagne pour le non au référendum sur la Constitution européenne, mais en vrai je m’intéressais beaucoup plus au non qu’à la Constitution, sur laquelle je n’ai toujours pas la moindre opinion ;
– de populisme : une nation, c’est aimable quand il y a un peuple dedans. Le plus simple pour me faire comprendre sera de paraphraser Marx qui explique que ce qui fait une classe sociale, ce n’est pas bêtement sa place dans le processus de production, mais la conscience qu’elle a d’être une classe. Ce qui a fait, ne fait plus et pourra, si Dieu veut, refaire le peuple français, c’est sa conscience d’unicité, d’historicité et d’universalité. Pour dire les choses plus simplement, on est français quand on vibre pour Jeanne d’Arc, La Fontaine, Poussin, la Grande armée, Dumas ou Gainsbourg – et, bien sûr, pour le « souvenir du sacre de Reims et le récit de la fête de la Fédération[1. « Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France : ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » Marc Bloch.] ». Ceux qui pensent que onze décérébrés en bleu beuglant autour d’une coupe en ferraille peuvent y suffire sont des ennemis du peuple et seront, espérons-le, punis comme tels ;
– d’élitisme, parce que ce mouvement ne peut plus venir d’en bas. Le peuple ne s’auto-réparera pas tout seul, tel R2D2. La classe ouvrière et la paysannerie ont disparu en tant que classes, exterminées respectivement par la gauche et la droite en qui elles plaçaient leur confiance. Leur histoire, leur tradition, et leur rôle structurant dans notre identité ont disparu avec elles. C’est triste et c’est tant mieux, tout est à refaire, avec une vague idée de ce qu’il ne faut plus faire. Le sursaut, s’il vient, ne pourra venir que d’une poignée d’intellos « dilettantes et fanatiques[2. De mémoire, c’est ainsi que Gaston Gallimard décrivait, fort joliment, les fondateurs de la NRF.] », qui autour d’un verre de Chablis ou d’Amontillado, se diront que ce serait quand même dommage de faire une croix sur ce pays, parce qu’après tout on l’aime bien, malgré Cauet, Télérama ou l’élection de l’analphabète Simone Veil à l’Académie.
Et enfin il va de soi que tout cela requiert une bonne dose d’optimisme. Mais à quoi ça sert d’être français, si on ne croit pas aux miracles ?
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !