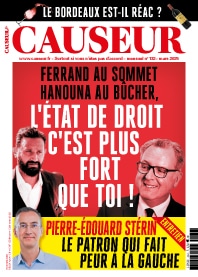Nourris par des interprétations biaisées et des anachronismes historiques, les glissements sémantiques récents autour des vocables de « génocide » ou « otages » ne visent pas seulement à diaboliser Israël, mais à réécrire la mémoire collective en inversant les rôles de victime et de bourreau.
« La plupart de ce que nous comprenons dans le discours public ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la compréhension non consciente que nous apportons aux mots ».
Cette phrase d’un linguiste américain, George Lakoff, permet d’appréhender les ressorts manipulés dans la guerre des mots qui cherche à façonner l’opinion, fait rage contre Israël et pour laquelle le terme de propagande n’est qu’un vernis superficiel. De fait, prétend Lakoff, le sens que nous donnons au monde qui nous entoure ne provient pas d’un affadissement d’idées transcendantes dont nous chercherions, comme le veut la tradition platonicienne, à retrouver la pureté première, mais d’un bricolage subjectif fondé sur notre bagage de sensations et d’expériences et incarné dans des métaphores conceptuelles. Lorsque Dominique de Villepin dit que « Gaza est un camp de concentration