Le nouveau livre d’Isabelle Muller est un pied de nez aux doctrines qui visent à abolir les spécificités féminines et masculines. Avec talent et audace, elle réveille les esprits anesthésiés.
Voici le livre de la nécessaire réhabilitation des évidences perverties, le guide salutaire de la reconquête des territoires perdus de la raison.
L’auteur, Isabelle Muller (nous nous épargnerons ici les balourdises du type autrice), accompagnant un jour de 2018 la philosophe Marianne Durano à l’émission Répliques d’Alain Finkielkraut (France Culture), entend avec stupeur l’autre intervenante invitée prophétiser l’avènement des temps de l’« autoengendrement à plusieurs », une bizarrerie dont on doit comprendre qu’elle consacrerait la phase ultime de l’abolition tant promise de la différenciation des sexes. On me pardonnera de ne pas développer plus avant cette révélation, l’autoengendrement, fût-il à plusieurs, s’inscrivant pour moi dans le registre des jargonnantes inepties du moment si prisées des maîtres à penser de ces territoires perdus de la raison évoqués plus haut.
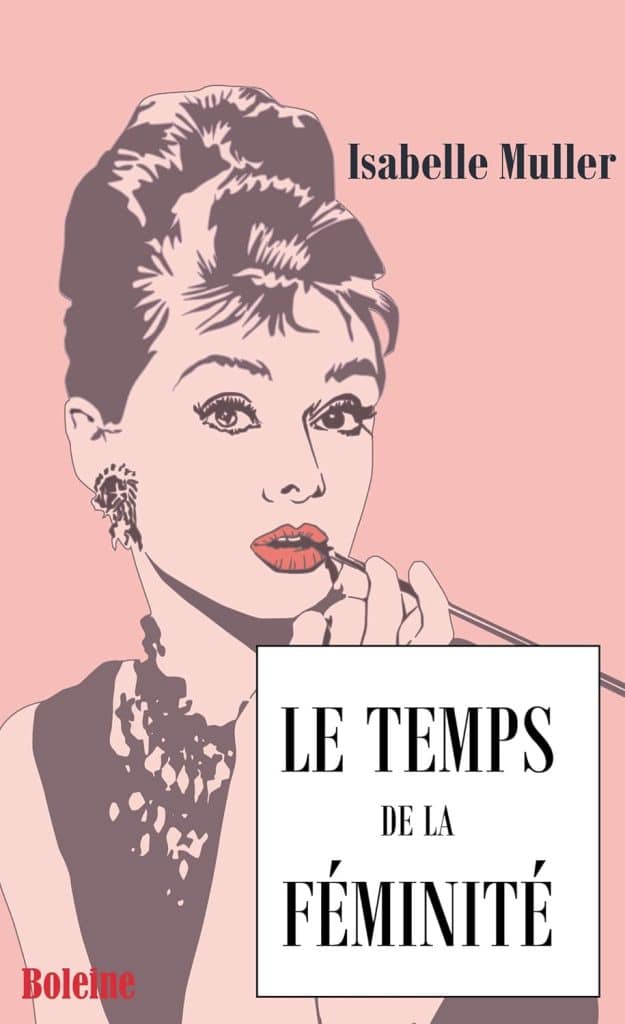
Sentiment d’urgence
Face à cela, l’auteur est saisi de l’urgence de prendre la plume. On la comprend. Elle le fait avec une audace intellectuelle que les doctrines successives visant à l’abolition des spécificités féminines et masculines ont fini par chasser peu ou prou de nos esprits anesthésiés. Pensez donc ! Isabelle Muller ose la question : « Qu’est-ce qu’une femme ? » On entend d’ici les ricanements, les sarcasmes des wokistes d’en face. « Persister à s’interroger sur un truc qui n’existe pas, qui n’existe plus ? On ne fait pas plus ringard ! Comment peut-on ? » Or, notre auteur ne s’en tient pas à cela en matière d’audace conceptuelle, elle va jusqu’à développer le thème de la spécificité de l’âme féminine. Déjà, en soi, parler de l’âme ne court pas les pages de la littérature actuelle. Quant à lui accoler le qualificatif « féminine », cela frise le crime d’hérésie. Le bûcher n’est pas loin.
A lire aussi: Dangereuses, vraiment ?
Or, ne serait-ce qu’en référence à ces deux thèmes – centraux, il est vrai – du livre d’Isabelle Muller, je me permettrai, moi qui suis un homme (on me pardonnera aussi cette obscène revendication), de recommander la lecture du Temps de la féminité en premier à mes semblables, masculins, donc. (La lâcheté étant un de nos travers marquants, si cela les arrange, qu’ils le lisent en cachette. Mais qu’ils le lisent.)
Non seulement, ils renoueront avec l’évidence aujourd’hui pervertie de l’absolue spécificité du féminin, mais ils ne pourront que se laisser convaincre que cette spécificité ressortit tout simplement au sublime. « Une femme, par sa biologie et le corps qui lui est donné, écrit Isabelle Muller, peut accueillir la vie en son sein, faire grandir un être qui n’est pas complètement le sien, et donner naissance à une personne […] Elle engendre dans son propre corps, ce que l’homme ne peut pas. (Il engendre dans le corps d’autrui). » Et de convoquer Aristote en appui de son propos : « De cette différence essentielle, vertigineuse, naît tout le reste », conclut notre philosophe tutélaire. (Sur ce point, s’opposent donc la pensée d’Aristote et celle de Sandrine Rousseau. Arbitrage ô combien difficile).
Puis l’auteur se réfère à Marianne Durano, la jeune philosophe qu’elle accompagnait le jour de la révélation du « réengendrement » en réunion. « Qu’est-ce qu’être une femme? interroge cette dernière. C’est vivre dans sa chair la possibilité d’un autre, redouté et désiré, dont la virtualité même scande son avenir. C’est rejouer chaque mois le rythme des saisons, l’effervescence du printemps et la décomposition de l’automne, savoir intimement que l’humain est un être de nature, et que la vie en lui veut se transmettre avant de mourir. »
Tout est dit. Poétiquement dit, qui plus est. (À ce propos, le texte d’Isabelle Muller s’enrichit de poèmes éclairants et, en fin d’ouvrage, de textes d’auteurs de référence.)
A lire aussi: «Transmania»: le plus gros «casse conceptuel» du siècle?
Dès lors, on se convainc sans peine que la très forte évidence ainsi affirmée – ou réaffirmée, ayant été oubliée, gommée, chassée – n’est autre que ce qui fonde la « supériorité métaphysique de la femme » et que, partant, elle devrait s’imposer à tous. Tranquillement, sereinement. Joyeusement. Dans la magie d’une adhésion à une sorte d’Amor Fati, d’amour du destin.
Être une femme, c’est vivre dans sa chair la possibilité d’un autre, venons-nous de lire. Cela exprime tout simplement que, à elle seule, cette possibilité constitue la condition nécessaire et suffisante de la féminité, quand bien même, pour telle ou telle raison, cette possibilité ne serait pas suivie d’effet. Nous sommes donc loin ici d’une quelconque injonction à procréer, cette interprétation biaisée et caricaturale que l’idéologie woko-féministe se complaît à agiter tel un épouvantail à peine est murmuré le beau mot de féminité.
Le féminisme fait désormais des femmes des victimes permanentes
Tout aussi caricatural serait de cantonner le champ d’excellence de l’âme féminine dans la sauvegarde, la protection du foyer compris dans sa seule dimension domestique, le bien fondé et la noblesse de celle-ci n’étant d’ailleurs nullement contestables. Mais le foyer en tant que territoire de féminité me semble devoir s’étendre évidemment bien au-delà. Lorsque la petite bergère de Lorraine s’engage et prend les armes, c’est au secours du foyer national, de la Patrie qu’elle vole. Ainsi de ses continuatrices de la Résistance, pour ne prendre que cet exemple. Quant à celles, innombrables, qui au sein du foyer – domestique cette fois – déployaient dans le même temps des trésors d’ingéniosité pour faire bouillir le rutabaga et nourrir le gosse et l’aïeul, il est bien clair qu’elles faisaient l’acceptation du même devoir sacré. Assurer la pérennité du foyer.
« Il revient à la femme de poser des choix conscients, écrit encore Isabelle Muller […] Rien ne justifie que les femmes se laissent imposer des parcours qui ne sont pas les leurs, des choix inconscients qui les empêcheraient de remplir leur mission essentielle. » Aujourd’hui le spectre de ces choix est ouvert au plus large. « De justes et nécessaires changements sont intervenus », se félicite-t-elle. Mais, à l’inverse, elle ne peut que déplorer la dérive délétère actuellement en marche : « Alors que les femmes ont acquis une juste égalité, une place et un rayonnement dans la société sans doute jamais égalés, notre époque cherche à déconstruire la différence des sexes […] Elle fait d’elle [la femme] une victime permanente qui serait sans cesse discriminée. »
Voilà donc le piètre résultat d’un féminisme, sans doute originellement profitable et légitime sur le plan social, mais qui, s’ingéniant à nier la féminité n’aurait réussi, au fil de dévoiements et d’errements multiples, qu’à nier la femme même.
Refermant le livre d’Isabelle Muller, surgit tout naturellement une autre évidence. Le temps du féminisme ayant produit ce que l’on sait, n’y aurait-il pas urgence à passer à celui de la féminité ?
Isabelle Muller, Le temps de la féminité, Éditions Boleine, 2024.

Vous avez refusé les cookies et vous ne pouvez donc pas accéder à notre contenu « premium ».
Nous vous invitons à revoir vos préférences de cookies en cliquant sur “Changer”
OU
Pour profiter d'une expérience sans interruption et d’un accès complet à tous nos articles et contenus exclusifs :
Je m'abonne



