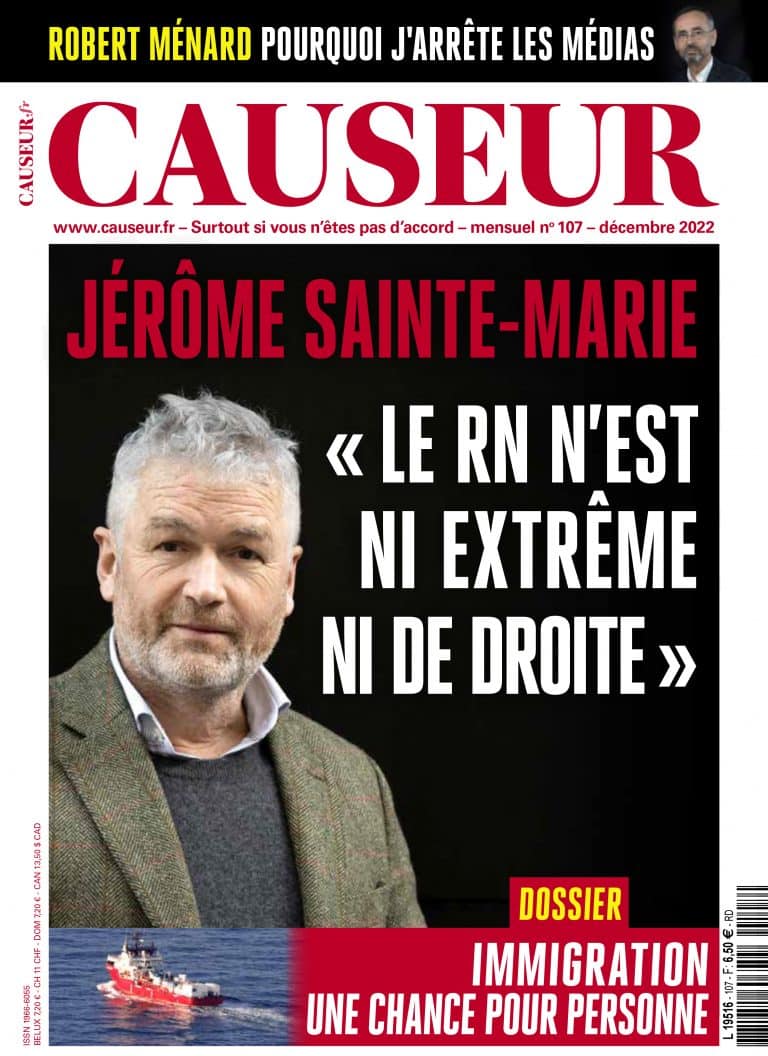Les réseaux et les filières en tout genre prospèrent sur le dos d’une administration et d’une justice humanitaristes, avec la complicité d’ONG. Et cela, au détriment des plus pauvres de nos concitoyens.
Il fut une époque, en France, où le patronat organisait l’immigration en fonction de ses besoins, des recruteurs se chargeant de sélectionner dans les pays d’origine des hommes assez vaillants pour travailler dans les mines ou sur les chaînes de l’industrie automobile. Les organisations patronales géraient les accueils, finançaient la Sonacotra, chargée de loger les salariés dans des foyers, et le Service social d’aide aux migrants. L’État était aux abonnés absents et la gauche – alors communiste – manifestait contre une importation de salariés qui tirait les salaires vers le bas. Aujourd’hui, des secteurs professionnels sont en tension (femmes de ménage, aides-soignantes, soutien à la personne, médecins, métiers du bâtiment…), mais l’immigration professionnelle a disparu. Dans les textes, elle existe toujours mais, dans les faits, personne n’y a recours, hormis les grands groupes, surtout américains, pour leurs cadres de haut niveau. Depuis que l’État a pris la main, la France a perdu toute capacité à organiser son immigration. Par défaut, elle est devenue le business de l’économie criminelle, une économie dénuée de tout scrupule et vivant grassement sur le dos de millions de victimes auxquelles elle fait miroiter l’espoir d’une vie meilleure. Les organisations spécialisées de ce secteur lucratif sont les mêmes que celles qui alimentent l’Europe – et la France particulièrement – en produits stupéfiants. Elles tiennent la route de la cocaïne qui, débarquée en Afrique de l’Ouest, est acheminée à travers le Sahara jusqu’au Maroc, puis l’Espagne ou qui, transportée par le Mali, l’Algérie et la Libye, traverse la Méditerranée pour aboutir au sud de l’Italie avec l’aide de la mafia locale. Et elles tiennent celle de l’héroïne, produite en Afghanistan et transportée en Europe de l’Ouest à travers la Turquie, la Grèce et les Balkans. Ces réseaux ont organisé une effroyable loterie dont les gagnants auront été assez riches pour payer un « billet » vingt fois supérieur au prix du billet d’avion sur la même destination (on trouve un Conakry-Paris pour moins de 400 euros) et assez chanceux pour survivre à la traversée du désert, au viol, aux mauvais traitements, au travail forcé et à une navigation incertaine sur des embarcations de fortune. La suite n’a pour eux aucun intérêt.
Pour leurs victimes, le miroir aux alouettes a parfois des allures de mauvais film. Débarquées à Paris, elles plantent leurs tentes de fortune dans des parcs publics ou sous les lignes de métro, noient leur désespoir dans la consommation de crack (vendu par leurs « frères ») ou plongent elles-mêmes,