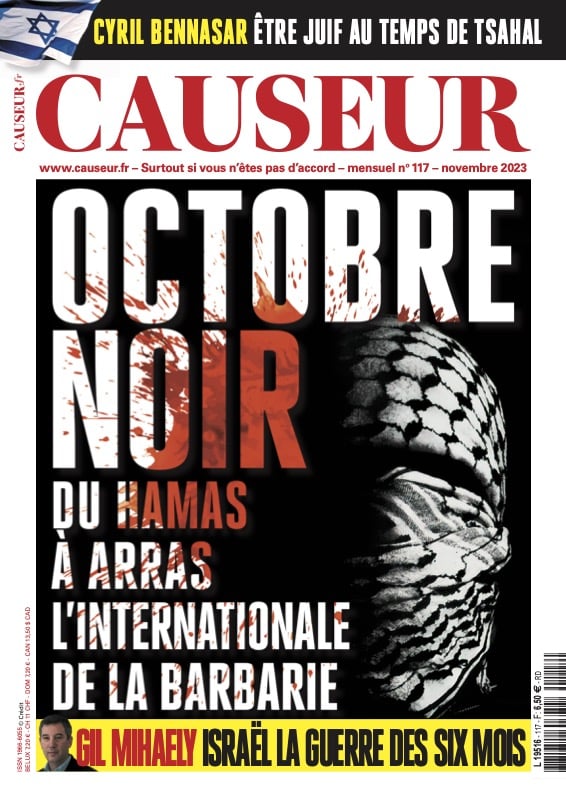En matière d’immigration, l’administration peine à faire appliquer la loi. Moyens financiers limités, directives politiques floues voire permissives et contre-pouvoir des associations permettent à la majorité des clandestins de demeurer sur notre sol. Et le terrorisme profite de cette mécanique incontrôlable. L’ancien préfet Michel Aubouin témoigne.
Les gestionnaires de l’immigration ne manquent pas de travail. Si une grande partie des immigrés entrent en France de manière légale, une part non négligeable le font sans autorisation ou y demeurent au-delà de la date de validité de leur visa. Assez logiquement, ces derniers devraient être invités à quitter le territoire national ou à se mettre en conformité avec la loi, mais, comme leur intention n’est pas de repartir, il y a peu de chance qu’ils le fassent spontanément. Un bras de fer s’engage alors entre le clandestin et l’administration. En général, l’administration a plutôt l’avantage et il est difficile pour un Français de contester le fisc, le droit de l’urbanisme ou une infraction routière. En matière d’immigration, c’est le contraire. L’administration est vulnérable, ou plutôt elle l’est devenue, car les décideurs politiques, par crainte d’encourir les reproches des faiseurs d’opinion, ont multiplié les exceptions à la règle.
Combien de clandestins en France ?
La majorité des clandestins demandent l’asile (136 000 en 2022) et ils ont une chance sur trois de l’obtenir. Les autres, les plus nombreux, deviennent donc