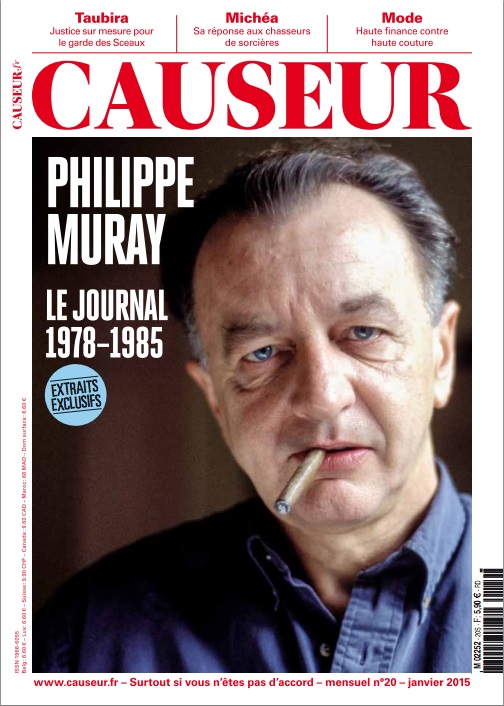On peut se gausser de ces petites cérémonies de chiffon, baptisées désormais « fashion weeks », où se retrouvent à intervalles réguliers quelques excentriques, les figures changeantes ou habituelles de ce qu’on nommait naguère le Tout-Paris, et les météorites de l’actualité plus ou moins heureuses. On peut feindre d’en être offusqué, et l’on peut certes moquer ces forains de vanités et autres figurants de la parade sociale. Il reste qu’une société sans mode, et sans la mondanité brillante qui l’accompagne, privée de sa chatoyante extravagance, serait non seulement morose, mais encore inquiétante.
On peut se gausser de ces petites cérémonies de chiffon, baptisées désormais « fashion weeks », où se retrouvent à intervalles réguliers quelques excentriques, les figures changeantes ou habituelles de ce qu’on nommait naguère le Tout-Paris, et les météorites de l’actualité plus ou moins heureuses. On peut feindre d’en être offusqué, et l’on peut certes moquer ces forains de vanités et autres figurants de la parade sociale. Il reste qu’une société sans mode, et sans la mondanité brillante qui l’accompagne, privée de sa chatoyante extravagance, serait non seulement morose, mais encore inquiétante.
Il y a dans ce genre de manifestation comme la preuve du serment tacite qu’une nation se fait à elle-même : maintenir crânement son droit à la futilité, à l’éblouissement. La mode et, au-dessus d’elle, la haute couture sont un défi à l’usure du temps, une espèce d’imprécation très humaine lancée contre l’habitude, la répétition et l’inévitable fin des choses, des êtres et des liens qui les unissent (lire l’entretien avec Viviane Blassel).
Cet univers a connu en trente ans une série d’événements qui l’a placé au centre d’un dispositif stratégique tout entier animé du désir de conquête et de rayonnement. Par ses méthodes de communication, par les moyens qu’il a mis en œuvre pour gagner des marchés et des clients, il a bouleversé tous les repères du goût et du jugement esthétique qui le gouvernaient auparavant. Sous plusieurs aspects, il peut s’apparenter à celui de l’art dit contemporain.[access capability= »lire_inedits »]
Pompidou l’audacieux
« Chère vieille France… La bonne cuisine… Les Folies Bergère… Le gai Paris… La haute couture, les bonnes exportations… Du cognac, du champagne et même du bordeaux et du bourgogne : c’est terminé ! La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle ! » (Georges Pompidou, conférence de presse du 15 novembre 1972).
Le président ne pouvait imaginer que, quarante ans plus tard, les délocalisations, les restructurations et la numérisation proliférante auraient radicalement transformé l’économie française, projetée sans précaution dans la mondialisation, ni que le champagne connaîtrait une courbe des ventes exponentielle jusqu’en Chine et en Russie. Quant à la haute couture, alors sur le déclin, et bien que toujours peu rémunératrice par elle-même, nul ne prédisait alors qu’elle deviendrait l’étendard du secteur du luxe, deuxième source d’excédent commercial, immédiatement après l’aéronautique !
Aujourd’hui, Georges Pompidou lui rendrait assurément toute sa place dans les fleurons de notre prospérité. Deux hommes sont à l’origine de cette renaissance, deux entrepreneurs d’un genre particulier, bien différents de Marcel Boussac, dont la faillite retentissante allait faire la fortune de l’un et contribuer à celle de l’autre. Deux hommes qui, à l’instar du président Pompidou, collectionnent les artistes de leur temps.
Il se trouve que Bernard Arnault et François Pinault – car c’est d’eux qu’il s’agit – sont les contemporain de Jeff Koons et de Paul McCarthy !
De l’or parmi les ruines
Le 25 mars 1980, on enterre Marcel Boussac. Il avait été immensément riche, très avisé dans ses affaires, puis la chance l’avait quitté. Progressivement, son immense empire, principalement dans le textile, s’était effondré. Il produisait, mais il ne savait plus vendre ; par surcroît, ses convictions paternalistes lui interdisaient de licencier un seul membre de son nombreux personnel. Il meurt complètement ruiné.
En 1976, Boussac est repris par la Société foncière et financière Agache-Willot, qui dépose à son tour le bilan en 1981. Le gouvernement socialiste est très ennuyé : l’ensemble représente encore 16 000 emplois. Au terme d’une interminable séquence politico-juridique, la préférence est accordée, en 1984, au plan de reprise de Bernard Arnault. Sorti major de Polytechnique, il dirige encore l’entreprise immobilière familiale Férinel. Avec l’assistance administrative et financière de l’État, et après la promesse – qu’il ne tiendra pas – de conserver le plus grand nombre d’emplois, il conduit une habile, implacable « restructuration ». Il revend les actifs pour ne conserver que Conforama, Le Bon Marché, et une maison de couture, un peu en déshérence mais prestigieuse, Dior. Bref, Bernard Arnault nettoie, et garde le meilleur pour lui. Le Courrier picard aura ce titre révélateur : « Boussac : des ruines qui font de l’or » (2 juin 1989). Ensuite, avec une infinie patience, sans ménager les hommes, à force de ruse, de séduction, d’alliances signées puis rompues sans préavis, guidé par une vision nette des nouveaux marchés du luxe, il construit la plus grande fortune de France.
Les deux tycoons
Un autre personnage entre en scène : François Pinault. C’est un Breton réservé. Il n’a pas l’onctuosité catholique et bourgeoise de Bernard Arnault. Ces deux hommes aiment la pénombre des calculs froids, la prudence des manœuvres réfléchies. Au début, Arnault et Pinault s’accordent : le premier revend au second Conforama. Puis ils se livrent une guerre impitoyable. De leur affrontement, de la haine qu’ils se vouent, de leur capacité à se nuire réciproquement, naissent deux splendides groupes du luxe français[1. L’industrie mondiale du luxe (à l’exception des automobiles, des yachts et des œuvres d’art) est dominée par LVMH-Moët Hennessy Louis Vuitton SA, dont le chiffre d’affaires en 2012, grâce à une croissance de ses ventes de 18,6 %, atteignait plus de 9 milliard d’euros. Kering occupe la sixième position (5,849 milliards), L’Oréal la septième (5,240 milliards d’euros), Hermès la douzième (4,481 milliards).].
Celui de Bernard Arnault, le plus vaste, est baptisé LVMH (Louis Vuitton-Moët Hennessy). Il représente le champagne (Krug, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Mercier…), les vins (château Cheval Blanc, château d’Yquem), la maroquinerie (Louis Vuitton, Céline, Loewe, Berluti…), la mode (Givenchy, Kenzo, Emilio Pucci, Christian Dior, Marc Jacobs…), les parfums et la cosmétique, la joaillerie et les montres (Tag Heuer, de Beers, Hublot, Chaumet…), la distribution dite sélective (Le Bon Marché Rive Gauche, Sephora…), la presse (groupe Les Échos), et encore La Samaritaine (futur palace ?), le Jardin d’acclimatation (lire l’article de Janie Samet)…
Celui de François Pinault (ex-Pinault-Printemps-Redoute, devenu Kering) est beaucoup moins étendu, mais considérable tout de même : la mode (Gucci, Stella McCartney, Balenciaga, Alexander McQueen, Saint Laurent, Bottega Veneta…), la joaillerie (Boucheron), le sport comme mode et style de vie (Puma). La chaîne de magasins Printemps a été vendue et des négociations sont engagées pour la cession de La Redoute.
Chic et choc
Bernard Arnault et François Pinault ont entraîné le modèle, d’inspiration aristocratique, de la haute couture[2. Une maison de haute couture se définit légalement par des vêtements faits à la main, sur mesure, dans des ateliers dédiés ouverts toute l’année.] et, généralement, du luxe de l’autre côté du miroir, où règne l’implacable loi du marché ouvert, de la concurrence acharnée. La paix régnait entre eux jusqu’à l’entrée de François Pinault dans le capital de Gucci, entreprise de maroquinerie florentine dirigée à l’époque par Domenico De Sole, et par Tom Ford pour le style. Bernard Arnault convoitait Gucci, il s’estime trahi. Nous sommes en 1999. L’affaire Gucci précipite les adversaires dans une effarante guerre d’acquisitions, qui se trouve à l’origine de la métamorphose du luxe français et de son insolente prospérité.
Tom Ford, chez Gucci, a imposé des idées très agressives en matière de marketing. Il développe le concept de « porno chic », inauguré par le photographe Helmut Newton ; et l’on voit, dans les magazines féminins, des publicités tout à fait « explicites », qui empruntent aux pratiques du cinéma pornographique, mais habillées, maquillées, parées des attributs du luxe le plus ostentatoire. Le mouvement est lancé, la surenchère dans la provocation de posture ne s’arrêtera plus.
Le luxe contre les bourgeois
En 1995, B. Arnault a recruté John Galliano au poste de directeur artistique de Givenchy. En 1996, il le déplace chez Christian Dior, avec la consigne de « désembourgeoiser la maison ». Le couturier, indiscutablement talentueux, remplira parfaitement sa mission. En 2000, sur le podium, ses mannequins sont vêtus de hardes luxueuses pour le défilé « Clochards ». Il vante sans rire « l’ingéniosité que déploient les déshérités pour se vêtir ». Cela grince un peu, mais la presse suit : triomphe, révérence. On crie au génie. Dior est l’un des plus grands annonceurs…
Le nouveau capitalisme ne s’encombre pas de bonnes manières. Il cherche à être efficace, c’est-à-dire à écouler rapidement ses marchandises. Le luxe est l’un de ses plus rentables champs d’expérience. « Désembourgeoiser », cela veut dire qu’on délaissera la vieille clientèle sobrement élégante de la maison, et qu’on attirera, par tous les moyens, un public nouveau, rajeuni, envoûté par l’illusion féerique.
En 1947, Christian Dior installe une silhouette féminine inédite, qui va être reprise partout dans le monde. Le new-look de Dior instaure une référence esthétique reconnaissable entre toutes. Galliano et ses semblables créent des événements éblouissants, des chocs visuels, des scandales médiatiques à usage commercial, mais inventent-ils une silhouette durable, reconnaissable ? Là n’est plus la question qui guide la haute couture. Dior est à présent une maison profitable. Galliano devient incontrôlable, même par Arnault. La créature a échappé à son créateur. Il déclare, superbe : « Grâce à moi, la mode est entrée dans le xxie siècle. »
On ne rit pas
Le couturier a cédé la place au directeur artistique. Comme l’artiste contemporain, il incarne la rébellion, la transgression. Il brouille les signes évidents, rassurants de la haute couture. Aux défilés tranquilles ont succédé des blockbusters du chic, peuplés de hordes sauvages, de créatures à la beauté bizarre qui arpentent les podiums tels des conquérants pressés. La transformation des mannequins, de leur apparence, a été radicale : femmes ou hommes, ils affichent un air tantôt accablé, tantôt absent, toujours méprisant. Ils s’exposent, mais ils se refusent. Plus encore : ils s’opposent au groupe, fût-il fortuné, sélectionné, qui les observe, ils le toisent, ils le défient. Enfin, ils ne sourient jamais ; la joie, même furtive, l’esquisse d’un bonheur fugace seraient aveux de faiblesse. Le rire rend les hommes égaux, les mannequins ne sont pas nos égaux ; quelque chose de mystérieux, qui n’est pas toujours la beauté, les sépare de la communauté banale des hommes[3. Il y a de notables exceptions, ainsi Jean Paul Gaultier : ses mannequins n’ont pas toujours le « physique de l’emploi », et jouent volontiers la carte de l’humour. Quant à Gaultier lui-même, il ne craint pas de démontrer son bonheur d’être et de créer.].
Cette physionomie d’où le rire est absent, une personnalité en a fait sa signature, Anna Wintour. Elle ordonne, réglemente, sous son carré impeccable de cheveux et derrière le noir impénétrable de ses immenses lunettes, l’industrie du luxe et ses milliards de dollars. Mme Wintour, diable habillé par Prada[4. On dit que pour le personnage central de son livre (dont on a tiré un film fort médiocre) Le diable s’habille en Prada, Lauren Weisberger s’inspira de la personnalité d’Anna Wintour. Elle avait été son assistante à Vogue.], à la tête de Vogue, dispose de la puissance de feu du magazine (plus d’un million d’exemplaires vendus mensuellement aux États-Unis).
King Karl
Karl Lagerfeld, dandy de fable, figurant une manière carnavalesque d’Erich von Stroheim, ne déteste pas le rire. Il jouit d’une féroce intelligence et d’une vaste culture, bien utiles pour nourrir son torrentiel débit de mots et ses formules percutantes. Dessinant des vêtements depuis l’adolescence, graphiste avant tout, il connaît parfaitement son métier. Il a la science d’une première main. Bénéficiant d’une santé de fer, renforcée encore par une diététique savante qui lui fait des joues creuses, ce personnage plus balzacien que proustien a commencé dans la partie en même temps que Saint Laurent. Il cultiva avec ce dernier une frivolité seventies mêlée de XVIIIe siècle, jusqu’à leur brouille, en 1975. Yves Saint Laurent, prince en exil intérieur, développa sa griffe, établit la puissance de son nom, alors que la grande réussite de Lagerfeld demeure le sauvetage de Chanel, dont il a contrarié l’esprit sans le trahir.
Lagerfeld, personnage soufré, a appris les règles de la survie en milieux luxueux. Il affronte la mondialisation, il ne craint pas le diable, il dîne sans crainte avec Bernard Arnault.
Fin d’un cycle ?
Jeff Koons en 2008, Takashi Murakami en 2010, au château de Versailles, Paul McCarthy, place Vendôme, le défilé Chanel printemps-été 2015, qui s’acheva par une parodie de manifestation menée au porte-voix par Gisèle Bündchen, mannequin vedette : ricanements hypercritiques, défis de dérision, banderilles plantées dans le corps du capitalisme, non pour l’affaiblir mais pour lui redonner de l’énergie. Toute l’organisation de ce monde ne tient que par un mouvement perpétuel. Si celui-ci s’interrompt, il tombe. Cependant, la provocation, lorsqu’elle n’a plus qu’une scène de paillettes et de dorures pour se manifester, est un art perdu. La mode a achevé sa métamorphose, cherchant à entraîner avec elle nos certitudes, nos repères, nos « valeurs ». Cela lui confère une étrange parenté avec les dernières aventures de l’art. Certains de ses « héros » paient très cher leur surexposition : Alexander McQueen se suicide, John Galliano, alcoolique, provoque un scandale qui entraîne sa chute.
François Pinault, à qui l’on refusa d’élever un édifice en lieu et place des usines Renault, sur l’île Seguin, où il eût montré les œuvres qu’il possède, a réalisé son rêve dans son palais Grassi, à Venise. Bernard Arnault est aujourd’hui le banquier de la mode et le mécène des arts. L’architecte Frank Gehry a imaginé le splendide bâtiment de la Fondation Louis Vuitton. Les volumes d’exposition y sont impressionnants, mais qu’y verra-t-on, quelles œuvres y auront un droit d’accès ?
1984-2014 : trente années sont passées sur la mode et sur l’art. Dans ces deux domaines, les contraintes du monde global ont affolé le rythme, brisé les moules anciens, effacé les mémoires. Le luxe est un univers impitoyable. Et en expansion.[/access]
Photo : Wikimedia Commons
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !