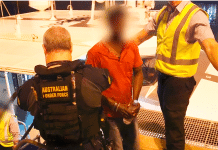Dans Le Peuple de la frontière, notre ami Gérald Andrieu raconte sa longue marche de Dunkerque à Menton, à la rencontre d’une France oubliée par le journalisme politique avide de petites phrases. 2000 kilomètres à pied, ça use les souliers mais ça clarifie les idées.
Gérald Andrieu a un problème : son métier a mal tourné. Depuis qu’il a décidé de faire journaliste, il est hanté par une détestation et par une peur, peut-être transmises par Philippe Cohen, qu’il a eu la chance de croiser quand il entrait dans la carrière. La détestation, c’est celle du journalisme politique qui consiste à « côtoyer au plus près les prétendants au trône sans jamais discuter avec ceux qui décident s’ils le méritent ». La peur, c’est celle de devenir un de ces journalistes-ethnologues qui observent le peuple et ses fâcheuses manies à travers un microscope idéologique. « Alors, on est venu voir comment vit