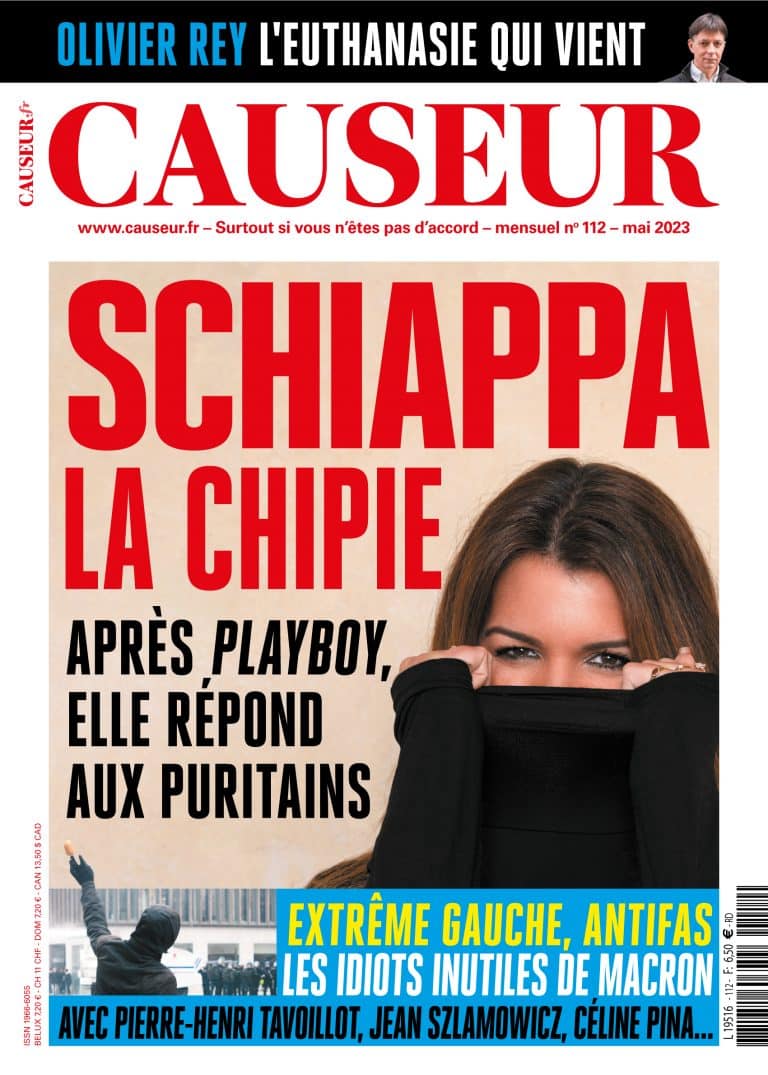Les personnels des sociétés produisant des fictions pour la télé, le cinéma et les jeux vidéo doivent désormais se plier à un stage pour « prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles dans l’art et la culture ». Certains voient derrière cette belle intention une censure à peine déguisée dans un milieu déjà travaillé par la culture woke.
Madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture de notre beau pays, est-elle en train de devenir la mère fouettarde de la production audiovisuelle ? Satisfaire les canons des nouveaux conformismes est devenu le sommet de son art politique. Après s’être montrée menaçante sur les retraits de fréquence des chaînes de télé qui ne traverseraient pas dans ses clous, elle a décidé d’inculquer avec fermeté aux professionnels de la production les vertus de l’autodiscipline.
Désormais, toute société de production de fiction télé, cinéma et jeux vidéo est priée de se soumettre à un stage destiné à « prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles dans l’art et la culture ». Les espaces de travail et de tournage, lieux de perdition supposés, sont concernés.
L’étouffement par la subvention
Selon la brochure du Centre national du cinéma (CNC), l’organisme chargé par la ministre de l’application de cette