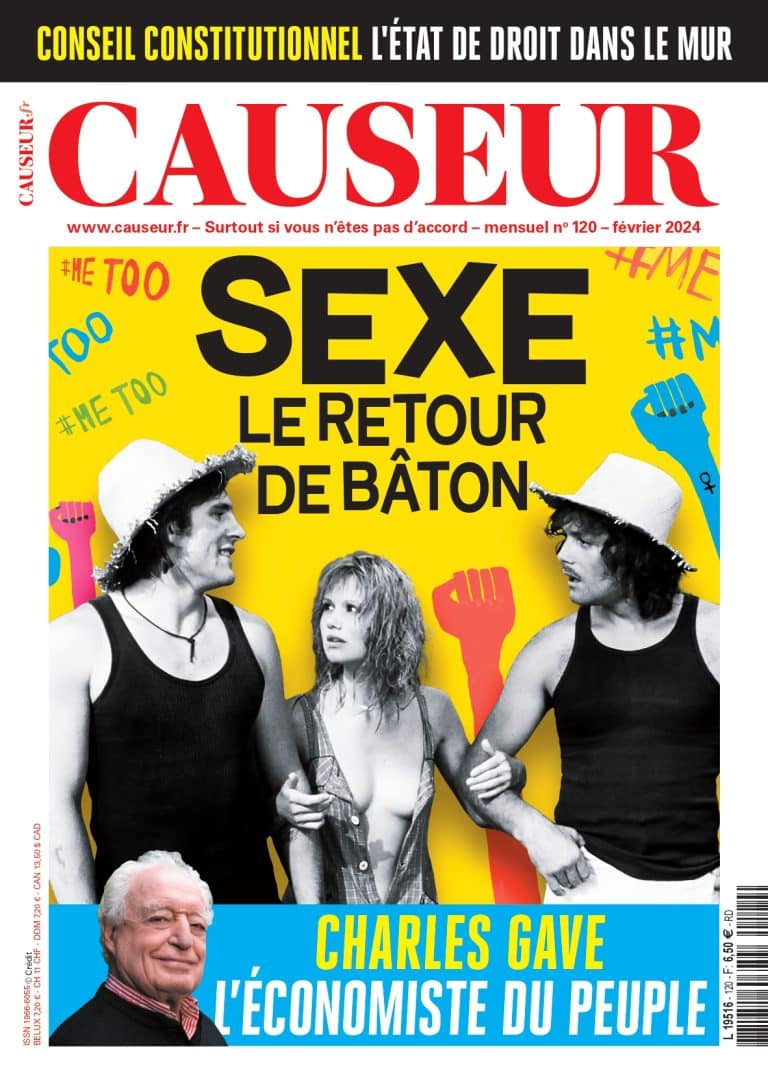L’exposition « Formes de la ruine », au musée des Beaux-Arts de Lyon, alimente une réflexion sur le témoignage de la trace, sur notre rapport aux vestiges. Cette réunion d’œuvres anciennes et contemporaines prouve que, de la Renaissance à nos jours, le regard que nous portons sur notre propre finitude ne cesse d’évoluer.
À l’heure de la ville « zéro déchet », de la plage « zéro poubelle », de la mer « zéro plastique », du véhicule « zéro émission », de l’architecture « durable », de l’homme « déconstruit » et de la « co-construction citoyenne », l’exposition Formes de la ruine au Musée des Beaux-Arts de Lyon nous invite à réfléchir sur la représentation des ruines dans l’art, sur les vestiges et les traces que nous laissons, celles dont nous héritons, et sur le sort que nous réservons à ces fragments déchus de l’architecture humaine qui supposent, dans le lien fluctuant qu’ils entretiennent avec la construction et la destruction, un certain rapport au temps, à l’histoire, aux autres et à soi.
Inspiré d’Une Histoire universelle des ruines d’Alain Schnapp
Variation inspirée de l’ouvrage de l’archéologue Alain Schnapp, Une Histoire universelle des ruines (2020), l’exposition lyonnaise nous emmène (un peu) à l’écart de l’obsession du tout-renouvelable-recyclable-rechargeable, en mettant les ruines à l’honneur. Restes de colonnades antiques, fantômes de villes ensevelies, édifices gothiques écroulés, bâtiments dévastés, immeubles bombardés, murs éboulés, les ruines (du latin ruere : « tomber en se désagrégeant ») ne sont pas les scories insignifiantes de nos talents de bâtisseurs. Les hommes, au fil des siècles, ont vu dans la disparition brutale (guerres, catastrophes naturelles) ou progressive (érosion du temps) de ce qu’ils édifient, des souvenirs à vénérer ou à haïr. Structurée autour de quatre thèmes, « Mémoire et Oubli », « Nature et Culture », « Matériel et Immatériel », « Présent et Futur », l’exposition montre que les ruines, à la croisée de l’espace, du temps et des sensibilités, ne sont jamais neutres : on peut y lire ce qu’elles disaient à l’époque où elles n’étaient pas encore des vestiges, et elles nous renvoient, dans leur évanouissement présent, à ce que nous sommes nous-mêmes devenus. Des tablettes mésopotamiennes couvertes de