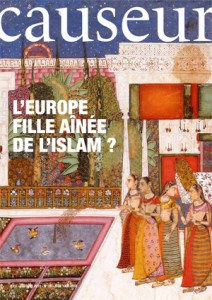Dans le village où, enfant, nous passions nos vacances de prince des villes revenu à la vie sauvage, il arrivait presque chaque été qu’un paysan tuât un cochon. Ce jour-là, l’animal ne quittait pas la porcherie. Il attendait l’événement, dans un état d’incompréhension et d’inquiétude mêlées. Enfin, il était sorti de force, puis hissé sur une table de planches improvisée. Six hommes solides le maintenaient et menaient l’affaire à son terme. Le boucher ambulant entaillait une grosse veine qui faisait relief dans la gorge du goret ; le gros bouillon de sang qui s’échappait de sa blessure emportait avec lui ses râles de protestation douloureuse. Le petit Parisien feignait d’être écœuré par le spectacle, mais n’en perdait rien. Son trouble se dissipait dans l’atmosphère de gaîté qui suivait immédiatement cette cérémonie sanglante, et pourtant admissible. Le porc était nécessaire à l’accomplissement de ces choses toujours recommencées et délicieuses : boudin, saucisson, jambon…[access capability= »lire_inedits »]
Il ne nous suffit pas de tuer les animaux, il faut aussi qu’ils souffrent, et qu’on les frappe, et qu’on les mutile, et qu’on les estropie. Nous ne nous satisfaisons pas de les exploiter et de les asservir : nous jouissons de les humilier et de voir dans leurs yeux l’effroi que nous leur inspirons. Nous les rouons de coups pour les diriger vers le lieu de leur supplice, où ils parviennent, souvent, les membres brisés. Comme ils ne peuvent plus seulement se mouvoir, nous les soulevons de terre à l’aide de palans, et c’est ainsi, suspendus, terrifiés, pantins calomniés, qu’ils se présentent au pistolet. Nous rions de leur lente agonie ; leurs postures grotesques, leurs mouvements saccadés, leur masque d’effarement, alors que la vie s’épuise en eux avec lenteur, augmentent encore notre joie mauvaise. Souvent, leurs spasmes interminables gonflent notre colère absurde, et quand ils sont morts, nous les agonissons d’injures.
Les caprices de notre machinale cruauté
En son temps, il n’y avait pas d’homme plus doux, plus attentionné que le prêtre oratorien Nicolas Malebranche (1638-1715), métaphysicien, philosophe « extasié de Descartes ». Or, un matin, il chassa un chien qui l’importunait d’un si violent coup de pied que les gens qui l’accompagnaient s’en étonnèrent. Et l’aimable penseur de rétorquer : « Eh ! Quoi ! Ne savez-vous pas bien que cela ne sent point ? ». Dans les abattoirs industriels comme dans les arènes, de quelque côté qu’il se tourne, l’animal se heurte à nos traditions, à nos croyances, à nos simples besoins qui l’accablent et lui réservent le pire des sorts. Il sert aux rites de la pensée magique, païenne, ou rationnelle. Il se conforme, bien malgré lui, au modèle cartésien de l’animal-machine, il satisfait aux caprices de notre machinale cruauté.
Afin d’assouvir plus honnêtement notre pulsion, nous enrôlons le divin. En l’invoquant, nous sollicitons le sens du symbole, qui masque nos mauvaises manières. Dans le rituel d’égorgement, nous prétendons que nos bas instincts sont gouvernés par un Dieu de colère inassouvi. Ainsi justifiés, nous reproduisons le rite par lequel se renouvelle, dans le sang, la tragédie qui nous hante depuis la nuit des temps. Chaque année, des centaines de milliers de moutons australiens, pour le plus grand profit de leurs éleveurs, traversent l’océan en direction des pays du Golfe. Ceux qui auront survécu à ce voyage cauchemardesque sont attendus avec impatience par les sacrificateurs.
Et nous, qui prétendons au Ciel, nous avons fait de la Terre l’Enfer des animaux, qui sont nos légions de damnés.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !