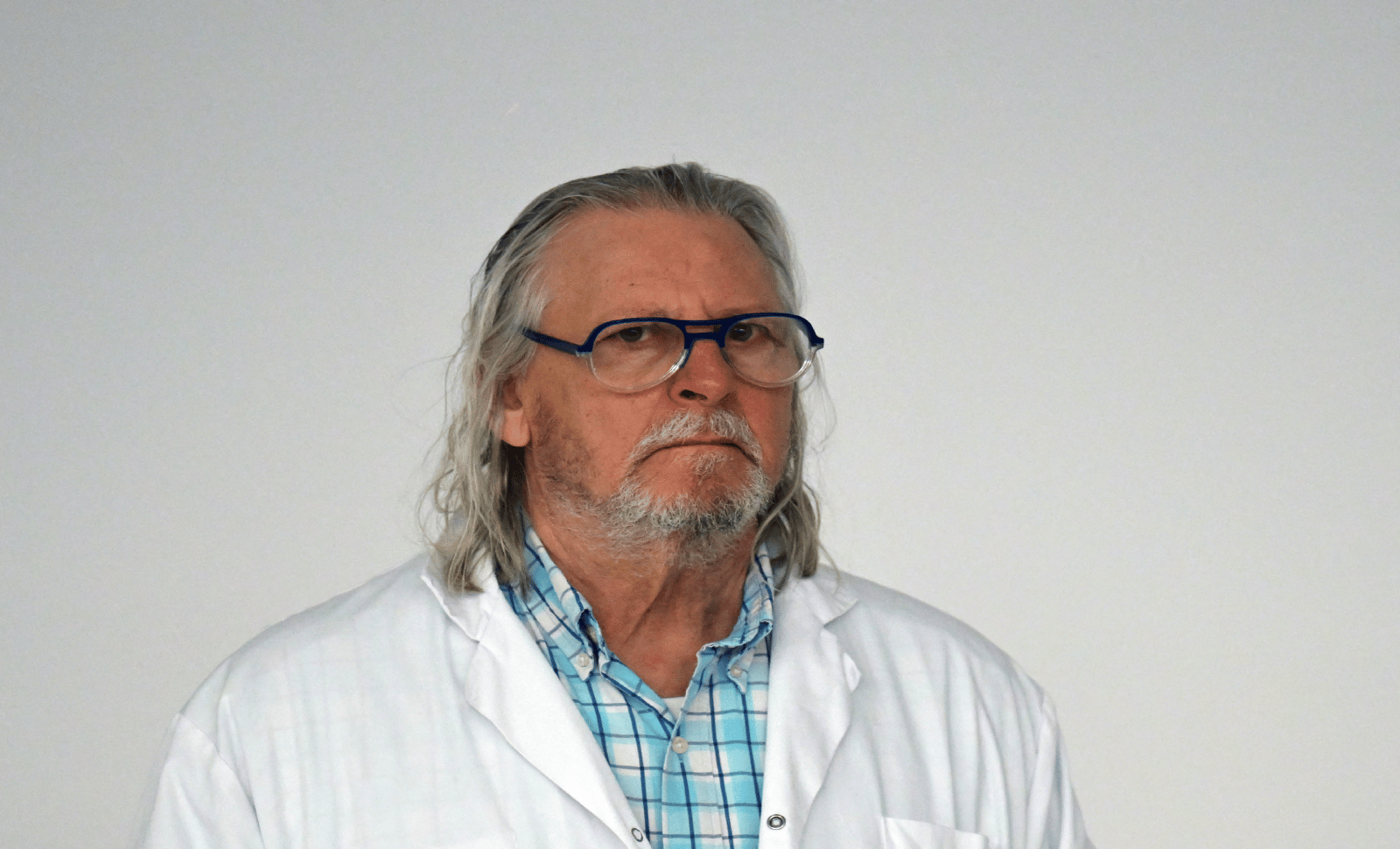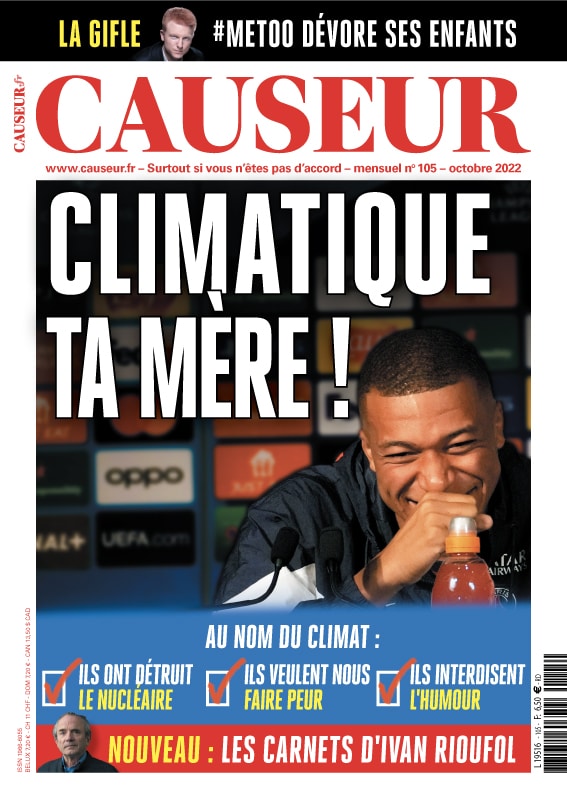La bonne santé n’est plus un privilège de riche. Dans les pays occidentaux, l’espérance de vie dégringole. Gestion technocratique de l’hôpital, hégémonie des lobbies pharmaceutiques, déshumanisation des soins sont autant d’erreurs stratégiques que notre système refuse d’admettre.
L’évolution de notre médecine prête à une réflexion approfondie. Jusqu’à un passé récent, l’amélioration de la qualité des soins et de l’espérance de vie étaient corrélées à l’augmentation du niveau de vie et des dépenses de santé. Depuis quelques années, ce n’est plus le cas. À partir d’un PIB de 20 000 dollars par tête d’habitant ou de dépenses annuelles de 10 000 dollars par habitant par an dans le domaine de la santé et de l’espérance de vie, il n’y a plus de corrélation claire entre les montants dépensés et la qualité des soins. Autrement dit, il ne sert à rien de dépenser de plus en plus d’argent. La question qui se pose est : comment utiliser au mieux l’argent consacré à la santé ? Chez nous comme dans beaucoup de pays d’Europe, les décisions ont consisté à diminuer le nombre de médecins. En France, nous sommes passés de près de 9 000 médecins formés par an dans les années 1970 à 3 500 par an dans les années 1990. La justification de ce choix était la nécessité de réduire les dépenses de santé. Or, elles n’ont fait qu’augmenter. Pas à cause de la croissance démographique, ni du vieillissement, mais parce que la France est l’un des pays riches où il y a le moins de médecins par habitant – un désert médical en dehors des villes et une population médicale vieillie, composée de baby-boomers. Heureusement, en dépit de cette situation née des décisions de technocrates, il y a toujours des gens pour se révolter. En effet, les étudiants qui veulent réellement étudier la médecine (et qui en ont les moyens) vont le faire dans d’autres pays d’Europe. Il y a, actuellement, 2 000 étudiants en médecine français en Roumanie, où on les forme en français. Il y en a au Portugal, en Belgique et ce phénomène va se développer, pour les médecins comme pour les autres métiers de santé dont l’effectif a été fixé artificiellement, sur la base d’une prédiction des besoins, qui comme la plupart des prédictions ne se réalise jamais.
Par ailleurs, la baisse du temps de travail, liée à la féminisation de la profession et à l’évolution générale de la société, a entraîné une réduction du temps moyen annuel de travail des médecins. Or, ces données n’ont pas été prises en compte par les modèles. De plus, cette diminution de temps médical disponible a été aggravée par l’accumulation des tâches administratives et réglementaires. En conséquence, pour les soins banals mais urgents,