L’agitation que connait la France n’est pas seulement la énième bataille des retraites, mais l’aboutissement d’un long délitement. Alors que le divorce semble consommé entre les Français et le pouvoir, le récit dominant dans les médias, c’est que tout est de la faute de Macron. En réalité, nous sommes tous responsables de l’état calamiteux du pays, les gouvernants qui ont vendu des illusions, et les gouvernés qui les ont achetées avec enthousiasme.
« Crise » est trop vague (même quand on y ajoute « de régime »), « agitation », trop faible, « révolution », inadapté (ou prématuré). En vérité, on ne sait à quel mot se vouer. Personne n’a trouvé la martingale sémantique qui raconterait le chaudron français. Peut-être parce que, comme l’a dit, je ne sais plus qui, l’histoire nous présente en même temps toutes les factures de quarante ans de choix collectifs calamiteux.
Doit-on parler pudiquement des « événements », comme en mai 1968 ou aux débuts de la guerre d’Algérie, de la « situation », comme des proches du président cités dans un quotidien ? Une chose est sûre, la France est une cocotte-minute, chacun semblant avoir un compte personnel à régler avec le pouvoir. Depuis deux mois, la contestation bat le pavé, des trains sont annulés, des classes fermées, des facs bloquées, y compris Assas et Paris-Dauphine qui a connu la première grève de son histoire. Les rues de la capitale (et d’autres cités), jonchées de montagnes de détritus, ont pris un air encore plus désolé que d’habitude. Les touristes ont fui nos villes transformées en territoires hostiles.
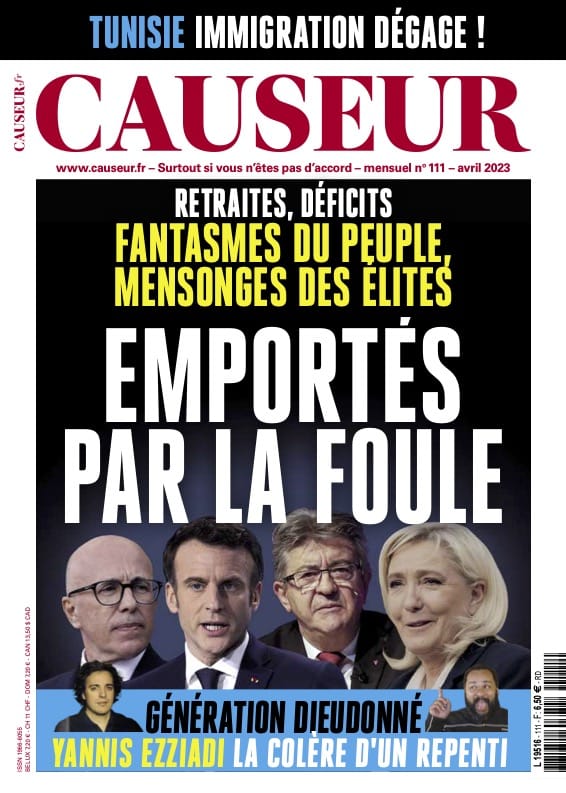
On a aussi découvert que les Français étaient très à cheval sur le rôle du Parlement. Soixante millions de constitutionnalistes pointilleux se sont étranglés de rage après l’annonce du recours au 49.3, érigé en symbole de la surdité du pouvoir et du débat confisqué – confiscation très théorique quand, depuis des semaines, nous ne parlons que de ça. Un rassemblement sauvage s’est invité place de la Concorde, à un jet de pavé de l’Assemblée nationale. Certains y ont vu un quasi-remake de février 1934, d’autres, une représentation de la décapitation du roi. À Paris et dans d’autres villes, des jeunes gens très à cran sur leurs vieux jours ont joué au chat et à la souris avec les







