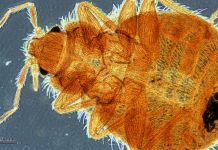Tout le monde, il est laid, tout le monde il n’est pas gentil
C’est le sujet qui anime actuellement la classe intellectuelle, l’enlaidissement de la France est-il une fatalité ? D’où vient cette déconstruction méthodique de nos paysages, désormais visible à l’œil nu en province et à Paris ? La « Fronde » gronde dans nos rues et même dans nos campagnes. Personne ne peut plus ignorer ou nier l’étendue des dégâts. L’immondice saute aux yeux ! Notre habitat est devenu morose et hostile, faussement moderne, atrocement futile, décadent par gabegie.
Zones commerciales tentaculaires à l’entrée des cités jadis de caractère, agriculture extensive à vocation planificatrice, artères dépavées et déplumées, arrachage systématique des arbres sur les boulevards et élargissement éhonté des pistes bétonnées, échangeurs qui donnent le tournis aux élus locaux et ronds-points qui enivrent les employés municipaux, le bâti cède sous la menace du toujours plus coûteux et du plus inhumain, du plus sordide et du plus impropre à la vision. Cette hygiène de l’assassin qui vise à démolir le fragile et le pittoresque, la grâce et l’harmonie, le patrimonial et l’agreste semble être la seule option politique admise et comprise par nos édiles. On détruit et on remplace par souci électoral et par paresse comptable. Le poète et philosophe italien Giacomo Leopardi (1798-1837) résumait dans une lettre adressée à Pietro Giordani tout le mal qu’il pensait de cet affaissement esthétique : « Je commence à être d’autant plus écœuré par le superbe mépris que l’on professe ici pour tout ce qui est beau et pour toute littérature, que je ne puis me faire à l’idée que le comble du savoir humain réside dans les sciences politiques et dans la statistique ». Et pendant ce temps-là, notre richesse intérieure, églises et demeures seigneuriales, constructions lacustres et paysannes, cabanes de pêcheurs et refuges d’alpage, bistrots canaille et édifices industriels, meurt à petit feu.
Pavillons climato-déficients du périurbain
On sait le combat perdu d’avance, que déjà l’accès au beau, à la plénitude de l’esprit, à un bord de Loire sauvage, de Pays Pagan ou de Balagne sont réservés à une population économiquement favorisée. Le bel espace, ce nouveau luxe, est en voie de privatisation pendant que le collectivisme architectural nous parque dans de l’éphémère et du ridicule. Que nous reste-t-il ? Les pavillons climato-déficients du péri-urbain et les barres funestes hors les murs, les hangars à tôle ondulée en pleine pampa beauceronne et les façades recouvertes de marques de luxe sur les rives de la Seine. Pour s’offrir un coin de paradis, loin des affres du consumérisme et des hordes touristiques, communier avec l’Histoire de notre nation et ses plus hauts personnages, profiter d’une douceur hexagonale et d’un environnement respectueux des saisons, il faudra dorénavant s’armer de patience et jouir de confortables ressources financières. Seule une poignée d’individus y parviendra. Les très riches et aussi les reclus de la ruralité qui, malgré un recul évident de leurs droits à travailler dignement, à se soigner sans exploser leur budget essence ou simplement à accéder aux mêmes services publics que les citadins bénéficient encore d’un décor relativement protégé. Jusqu’à quand ? Combien de campagnes ont été défigurées ces dernières années par la frénésie des promoteurs et l’empiètement vorace sur le vivant.
Pour l’extension du domaine de la beauté!
La révolution du « beau » aura-t-elle lieu ? À voir les dernières Victoires de la Musique, on peut en douter. Comment éduquer une population qui vit dans des logements défectueux et sous l’emprise d’une culture de masse ? Comment insuffler le désir de la conservation et le goût des mots ? Parce que le beau n’est pas seulement une aspiration à s’épanouir dans un milieu sain, c’est un apprentissage des sens, un travail quotidien pour savoir apprécier un beau geste, une belle langue, un élan souverain, une poésie affleurante ou un vitrail séculaire. C’est, par exemple, s’émouvoir du pâté en croute ris de veau, foie gras et morilles de la Maison Vérot, charcutier d’excellence depuis 1930, la régularité de ses strates colorées nous amène du côté de Fernand Léger pour la structure et d’André Hardellet pour le rendu vibrant. Le beau se niche partout pour celui qui sait regarder, lire ou écouter. Sur mes côteaux de Pouilly au printemps, à la pointe de Corsen en plein hiver, dans le revers de Richard Gasquet, dans le sourire de Koba (Marthe Keller), dans la lunette arrière inversée d’une Citroën Ami 6, dans une chanson de Michel Delpech, dans un pull Saint James ou dans une allée de la forêt de Tronçais. Militons tous pour l’extension du domaine du beau !
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !