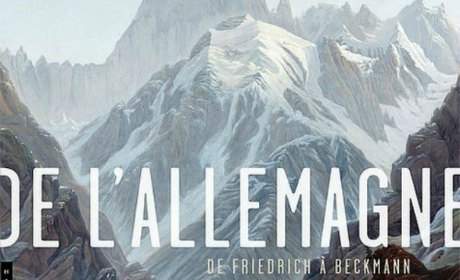 Quelle était l’intention de Danièle Cohn, de Sébastien Allard, et de Johannes Grave, lorsqu’ils ont décidé de réunir près de 200 oeuvres au musée du Louvre ? En tout cas, l’exposition dont ils sont les commissaires provoque des remous de chancellerie et de vifs émois de part et d’autre du Rhin. L’irritation, voire le début de scandale, peuvent sembler excessifs. C’est peut-être que cette animation outragée ne s’inscrit pas dans une controverse esthétique, mais résume l’état présent des relations entre la France et l’Allemagne.
Quelle était l’intention de Danièle Cohn, de Sébastien Allard, et de Johannes Grave, lorsqu’ils ont décidé de réunir près de 200 oeuvres au musée du Louvre ? En tout cas, l’exposition dont ils sont les commissaires provoque des remous de chancellerie et de vifs émois de part et d’autre du Rhin. L’irritation, voire le début de scandale, peuvent sembler excessifs. C’est peut-être que cette animation outragée ne s’inscrit pas dans une controverse esthétique, mais résume l’état présent des relations entre la France et l’Allemagne.
Étrangement, l’article publié par Philippe Dagen et Frédéric Lemaître dans Le Monde du 18 avril ignore le travail accompli naguère par des hommes remarquables : « Parrainée par Angela Merkel et François Hollande, l’exposition “De l’Allemagne, 1800-1939, de Friedrich à Beckmann” [a pour] dessein de montrer – enfin – au public français qu’il y avait des peintres allemands, contrairement à une idée répandue en France dans l’entre-deux-guerres, et pas encore tout à fait disparue. » Que signifie cet « enfin » ? Faut-il rappeler quatre dates, qui sont dans la tête de tous les amateurs d’art, de peinture et d’Allemagne ?
Ceux qui eurent la chance de visiter « La peinture allemande à l’époque du romantisme », en 1976-1977, à l’Orangerie des Tuileries, en ont gardé un souvenir impérissable, et sont reconnaissants à Werner Hofmann, mort le 13 mars, de l’avoir organisée, en compagnie de Michel Laclotte.
Compte-t-elle pour rien, cette autre exposition, intitulée « Symboles et réalités : la peinture allemande, 1848-1905 », qui se tint au Petit Palais (1984-1985) ? Et « Paris Berlin 1900-1933 », au Centre Pompidou, en 1978, qui fit courir tant de monde : on méprise, on ignore ? Enfin, faut-il absolument méconnaître, toujours au Centre Pompidou, « Les réalismes entre réaction et révolution, 1919-1939 », impeccable travail de recensement pluridisciplinaire, auquel notre ami Jean Clair prit une part très active (1980-1981) ? Pour la seule Allemagne, on ne recensait pas moins de 27 peintres…[access capability= »lire_inedits »]
En attendant, les esprits s’échauffent, et l’on voit de distingués spécialistes d’esthétique s’empailler presque aussi rudement que des socialistes français et des sociaux-démocrates allemands. Qu’on en juge : « Que l’exposition s’achève avec la césure de 1939 ne doit rien au hasard. L’horreur est inscrite dans l’art allemand depuis Goethe. » (Adam Soboczynski, Die Zeit, 4 avril) Rebecca Lamarche-Vadel, fille du regretté Bernard Lamarche-Vadel, n’est pas plus amène : « C’est cette suggestion d’une catastrophe allemande inévitable que semblent annoncer toute cette noirceur et ce romantisme, qui fait que le substrat politique de cette exposition est tellement irritant. » (FrankfurterAllgemeine Zeitung, 6 avril) Dans ce même quotidien, Niklas Maak accuse le Louvre d’avoir « bricolé » une histoire de l’Allemagne conforme aux « clichés du voisin romantique dangereusement sombre ». Le journal suisse de langue allemande, Tages Anzeiger, sous la plume de Linus Schöpfer, évoque le « béton » qui cimente les préjugés des Français !
Dans ce contexte tendu, l’ambassadrice d’Allemagne à Paris, Susanne Wasum-Rainer, intervient en personne – et diplomatiquement – dans Le Monde : « […] prêter [au Louvre] l’intention, dans un contexte de crise européenne, de mettre en lumière la “voie particulière” (voir plus loin) qui a conduit l’Allemagne à la politique d’extermination national-socialiste, c’est se méprendre sur la volonté, l’érudition et l’engagement de l’ensemble des acteurs impliqués dans ce projet. » Henri Loyrette, alors président-directeur du musée[1. Depuis, il a quitté ses fonctions. Son successeur est Jean-Luc Martinez.], s’emploie également à calmer les esprits :
« Cette longue période [a été choisie pour] proposer trois clés de lecture de l’art allemand pour un public français, sans aucune intention polémique : le rapport au passé, le rapport à la nature et le rapport à l’humain. Ce parti pris a […] pour visée d’éviter toute possibilité d’une lecture téléologique qui laisserait penser qu’il pourrait y avoir une éventuelle continuité du romantisme au nazisme. » (Die Zeit, 11 avril)
Beaucoup de bruit pour rien ? Pas tout à fait, pourtant. Si l’exposition du Louvre n’est pas coupable de tous les péchés dont on l’accable, elle n’en est pas moins problématique. Nous donnerons donc raison à Élisabeth Décultot, directrice de recherche au CNRS : « Cette lecture nationale, qui ignore totalement le polycentrisme allemand, doit être révisée.» Concernant l’Allemagne, il est toujours difficile de ne pas tomber dans le piège téléologique, explicitement dénoncé par Henry Loirette. Science de la finalité, la téléologie aboutit à une histoire écrite a posteriori, dans laquelle ce qui est arrivé devait nécessairement arriver (ce qui est le contraire du raisonnement historique).
Au terme du tour d’horizon proposé par le Louvre, les visiteurs les moins avertis concluront que l’art allemand a produit une puissante énergie nationaliste, grosse d’un péril mortel : le national-socialisme. On ne peut s’empêcher de penser à la thèse défendue par des historiens allemands après la Seconde Guerre mondiale : selon eux, le Sonderweg, voie originale, singulière de développement suivie par les Allemands au XIXe siècle, fut l’une des causes majeures de la pénétration des thèses nazies dans leur société. Du Sonderweg au national-socialisme, la pente était, en quelque sorte, « naturellement » glissante.
Or, sans accréditer le moins du monde cette grille de lecture, la conception, par moment maladroite, de l’exposition « De l’Allemagne » produit des rapprochements embarrassants. À ce sujet, pourquoi avoir choisi la date de 1939 comme borne temporelle, alors que l’oeuvre la plus « tardive », L’Enfer des oiseaux, saisissante allégorie de Max Beckmann, est de 1938 ? 1939 annonce très clairement la catastrophe prochaine, provoquée par le IIIe Reich, mais certainement pas par tous les artistes allemands des XIXe et XXe siècles ! Peut-on être plus explicite, moins chauvin, moins dangereusement nationaliste que Goethe, cosmopolite accompli, écrivant ceci : « Peut-être se persuadera- t-on prochainement qu’il n’existe aucun art patriotique, aucune science patriotique. Tous deux appartiennent, comme tout ce qui est bien, au monde entier. » On pourrait aujourd’hui interroger cette profession de foi qui, dans la louable ambition d’arracher l’art aux passions politiques, conduit à le priver de tout ancrage dans une culture nationale. Il est vrai que le vieux maître ne connaissait pas Jeff Koons[2. Jeff Koons, américain, né en 1955, gonfleur de lapin, fabricant d’objets très prisés des milliardaires. Aurait tort de se priver. Doit bien s’amuser.].
L’exposition, justement, s’ouvre sur le lumineux, majestueux portrait en pied de Johann Wolfgang von Goethe[3. Goethe dans la campagne romaine, 2,06 m x 1,64 m, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 1787.]. Le poète, vêtu d’un manteau blanc, semble perdu dans un songe, parmi des ruines de la Rome antique. L’oeuvre est bien choisie : Goethe invite ses compatriotes à « méditer l’exemple grec » et, pour ce qui le concerne, romain. Il va plus loin : il publie un Traité des couleurs, étude à la fois scientifique et poétique (planche illustrée à la plume et à l’encre noire, aquarelle et crayon).
Mais, très vite, un homme fait voler en éclats la belle organisation de Goethe : Caspar David Friedrich (1774-1840). Pour lui, la beauté n’est plus extérieure à l’artiste, elle gît en lui. Il accomplit l’effort d’aller la chercher. Les paysages de Friedrich sont « nationaux » en ceci : ils expriment la vision la plus secrète d’un Allemand qui ne consent pas à reproduire un souvenir culturel ni un modèle supérieur. Il laisse agir une puissance psychique, qu’il sollicite par une forme d’intrusion très intime. Le décor naturel qu’il crée n’est visible que par lui. Et Friedrich, explorateur des vertiges, recommande : « Clos ton oeil physique afin de voir d’abord ton tableau avec l’oeil de l’esprit. Ensuite, fais monter au jour ce que tu as vu dans ta nuit […]. » Les œuvres de Friedrich exposées au Louvre, leur splendeur intemporelle, leur dépouillement extrême, la combinaison de leurs éléments et de leurs formes, fondus comme dans un éblouissement, n’appartiennent pas seulement à la stricte figuration : elles relèvent, nous semble-t-il, d’une discipline métaphysique, dont on peut, sans céder à la tentation de l’essentialisme, repérer les différents avatars dans l’histoire allemande.
Au-delà de la polémique, reste l’essentiel : la beauté de ces tableaux et/ou l’immense intérêt de ce qu’ils nous apprennent. Quoi que l’on ait dit et écrit sur cette exposition, il faut donc s’y rendre d’un pas décidé. Balançant, ainsi que le soulignent ses concepteurs, entre Apollon et Dionysos, « De l’Allemagne » nous permet d’approcher l’imagerie sacrée, la candeur un peu sévère du groupe connu sous le nom de « Nazaréens » (Friedrich Overbeck, Franz Pforr). « Renaissants » anachroniques, ils se tournent vers le passé pour exprimer une protestation contre l’envahisseur français. Nous mesurons mieux l’importance de l’étonnant Philipp Otto Runge (Le Matin), nous aimons l’œil intelligent de Carl Gustav Carus (Haute Montagne, qui sert à composer l’affiche) et la vigueur d’Arnold Böcklin (suisse d’origine), capable d’illustrer l’effroi (La Guerre), et de montrer la concupiscence dans le regard d’un triton (Le Jeu des Néréïdes)…
On peut déplorer des maladresses dans la problématique choisie, regretter des manques, des oublis – pourquoi n’a-t-on pas mieux servi le Bauhaus, Die Brücke, Der Blaue Reiter, Dada, l’infortunée Anita Rée, la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit) ? On ne saurait pour autant se priver du spectacle de la beauté allemande.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !






