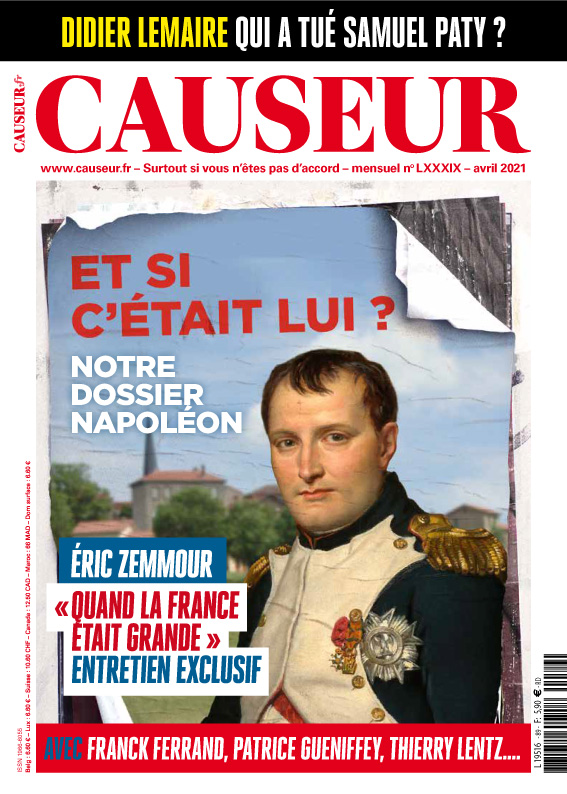Dans La Guerre des idées[tooltips content= » Robert Laffont, mars 2021″]1[/tooltips], la journaliste et essayiste Eugénie Bastié observe avec finesse le champ de bataille intellectuel français. De cette mêlée souvent médiocre émergent des gagnants – conservateurs, populistes, gauche radicale – et des perdants – libéraux et socio-démocrates. Malgré les sectarismes qui veulent interdire la contradiction, les idées retrouvent le pouvoir
Causeur. Vous revenez d’un long voyage au pays des idées. Qu’avez-vous appris, et peut-être d’abord sur vous ?
Eugénie Bastié. J’ai beaucoup appris sur moi-même. Et j’ai sans doute changé. Je suis sortie d’une dimension purement polémique pour me placer en position d’observatrice de la vie intellectuelle française. J’ai appris à mettre plus de côté mes convictions, ma vision du monde. J’ai compris à quel point le pluralisme est précieux, d’autant qu’aujourd’hui il est menacé. Pour interroger des gens qui ne partagent pas mes convictions, j’ai dû me mettre à leur place, tenter de comprendre leur généalogie intellectuelle ; ça m’a décentré de mes propres convictions et appris à faire place aux idées de l’autre. Cela m’a donné le goût de l’affrontement d’idées, au-dessus de la mêlée – moins dans le combat et plus dans le débat. Ainsi, j’ai redécouvert la pensée libérale à laquelle j’étais plutôt hostile. En somme, ça m’a rendu moins péremptoire.
S’interroger sur la vie intellectuelle des dernières décennies, c’est s’interroger sur une hégémonie. Pourquoi est-ce la gauche qui a toujours défini les termes du débat ?
Depuis la fin du XIXe siècle, il y a toujours eu plus d’intellectuels de gauche que de droite. À l’origine, le terme est employé par les écrivains de droite pour qualifier (et même pour disqualifier) les penseurs de gauche pendant l’affaire Dreyfus. Barrès l’utilise pour désigner des auteurs férus d’abstraction, éloignés de ce qu’on appelle aujourd’hui les préoccupations concrètes des gens. Raymond Boudon s’est interrogé dans une conférence sur la quasi-inexistence des intellectuels libéraux. Il y a plusieurs explications à cette surreprésentation de la gauche chez les intellectuels : à gauche, on veut changer le monde, donc on tourne davantage vers l’idéologie et l’abstraction ; il y a aussi une raison sociologique d’après Robert Nozick : les universitaires dépendants de l’État ne vont pas le critiquer, alors qu’ils sont naturellement hostiles au marché, qui ne les récompense pas.
À lire aussi : Eugénie Bastié: “Entre l’orgie et la pénitence, je ne sais pas ce qui triomphera après l’épidémie”
En réalité, la gauche, ayant renoncé à changer le monde, est devenue le camp du Bien autour des années 1980. Et cette supériorité morale ne lui est même pas contestée par la droite.
Oui, ça continue aujourd’hui. Dans son dernier livre, Élisabeth Roudinesco traite Paul Yonnet de fasciste alors que dans les années 1990, il disait