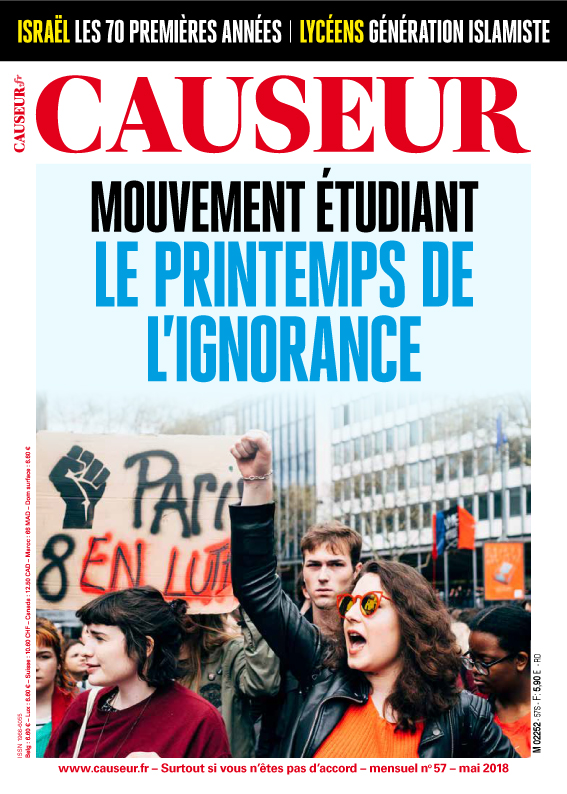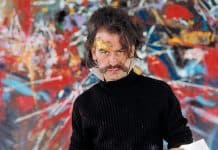Le Louvre propose jusqu’au 23 juillet une grande rétrospective Eugène Delacroix (1798-1863). Si on connaît l’auteur de La Liberté guidant le peuple, on ignore souvent le rôle décisif qu’a joué cet admirateur de Véronèse et de Rubens pour sortir la peinture de l’ennui néoclassique.
De nos jours, quand on veut attirer la sympathie sur un artiste, on affirme qu’il est révolutionnaire. En ce qui concerne Delacroix, pour une fois, c’est parfaitement vrai. Cet artiste conjugue même les deux acceptions du mot « révolution » : celle d’un retour sur le passé, à la façon d’une planète parcourant de nouveau son orbite et celle, plus courante, d’un dépassement radical du présent. Delacroix, en se réappropriant des traditions picturales perdues, ouvre de nouvelles perspectives. Sur un plan politique, il n’a pourtant rien d’un révolutionnaire.
La peinture française du début du XIXe siècle offre, il faut bien le dire, un paysage assez morne. Certes, la production de grandes toiles n’a jamais été aussi abondante. Cependant, la pompe des sujets rivalise avec la platitude de l’exécution. On célèbre les vertus romaines en format XXL. On enchaîne les sacres et les scènes de bataille. Ce mouvement, qui se veut classique, est connu sous le nom de « néoclassicisme ». Toutefois, Delacroix lui dénie la qualification (positive à l’époque) de classique. La facture besogneuse, léchée et souvent gauche qui s’y pratique révèle plutôt l’abandon des héritages. À peu de choses près, le néoclassicisme est à la Révolution et à l’Empire ce que le réalisme socialiste est aux régimes communistes.
La France si peu romantique à l’heure du romantisme
Ailleurs, en Europe, c’est assez différent. Certes, le néoclassicisme se déploie partout. Cependant, on voit fleurir ici et là des artistes originaux qui produisent des œuvres singulières pour des amateurs privés. Citons Friedrich, Runge, Abildgaard, Dahl, Wolf, Goya, Blake, Palmer, Füssli, Cozens, Constable, Turner, etc. La spécificité négative de la France tient sans doute à la conjonction de plusieurs phénomènes : la disparition ou la ruine des anciens amateurs, la présence d’une administration des beaux-arts particulièrement centralisée, à l’instar de celle de l’État, la succession de régimes politiques enrôlant l’art au service d’un récit officiel et, enfin, l’influence des Lumières qui, avec des commentateurs comme Diderot, ont poussé la peinture vers l’expression