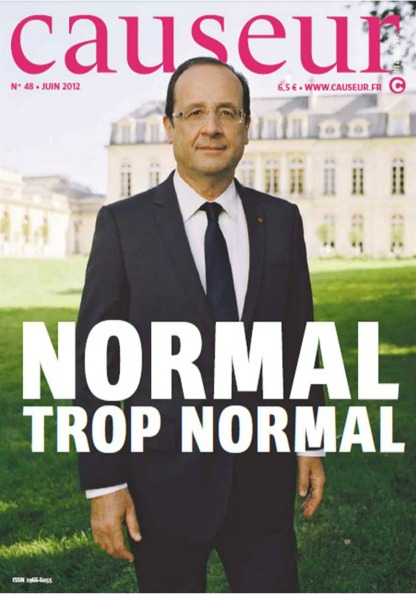L’Europe a joué à se faire peur. Après tant de bruit et de frayeurs, les Grecs ont fini par voter pour ceux-là mêmes qui avaient négocié le mémorandum, ce fameux accord signé en novembre 2011 entre Athènes et ses créanciers, infligeant au pays une cure d’austérité drastique. Avec 128 sièges sur les 300 que compte le Parlement grec, Antonio Samaras, chef de Nouvelle Démocratie (droite modérée), pourrait former une coalition avec les sociaux-démocrates du Pasok, dont les 33 députés constitueront l’appoint nécessaire à la formation d’une majorité stable. Dans ces conditions, les soupirs de soulagement poussés aux quatre coins de la zone euro sont quelque peu excessifs : contrairement à ce que suggérait la tonalité dramatique des commentaires médiatiques et des déclarations politiques depuis l’élection, le 6 mai, d’un Parlement pris en otage par les extrêmes, nous n’avons pas assisté à une tragédie mais à une comédie, dont l’enjeu ne fut jamais l’annulation de l’accord entre Athènes et ses créanciers, et encore moins la sortie de la zone euro, mais une renégociation à la marge du fameux mémorandum.[access capability= »lire_inedits »]
Autrement dit, les dirigeants grecs ont exercé un chantage implicite sur les bailleurs de fonds en laissant entendre que, si ceux-ci ne desserraient pas un peu l’étau, ce n’est pas à des gens raisonnables qu’ils auraient affaire, mais à des fachos échevelés ou à des gauchos exaltés. Il semble que les électeurs aient compris ce qui se tramait. En tout cas, ce qui était hier impensable est aujourd’hui sur la table : les Grecs seront vraisemblablement récompensés de leur « bon vote » par un rabais sur les exigences européennes. Qui a dit que la démocratie n’avait pas de prix ?
Les dirigeants grecs ont donc habilement fait monter la mayonnaise, dramatisant la crise politique provoquée par le premier scrutin, à la fois pour faire avaler aux électeurs leur adhésion au mémorandum et pour obliger les créanciers de la Grèce et ses partenaires européens à lâcher un peu de lest. Les victimes collatérales de cette pièce de théâtre sont les citoyens naïfs qui ont cru à l’existence d’une véritable alternative, qu’on leur faisait miroiter aussi bien à l’extrême droite qu’à l’extrême gauche – encore que, de ce côté, il suffisait de tendre l’oreille pour percevoir les signes annonciateurs d’une relative modération : Alexis Tsipras était visiblement prêt à mettre de l’eau dans son ouzo, ce qui éloignait le danger d’une crise incontrôlable. Et tout le monde le savait, au moins dans les coulisses.
L’accord signé fin 2011 entre le gouvernement grec d’un côté, l’Europe, la Banque mondiale et le FMI de l’autre a été le fruit d’un compromis reflétant les rapports de force – et n’en déplaise à tous ceux qui croient que les relations internationales sont régies par les grands sentiments, on voit mal comment il aurait pu en être autrement. Pendant toute la durée des négociations, la délégation grecque a martelé un seul message : ne tirez pas trop sur la corde ! L’argument était un peu court pour des créanciers convaincus, non sans quelques raisons, que les Grecs sont largement responsables du piteux état de leur économie, bien au-delà des problèmes générés par l’évasion fiscale et les fraudes à la Sécurité sociale. Rappelons que ce pays agricole importe 80 % de sa viande, contre 20 % il y a vingt ans ; et qu’au début du XXIe siècle, beaucoup de petites entreprises, souvent familiales, ne possèdent même pas d’ordinateur.
Dans ces conditions, on peut comprendre que Georges Papandréou, alors premier ministre, ait fini par signer. Mais dès son retour à Athènes, il a compris que, pour son opinion publique, il avait beaucoup trop cédé. La seule solution, pour imposer une renégociation de l’accord, était de modifier les rapports de force qui avaient présidé à sa conclusion, autrement dit de transformer l’extrême faiblesse grecque en force en laissant planer la menace d’une faillite grecque, prélude à un éventuel effondrement de la zone euro.
C’est ainsi que Papandréou a joué un coup de poker en proposant un référendum sur le mémorandum, suscitant, à Berlin et à Paris, un embarras compréhensible : si Sarkozy et Merkel n’avaient pas la moindre envie de voir les électeurs grecs ramener leur fraise et mettre à mal un accord durement obtenu, ils pouvaient difficilement afficher leur hostilité à une procédure si démocratique. Papandréou pensait que la menace d’un vote citoyen suffirait à obliger l’Allemagne et la France à desserrer encore un peu les cordons de la bourse. Il en a été pour ses frais, le président français préférant passer pour un ennemi des peuples plutôt que de se faire rouler dans la farine. C’était partie remise. Comme s’ils avaient, collectivement et inconsciemment, compris la partie qui se jouait, les électeurs grecs réalisèrent, le 6 mai, le pire cauchemar des Européens en élisant un Parlement qui, non seulement ne pouvait pas former une majorité, mais était de surcroît dominé par deux épouvantails : la coalition de gauche radicale Syriza d’Alexis Tsipras, et Aube dorée, le parti néonazi de Nikolaos Michaloliakos. Les six semaines écoulées entre ces élections « ratées » et le rendez-vous électoral du 17 juin auront été le dernier acte de ce poker menteur. On a eu droit à toutes sortes de scénarii catastrophes, à des fuites annonçant que tel État ou telle institution internationale préparait l’explosion de la monnaie unique et/ou à une sortie hellène de la zone euro, à des bruits récurrents sur une ruée sur les banques annonciatrice d’une issue « à l’argentine ». Bref, malgré la fraîcheur de ce faux printemps, la crise grecque a fait transpirer beaucoup de monde.
Dès que le résultat du scrutin a été connu, Guido Westerwelle, le ministre allemand des Affaires étrangères, a clairement énoncé les limites à ne pas franchir : si certaines concessions sont envisageables, notamment sur le calendrier, une renégociation complète du mémorandum est exclue. Son homologue belge, Didier Reynders, a confirmé que, si la nouvelle majorité était prête à mener les réformes nécessaires pour maintenir la Grèce au sein de la zone euro, l’UE et le FMI pourraient lui accorder un peu plus de temps – et peut-être un peu plus de moyens – pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.
Cette issue, qui permettra d’adoucir légèrement la purge imposée aux Grecs, devrait les satisfaire, 80 % d’entre eux souhaitant le maintien dans l’euro et dans l’Europe, pourtant accusés hier de tous leurs malheurs. À charge pour les deux partis de gouvernement, la Nouvelle Démocratie et le Pasok, de marchander au mieux des intérêts du pays. Quant à Syriza, il reste sans doute de gauche, mais mérite de moins en moins l’adjectif « radical ». Seuls les néonazis, dont le chef est réellement stupide, restent à l’écart de ce consensus national, ce qui les privera sans doute des fruits de leur activisme social – et c’est tant mieux.
N’étaient-ce les difficultés endurées par les Grecs les plus pauvres, on pourrait presque dire que cette crise s’achève sur un happy end. Des deux côtés : pour l’UE et le FMI, quitte à étaler le paiement de la dette, l’important est que les Grecs reconnaissent la logique du mémorandum et en assument collectivement la responsabilité. Le temps où les citoyens se défaussaient de leurs responsabilités sur les « élites » et les « politiques corrompus » est révolu. Après avoir exprimé leur colère contre des puissances tutélaires jugées arrogantes lors du vote du 6 mai, et sauvé l’honneur en obtenant de ces dernières des concessions mineures mais non négligeables, ils peuvent s’attaquer aux racines culturelles et anthropologiques de leur naufrage pour transformer leur État clientéliste et archaïque en État moderne garant de l’intérêt général.
Dans les années 1960, quand les États-Unis étaient empêtrés dans la guerre du Vietnam, le sénateur républicain George Aiken avait lancé : « Déclarons que nous avons gagné et partons ! » Aujourd’hui, les Grecs doivent prendre ce que l’Europe leur donne. À elle de leur donner suffisamment pour qu’ils puissent déclarer qu’ils ont gagné. Et se mettre au boulot.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !