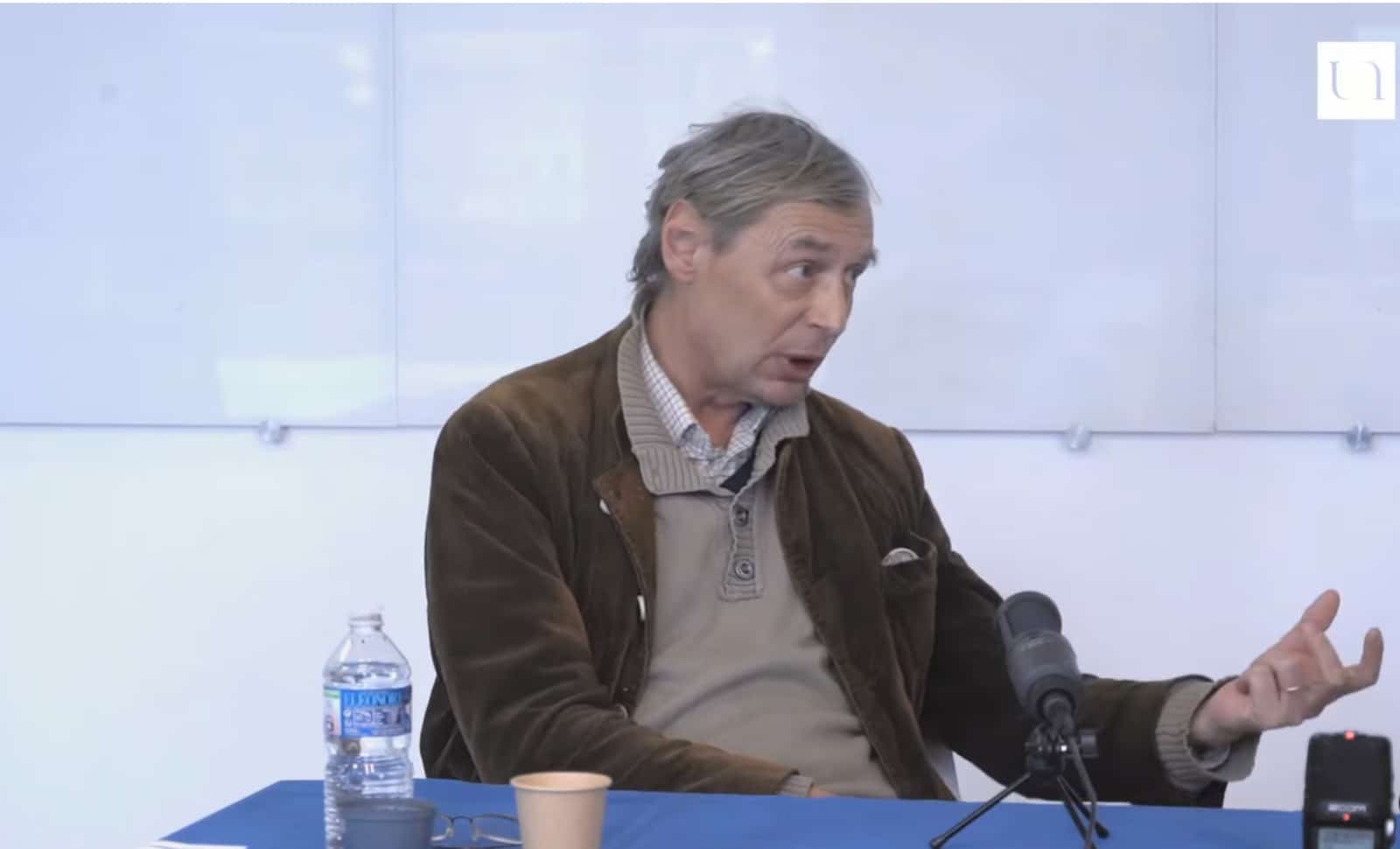Aristocrate et historien, Emmanuel de Waresquiel se fait romancier pour son autobiographie.
Enfant, Emmanuel de Waresquiel aimait « déjà les cartes et les atlas ». Des outils bien utiles en voyage, sauf à partir au plus près de soi-même comme le fait l’historien dans son dernier ouvrage, Voyage autour de mon enfance. Sur 150 pages, Waresquiel raconte ses plus anciens souvenirs. Badin d’apparence, l’exercice est ici difficile : l’auteur est surtout connu comme historien – de la Restauration et de la Révolution – et biographe – de Talleyrand et de Fouché. S’il est lecteur de Mémoires, elles lui servaient plutôt à écrire la vie des autres, car cet aristocrate répugne à parler de lui-même : « Je suis d’une génération qui répugne à trop parler d’elle-même, par éducation, par discrétion, par pudeur »
Il faudra pourtant bien se forcer car Warequiel a des choses à nous dire. De bonne souche – sa lignée remonte à Mme de Staël – l’enfant a grandi dans un château de Mayenne. Il a l’histoire à portée de balcon : la vue donne sur le lieu de bataille qui inaugure les Chouans de Balzac. Dernier témoin des mœurs féodales, Emmanuel de Waresquiel raconte avec simplicité l’extravagance de sa condition : « nous n’étions jamais seuls. On a du mal à imaginer cela aujourd’hui. » Pour entretenir le mobilier ou meubler le quotidien, la famille a depuis longtemps embauché du personnel. Une cuisinière, un jardinier, un fruiter même. Un monsieur Lelièvre – ça ne s’invente pas – à la basse-cour. Les domestiques sont pétris de pittoresques dans « un monde feutré et rassurant plein de rites et d’habitudes où rien ne changeait jamais que les saisons ». Pas de chats de gouttière ni de chiens bâtards, les animaux sont racés : un scottish terrier, un berger belge… la mère les nourrit au pâté, au pot-au-feu de paleron de bœuf et « à des décoctions de lait, de sucre et d’œufs lorsqu’ils étaient malades ». « Tous ces chiens vivent intensément dans mes souvenirs » comme les familiers, comme les meubles de famille, comme le bruit et l’odeur de la campagne. Dans cette belle litanie d’objets, de souvenirs, de sensations ou de saveurs… toute chose a un peu l’odeur de l’Histoire.
À lire aussi : Un été à Miradour : chronique familiale
Les objets sont depuis longtemps un thème littéraire. Déjà dans Madame Bovary avec la petite bourgeoisie du XIXe ou Les Choses de Perec avec la classe moyenne des années 1960, les hommes sont définis par ce qu’ils possèdent. Au regard de ses choses et de son bien, l’univers mental de la famille Waresquiel semble très caractéristique : « Toute la maison sentait l’Angleterre (…) Une Angleterre toute victorienne pétrie de sayings, de chasses au renard, de chiens et de chevaux. Le couloir du premier étage était couvert de gravures de Lionel Edwards, l’illustrateur de Country Life entre les deux guerres, que ma mère aimait et qui me faisait rêver : le long ruban des chiens et des chevaux dans des amphithéâtres de collines vertes, des équipages en vestes rouges, le punch servi à cheval sur des plateaux d’argent dans les cours des fermes pluvieuses. » Situation sociale et géographique, l’Anglomanie de la famille d’Emmanuel Waresquiel est depuis le XVIIIe un caractère de l’aristocratie libérale et cultivée à laquelle il appartient et dont les usages semblent avoir été maintenues jusqu’à aujourd’hui – comme si seules les formes les plus folkloriques de noblesse devaient survivre à l’effacement du milieu social dans son entier.
Ces usages familiaux sont une manière d’être que Waresquiel exprime dans son écriture, laquelle peut être flegmatique devant des évènements graves, ou exhaustive quand elle décrit ces fastes : « Je sentais bien que cette maison de Viry était différente de la mienne. Elle avait été construite bien avant la Révolution. Les pièces d’en bas étaient lambrissées, parfois peintes en rose et en vert (…) tout y était gai et exotique. » L’enfant appelé à devenir historien avait déjà des « pressentiments » – une intelligence analytique, une sensibilité à l’art, une aisance en société. Il respirait l’histoire à pleins poumons en même temps que le bon air mayennais et son odeur matinale du purin. Dans ses souvenirs, il convoque Proust, Fellini, Alfred Sisley… et finalement toutes les muses de tous les arts.
En préambule, l’auteur annonçait une sorte de pacte autobiographique lequel implique d’« écrire à billebaude ». C’est-à-dire d’écrire au risque de l’inexactitude avec des souvenirs d’enfant, éparses et brumeux ; fidèlement et simplement. Et surtout en toute sincérité. Une sorte de promesse littéraire faite au lecteur la main sur le cœur de dire toute la vérité – laquelle exclut de « faire du roman » à partir de ses souvenirs. Une composition littéraire apparait pourtant au fil des pages avec une forme qui lui est propre. Tout chapitre s’amorce par des souvenirs bruts et infantiles toujours relevés d’anecdotes au ton proustien plaçant sa vie en parallèle de l’histoire de France.
On voit aussi le personnage – volontiers romanesque – au travers des confessions de l’auteur, reflet de l’image plutôt réussie qu’Emmanuel de Waresquiel entend laisser de lui-même et de la France dont il est issu. Une France fidèle aux usages mais volontiers extravagante, british et gauloise, ferme et tendre, rustique et cultivée. Derrière le projet esthétique, on entrevoit aussi une argumentation et quelques idées fortes. À savoir que l’homme est d’abord un animal historique. Nous venons tous du fond des âges. Notre conduite est orientée – peut-être déterminée – par la mémoire de notre enfance, de notre famille, de notre milieu ou de notre lignée. Avec ce « voyage autour de mon enfance », on retrouve le biographe, on reconnait l’historien tout en découvrant le mémorialiste. Et peut-être, aperçoit-on déjà le romancier.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !