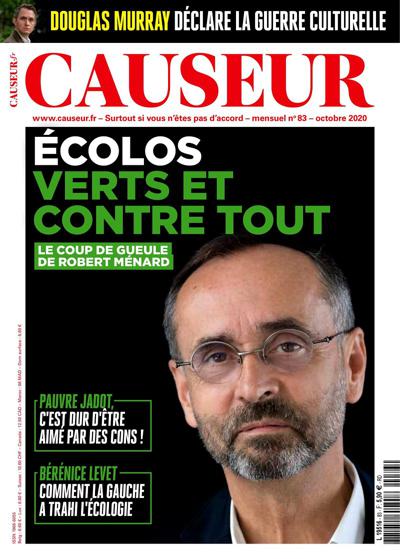Pour l’auteur de Juger la Reine, tout s’est joué entre le 17 et le 23 juin 1789 : la fin de mille ans de monarchie et l’avenir de la France. Restituant, grâce à des sources très variées, l’atmosphère de ces journées, l’historien explore trois évènements fondateurs de tout ce qui suivra, de la Déclaration des droits de l’homme à la Terreur en passant par tous les avatars ultérieurs de la longue guerre civile française. Repondant à François Furet, il affirme que la Révolution n’est pas terminée.
Élisabeth Levy. Votre livre[tooltips content= »Sept jours – 17-23 juin, la France entre en Révolution, Tallandier, octobre 2020″](1)[/tooltips] se concentre sur la semaine du 17 au 23 juin 1789. Pourquoi l’histoire populaire retient-elle de tout autres dates ?
Emmanuel de Waresquiel. Parce qu’en France, on a toujours été plus attaché aux symboles qu’aux réalités qui se cachent derrière eux. La Bastille est très vite devenue le symbole de l’insurrection populaire et de la prise du pouvoir par le peuple, donc un acte fondateur. En réalité, elle n’a jamais été « prise », elle s’est rendue. Le peuple ne l’a pas plus attaquée parce qu’elle était « l’antre du despotisme », mais parce qu’il s’y trouvait de la poudre. Le roi et son gouvernement étaient déjà nus le 14 juillet 1789. Les choses se sont jouées avant, en juin, avec trois événements liés entre eux et qui contiennent en eux-mêmes toute la Révolution et tout ce qu’elle deviendra par la suite, jusqu’à la guerre civile et la Terreur de 1793. Reste qu’en une semaine, tout est accompli, la révolution politique, mais aussi la révolution sociale.
Commençons par le 17 juin : les députés du tiers état se constituent en Assemblée nationale indivisible en adoptant la motion de Sieyès. En quoi s’oppose-t-elle à celle de Mirabeau ?
Mirabeau propose de faire des députés les représentants du « peuple français ». Dans son esprit et dans celui de nombreux députés du tiers état, le peuple n’est pas la nation. Il n’en représente que la part la moins éclairée. Il est un allié nécessaire, mais un allié dangereux. Quoi qu’il en soit, Mirabeau préserve ainsi ceux qui restent : les représentants de la noblesse et du clergé, et tout autant le roi. Toutes les déclarations de Louis XVI, depuis son avènement au trône en 1774 et jusque sous la Révolution, qu’il n’a par ailleurs jamais comprise, tournent autour de cette même idée : « Je ne fais qu’un avec la nation. » En se déclarant unilatéralement les représentants de la nation, les députés séparent le roi de cette dernière et le privent du même coup de sa sa légitimité. En quelques jours et après mille ans de droit divin et d’incarnation monarchique, la souveraineté change brutalement de camp. C’est cela la « table rase » évoquée par François Furet. De plus, le même jour, ils placent la dette publique sous la protection et l’honneur de la nation, privant le roi du plus important de ses pouvoirs régaliens, celui de lever l’impôt.
Les Français évoquent la raison et pourtant, ils sont habités par leurs désirs, leurs fantasmes
On se heurte immédiatement à un paradoxe français. L’aspiration à l’« indivisibilité » se conjugue avec une conflictualité permanente.
On peut dire que la guerre civile française a commencé à l’instant où les députés du tiers état se sont constitués en Assemblée nationale, non pas par un contrat passé avec le roi et les deux autres ordres, mais contre eux. En se proclamant seuls représentants de la nation et en déclarant cette dernière « indivisible », ils renvoient les deux autres ordres du royaume à l’inexistence politique et sociale, à leur « inutilité ». « Mauvais citoyens », « privilégiés », « ennemis », « traîtres », « complot » : on trouve déjà dans les discours de juin 1789 les mots de la Terreur. Toute l’habileté des députés du tiers état est d’avoir fait croire à l’opinion que les exemptions et privilèges fiscaux ne touchaient que les nobles et le clergé, soit un peu moins de 500 000 personnes sur une population de 26 millions d’habitants, comme s’ils ne bénéficiaient pas aussi de ces derniers : pays d’État, corps de ville, corporations, etc. Le décret du 17 juin est un décret de combat.
Trois jours plus tard, le 20 juin, trouvant porte close, les mêmes députés du tiers se rendent au Jeu de paume tout proche et jurent de ne se séparer que lorsqu’ils auront donné une constitution à la France.
Les députés du tiers s’étaient déclarés Assemblée nationale