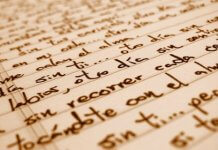La fondation Beyeler propose jusqu’au 26 juillet une importante exposition Edward Hopper, consacrée principalement à ses paysages. Cet artiste a échappé au déclassement et à l’oubli qui a marqué la plupart des artistes figuratifs américains de la première moitié du XXe siècle. Une belle occasion d’entrer dans son univers si singulier et, à travers lui, d’entrouvrir les portes d’une période particulièrement riche de l’art américain.
Un cas de réfutation de l’historiographie ordinaire
Les historiens de l’art commencent à parler de Hopper, souvent on les sent en difficulté.
Ils ont du mal à raccrocher cet artiste au récit qui tient habituellement lieu d’histoire de l’art du XXe siècle. Les uns vont chercher à son crédit qu’il aurait été apprécié par certains expressionnistes abstraits comme Motherwell. Le critique d’art Philippe Dagen explique avec le plus grand sérieux (lors d’une précédente exposition) que : « Hopper, à son insu, annonce la rigueur ultramoderne du minimalisme new-yorkais ». Beaucoup se résignent à considérer Hopper juste comme un électron libre, une exception qui confirme la règle. Enfin, Claire Maingon, de Beaux-arts magazine, voit tout simplement en lui un homme « à contre-courant ». Tout ceci est totalement absurde. En réalité, Hopper est tout sauf isolé. Il appartient à une histoire extraordinairement riche, mais que tout le monde ignore superbement, celle de l’illustration et de la peinture figurative américaines de la première moitié du XXe siècle.
À l’école de la poubelle
Edward Hopper naît en 1882 dans une famille de commerçants baptistes qui encouragent ses aspirations artistiques. Il grandit à Nyack, au nord de New York, au bord de la Hudson river. Cette région est fréquentée tout au long du XIXe siècle par des peintres de paysage regroupés sous le nom de Hudson river school (voir encadré plus bas). Ils popularisent une conception mystique des grands espaces. Dieu et la nature forment à leurs yeux un tout indissociable qui pourrait évoquer Spinoza, mais qui dérive plus directement de l’esthétique du sublime de Burke (connu en France pour sa critique de la Révolution). L’Hudson river school constitue le socle de la tradition américaine et de la culture de Hopper.
Il fait des études d’art à New York et rencontre, soit comme professeurs, soit comme élèves, des artistes de l’Ash Can School (littéralement école de la poubelle). On peut dire que, depuis les caravagesques, peu de peintres représentent avec autant de verve et de crudité la vie réelle des humains. Hopper et son ami Guy de Penne, tout en faisant partie du groupe, s’en distinguent par une sensibilité plus contemplative.

Lighthouse Hill, 1927
Huile sur toile, 73.8 x 102.2 cm
Dallas Museum of Art, don de Mr et Mme Maurice Purnell
© Heirs of Josephine Hopper / 2019, ProLitteris, Zurich
Photo : Dallas Museum of Art, Photo by Brad Flowers

Cobb’s Barns and Distant Houses, 1930–1933
Huile sur toile, 74 x 109.5 cm
Whitney Museum of American Art, New York, legs de Josephine N. Hopper
© Heirs of Josephine Hopper / 2019, ProLitteris, Zurich
Photo : © 2019. Digital image Whitney Museum of American Art / Licensed by Scala
Après ses études new-yorkaises, Hopper voyage en Europe à plusieurs reprises, et tout spécialement à Paris qui fait figure à cette époque de métropole des arts. On vient y rechercher l’enseignement de maîtres considérés aujourd’hui un peu vite comme académiques au sens péjoratif, tels que Bouguereau, Carolus-Duran, Benjamin-Constant, etc. Des institutions privées, comme l’Académie Julian, suppléent l’accès restreint de l’École des beaux-arts et forment de nombreux étrangers. Hooper fait de longs séjours à Paris. Il est fasciné par cette ville. Il est ardemment francophile