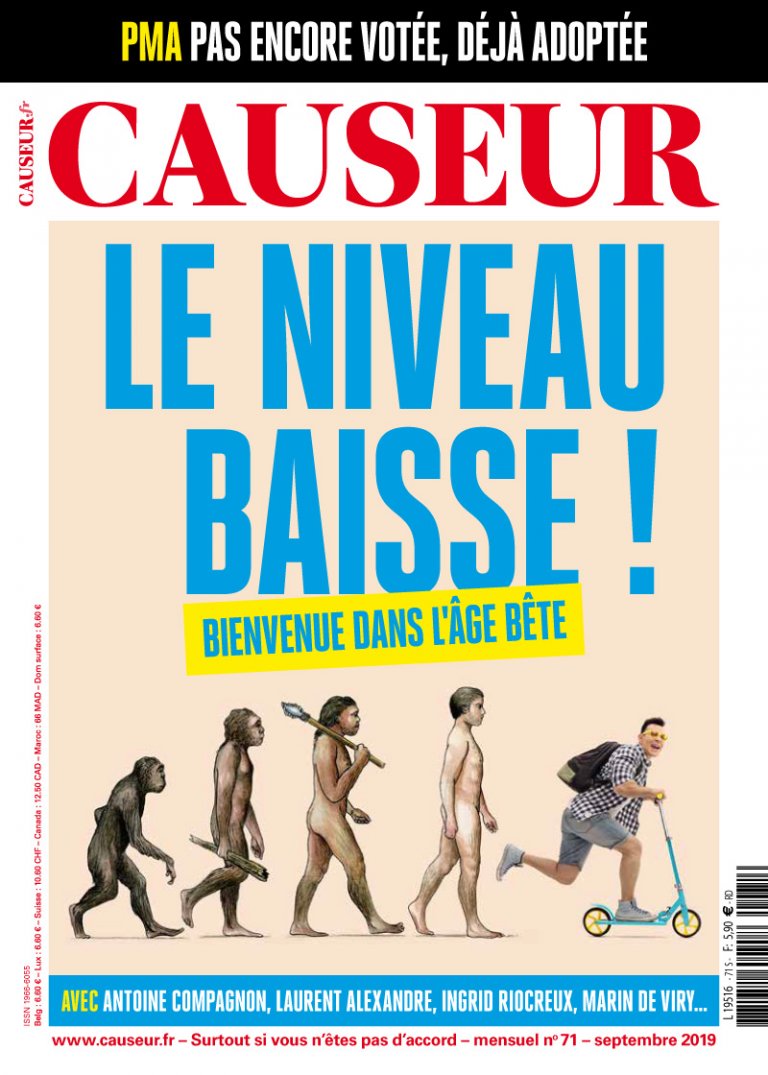De la Chine à l’Amérique, la demande intérieure a tendance à faiblir. Si une hausse des salaires pourrait éviter une récession mondiale, les tenants de la mondialisation heureuse n’en veulent pas.
Beaucoup de gens s’inquiètent d’une possible réédition de la crise de 2008. En réalité, il n’y a pas de conjoncture plus contraire à celle de 2008 que celle de 2019.
Il y a onze ans, nous avons été frappés, des deux côtés de l’Atlantique, par une crise financière qui a ouvert la voie à ce qui est appelé, depuis lors, la « Grande Récession », une récession deux, trois ou quatre fois plus importante, selon les pays concernés, que celles de l’après-guerre. Cependant, au-delà de l’Europe et de l’Amérique, seuls le Japon et les nouveaux pays industriels d’Asie ont été touchés. La Chine, pourtant déjà fortement reliée à notre prospérité, a conservé un dynamisme soutenu par les relances du gouvernement de Pékin.
A lire aussi: Privatisations: les sous-doués font de l’industrie
En 2019, les marchés financiers se portent mieux qu’ils ne se sont jamais portés. Selon les apparences, puisque les actions cotées sont à un record historique, ainsi que le crédit des emprunteurs publics et privés, exception faite des cancres nommés Turquie et Argentine. Avec cette chose inouïe : un cinquième de la totalité des emprunts cotés sur les marchés est affecté de taux négatifs. Cette absurdité apparente signifie que les emprunts émis antérieurement avec des taux positifs, comme il se doit, pour un montant de 100 et un intérêt de 2 % sur dix ans, par exemple[tooltips content= »Les obligations de référence du crédit des États ont une durée de dix ans »]1[/tooltips], ont pris une valeur telle que leur rendement apparent est devenu négatif, puisqu’ils se négocient au-dessus de 140, largement au-delà du capital et des intérêts figurant à l’émission. Tout s’explique par la procédure inédite de quantitative easing, ou « assouplissement quantitatif », dont on ne saurait surestimer ni les effets salvateurs ni les effets toxiques.
Quoi qu’il en soit, les entreprises, les particuliers et les États bénéficient de conditions de crédit des plus favorables et d’un facteur additionnel sous la forme d’intérêts bas ou nuls à servir sur le capital emprunté.
L’Allemagne emprunte à taux négatifs, de même que la France, il y a peu présentée encore comme un État en faillite virtuelle, ce qui nous fait économiser plusieurs milliards d’euros sur la facture financière annuelle du Trésor de Bercy. La Grèce, chassée des marchés du crédit en 2010, se voit offrir des taux d’emprunt inférieurs à 2 % ! Les particuliers français qui veulent emprunter pour construire ou acheter un logement y sont encouragés par des taux de l’ordre de 1 %.