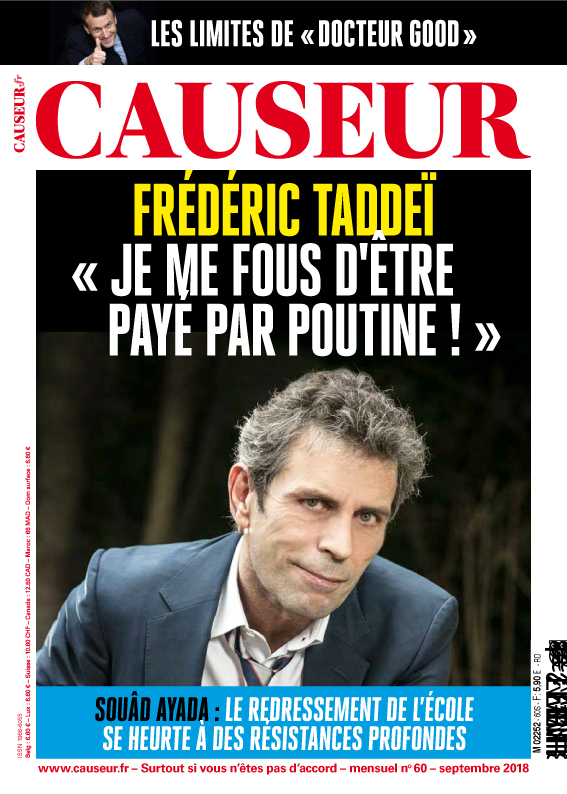Pour enrayer la dégringolade du lycée, la présidente du Conseil supérieur des programmes prône le retour aux fondamentaux. Reconnaissante à l’école républicaine de lui avoir permis d’échapper aux déterminismes sociaux et de servir son pays, Souâd Ayada entend réhabiliter les humanités, le sentiment national et la transmission des savoirs. Entretien (2/2).
A lire aussi: Souâd Ayada: « Certains Français ne s’aiment plus » (1/2)
Mais, aux yeux de l’ancienne inspectrice que vous êtes, le niveau des profs dans leur discipline n’a-t-il pas également chuté ?
Les mathématiques et le français connaissent depuis quelques années une crise du recrutement de professeurs. À cela s’ajoute la multiplication des moyens d’accéder à l’enseignement, les concours externes et internes du Capes et de l’agrégation ne constituant plus la voie privilégiée. Plus généralement, dans toutes les disciplines, le corps des professeurs a beaucoup changé. J’ai constaté cela même en philosophie, une discipline qui n’est pourtant enseignée qu’en terminale. Je ne dis pas que les professeurs aujourd’hui sont mauvais, je m’interroge sur la généralité et la solidité de leur formation initiale. Au-delà de la question du niveau des professeurs, il faut interroger les formations universitaires. En philosophie, il était inconcevable d’obtenir la licence sans une honnête connaissance de Kant. Aujourd’hui, certains étudiants titulaires d’un master 2 ignorent tout de Kant, mais sont de fins spécialistes de la déconstruction et des théories du genre, du « care »…
Pouvez-vous donner des exemples concrets des problèmes dans les programmes ?
Les programmes de lycée, qui datent de 2010 pour la plupart d’entre eux, me semblent plutôt satisfaisants, du point de vue de leur contenu et de leur ambition. Je serai en revanche plus réservée sur les programmes de l’école primaire et du collège de 2015, notamment ceux de français et, dans une moindre mesure, ceux de mathématiques. Le ministre a demandé au CSP de clarifier et d’ajuster les programmes de français, de mathématiques et de l’enseignement moral et civique de la scolarité obligatoire. J’ai eu à cœur d’orienter les travaux (officiellement publiés en juillet) vers plus de simplicité en mettant l’accent sur ce qui est élémentaire et fondamental dans l’enseignement. En français, il s’agissait d’échapper à l’emprise des jargons, notamment logico-linguistiques dans lesquels