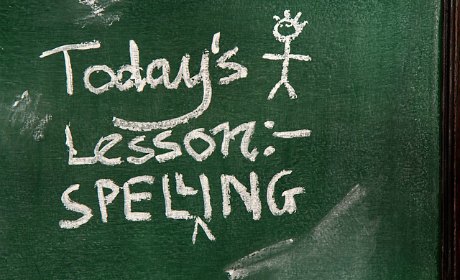France, ton école fout l’camp ! C’est ce que dirait la du Barry, si elle s’occupait de l’Éducation nationale d’aujourd’hui au lieu de veiller au café de Louis XV. Et personne ne la contredirait : sur le diagnostic, tout le monde est d’accord. L’illettrisme est en progression constante, les performances en maths, on l’a appris récemment, se sont effondrées, le bac ne vaut plus rien. Quant à l’enseignement de l’histoire, dont chaque Français se croit spécialiste, c’est un champ clos où s’affrontent les nationalistes – royalistes spécialistes du métro (Lorànt Deutsch) ou commerçants de l’épopée napoléonienne (Dimitri Casali) –, et les internationalistes adeptes de l’histoire globale et de la culpabilisation mémorielle – ils sont légion.
Encore les tournois avaient-ils des règles. Mais les luttes en champ clos se doublent de conflits cyclopéens entre les « pédagos » et les « républicains », où tous les coups sont permis. Comme dans l’Iliade, on s’insulte avant d’en découdre (« Enfant de Meirieu ! », « Sale élitiste ! »), et le sang coule.
C’est que si l’état des lieux est l’objet d’un consensus, les causes et les remèdes sont diversement analysés. Il suffit qu’un ministre peu au fait de la tâche qu’on lui a confiée (Najat Vallaud-Belkacem, par exemple) se laisse manipuler par les chevaux de retour du pédagogisme, qui ont infiltré depuis des lustres deux ou trois syndicats (le SGEN et le SE-UNSA, godillots du ministre, mais aussi certains secteurs du SNUI-PP), des organisations de parents (la FCPE), l’Inspection générale et les couloirs de la Rue de Grenelle, pour que germe une réforme du collège et des programmes qui a jeté des milliers d’enseignants dans la rue le 19 mai, et qui, à en croire Julien Dray, qui s’en est ouvert à François Hollande, pourrait mobiliser un million de manifestants à la rentrée. Pari tenu.[access capability= »lire_inedits »]
Qu’une réforme soit nécessaire, tout le monde en convient. Les différences de réussite entre « héritiers » (collégiens « initiés » par leurs parents aux bonnes filières, au beau langage, mis en orbite dès la sixième vers les classes prépas) et déshérités – non seulement les enfants des banlieues, mais de toute cette France ignorée des « élites parisiennes » (un pléonasme, à les entendre) que Christophe Guilluy a joliment baptisée « France périphérique » – sont devenues insupportables. En quarante ans, les grandes écoles sont passées de 14 % d’élèves issus des couches populaires à moins de 4 % – ça, ce sont les faits.
Le mal vient de plus loin, dirait Racine. Vers la fin des années 1950, des pédagogues réformateurs américains, inspirés par un rousseauisme impénitent et animés des meilleures intentions, se sont souciés d’instaurer dans l’enseignement des rapports « plus humains » – en abolissant la relation verticale du maître à l’élève, en mettant en avant les qualités supposées de ce dernier, bref, en fabriquant quelques dizaines de millions de petits Émile des grandes plaines. L’expérience, un temps confinée aux États-Unis, s’est étendue dans le monde à la faveur de l’agitation idéologique des années 1960. Le constructivisme (l’enfant construit ses propres savoirs, au lieu de recevoir passivement un enseignement ex cathedra – le ministre m’excusera de parler latin, j’ai été très mal élevé, en atmosphère confinée et élitiste) a contaminé d’abord le domaine anglo-saxon (l’Angleterre et le Canada ont payé un lourd tribut à ces simagrées angéliques), puis l’ensemble de l’Europe.
En France, les gentils JOC (Jeunesses ouvrières chrétiennes), dont est issu Philippe Meirieu, pape du constructivisme à la française, ont trouvé un nouvel évangile dans ce rousseauisme de bazar : ainsi le pédagogue a-t-il pour mission d’aider son disciple à voir la lumière en lui-même.
Dans le vocabulaire abscons qui permet aux initiés de la nouvelle foi de se reconnaître entre eux, on ne parle pas de « disciple », mais « d’apprenant ». Les programmes d’avril 2015 sont lourdement lestés de cette phraséologie de secte : « milieu aquatique profond standardisé » pour dire « piscine », et « traverser l’eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête » pour « nager ». Certains ont osé rire de cet insoutenable jargon, à la fureur du SNEP-FSU, syndicat majoritaire chez les professeurs d’éducation physique et sportive (le « prof d’EPS » a depuis belle lurette remplacé le « prof de gym » du grand Duduche), qui a vu dans ces moqueries « une forme de condescendance et d’ignorance bienséante lorsqu’il s’agit de sport à l’école », ajoutant, à l’adresse des « pseudo-z’intellectuels », comme dirait le ministre Najat Vallaud-Belkacem : « Un enseignement se préoccupant du corps (donc considéré comme de bas niveau intellectuel ?) devrait donc forcément s’écrire dans un langage trivial et non se théoriser ? » Ils ont raison, pourquoi parlerait-on de ballon quand on peut dire « référentiel bondissant » ?
Cette novlangue pédago (dont aucun prof concret ne fait usage) n’est pas seulement grotesque – ou anecdotique : elle correspond au cauchemar de la Lingua Tertii Imperi de Viktor Klemperer. Le pédagogisme est un totalitarisme. Un totalitarisme gentil et compassionnel.
Il pratique l’entrisme que les groupuscules gauchistes avaient érigé en l’un des beaux-arts. Seul un travail souterrain peut expliquer que des individus par ailleurs éclairés (Giscard d’Estaing ou René Haby) se soient laissé convaincre par le « collège unique » – désormais présenté comme un prérequis. Il fallait avancer masqué pour persuader François Fillon de décréter le « socle commun de connaissances » en 2004 – un socle qui réduit les connaissances obligatoires à un seuil extraordinairement bas. Réflexe de prof d’EPS : pour que tout le monde réussisse, on ne cesse de baisser la barre. Et 88 % des élèves de terminale réussissent le bac.
Au passage, le pouvoir des pédagos fut assez fort pour inspirer à Chevènement, qui l’a bien regretté depuis, la formule creuse des « 80 % d’une classe d’âge au bac ». Dans un pays où le baccalauréat est le premier diplôme universitaire (une exclusivité française : partout ailleurs, un diplôme de fin d’études clôt la scolarité secondaire), cela a permis d’envoyer en fac et au casse-pipe des générations de néobacheliers qui sont allées se fracasser sur le niveau, pourtant peu exigeant, des études supérieures. En moyenne, 50 % d’entre eux passent le cap de la première année – un pourcentage qui se réduit à 2 % pour les bacs professionnels, dont on a fait digérer à ce même Chevènement l’alignement sur les bacs généraux.
Ça a donc débuté comme ça, dirait Céline. Et sur cette base branlante, mais réputée incontournable, on a déroulé les conséquences. On a modifié les méthodes d’apprentissage de la lecture – parce que, d’après nos modernes Jean-Jacques, la méthode alpha-syllabique est une méthode de « classe », favorisant ceux qui disposent par héritage familial d’un sac de vocabulaire plus gros que celui des autres – ceux que le regroupement familial avait fait entrer en France en même temps que l’on décrétait le collège unique, combinaison létale s’il en fut jamais. On a tenté d’imposer les maths modernes – afin que les salauds de parents qui avaient fait des études ne puissent pas aider leurs rejetons pour les cours du soir. On a dénaturé l’étude du français, en transposant en CP tout un vocabulaire hérité de la linguistique moderne, qui faisait sens à bac + 5, mais qui imposait une rééducation des apprentissages basiques en primaire ou au collège. D’ailleurs, la grammaire n’a plus été enseignée systématiquement, mais de façon aléatoire – afin de favoriser le ludique.
Bien entendu, le facteur économique est déterminant en dernière instance, dirait Marx. Les libertaires qui conféraient au dégraissage brutal l’onction des nouvelles pédagogies ont été reçus comme des messies par les néolibéraux. En effet, toute heure économisée se traduit par des postes en moins – et dans une administration qui compte 850 000 enseignants, la tentation était forte. On a ainsi supprimé, en vingt-cinq ans, 500 heures de français – en postulant que du français, on en fait dans toutes les matières, et que l’on peut considérer qu’une heure de maths, c’est un quart d’heure de français. En additionnant ainsi des fractions d’emploi du temps, on est passé de 6 heures de français (années 1970-1980) à 4 aujourd’hui. Un élève d’aujourd’hui aura suivi à l’entrée de la seconde le nombre d’heures de français d’un élève qui entrait en quatrième il y a trente ou quarante ans – quand Valls ou Vallaud-Belkacem étaient collégiens, aussi privent-ils les générations suivantes de l’enseignement qui leur a permis de réussir. En primaire, le passage à la semaine de quatre jours et demi n’obéit pas à une autre logique – les chronobiologistes et autres disciples de Piaget étant intervenus pour que l’innovation se limite à la pratique du macramé.
L’argent, nerf de la guerre, comme disaient Thomas More et Rabelais. En étalant les difficultés (les quatre opérations, autrefois étudiées et maîtrisées dès le CP, sont à présent apprises jusqu’en CM2), on a supprimé l’une des causes de redoublement, avant de le supprimer dans les faits et sur ordre : un redoublant, c’est, selon les niveaux, entre 6 000 et 14 000 euros par an. Bien entendu, le fait que la Rue de Grenelle, depuis vingt ans, commence et finisse à Bercy, a été pieusement recouvert d’un voile pédagogique (ne pas décourager, un redoublant précoce est un enfant mis en échec, bla-bla-bla).
La réforme de Najat Vallaud-Belkacem découle de cette source empoisonnée. Elle utilise les mêmes arguments pédagogiques au service des mêmes intérêts économiques. D’où le soutien initial de Luc Chatel, auquel elle a emprunté les méthodes calamiteuses de sa réforme du lycée. Droite et gauche ont fait le même sale boulot. S’il est bien un domaine où le slogan « UMPS » fait sens, c’est à l’Éducation nationale.
Le problème, c’est que l’Éducation n’est ni de droite ni de gauche. La réussite des « apprenants » est un bien commun et leur échec une faillite commune. La méritocratie, l’élitisme républicain (des mots honnis par nos pédago-libéraux) n’ont pas de couleur politique – pas d’autre couleur que celles du peuple de France, que l’on tente d’amuser avec des réformes de surface (commencer une langue en cinquième, étudier le latin dans un cadre interdisciplinaire où l’on n’apprendra plus rosa-rosa-rosam, mais à jouer à Gladiator). La seule vraie réussite consisterait à pousser chacun au plus haut de ses capacités, ce qui impliquerait de reprendre à la base l’apprentissage de la langue et de la culture françaises. Le refus actuel de la transmission des savoirs, le « respect » érigé en principe de discussion, l’idée que l’enfant est naturellement moins sauvage que le tigre et n’ait aucun besoin d’être « institué », le recours au fétiche informatique comme si une technique était une science, sont autant d’indices inquiétants d’une perte d’identité, de la tentation communautaire, et de l’enfermement des ghettos sur eux-mêmes. La réforme Valls/Vallaud-Belkacem est le coup de pied de l’âne – ou des ânes. Il faudra tout reprendre à zéro, en commençant par éliminer les responsables qui ont vieilli dans leurs certitudes, et qui, observant comme tout le monde que l’École allait dans le mur, ont convaincu le ministre qu’il fallait y aller plus vite encore. « Eh bien, continuons », comme dit un personnage de Sartre jeté en enfer. Et juste après : rideau.[/access]
Également en version numérique avec notre application :
*Photo : Pixabay.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !