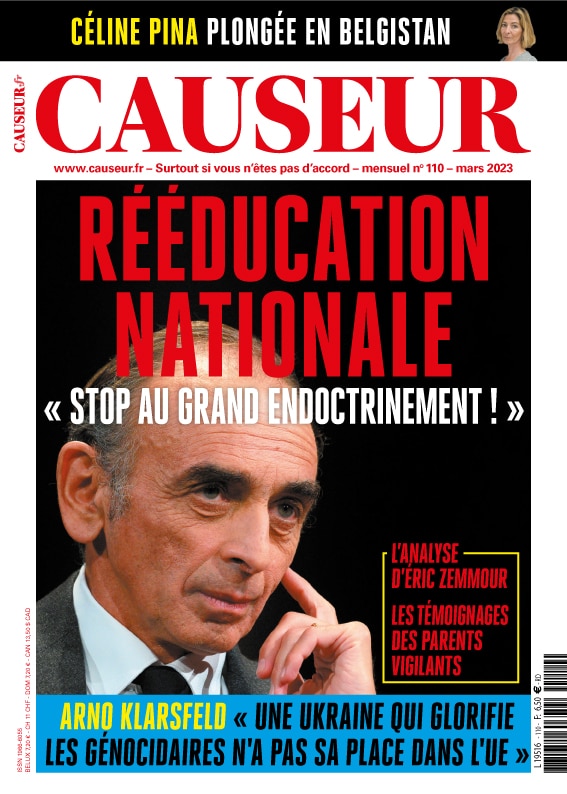Le meilleur « pain de campagne » se trouve en ville, nos belles provinces étant sous la coupe de boulangeries semi-industrielles. On peut toutefois y rencontrer des irréductibles, des boulangers passionnés qui redonnent vie aux farines anciennes en travaillant la terre, l’eau et la meule de pierre.
C’était dans les années 1970. À l’époque, le pain était infect, blanc, volumineux, léger, sans goût, sec comme du carton, bourré d’acide ascorbique… Dans la campagne dauphinoise où nous avions notre maison, le boulanger venait ainsi une fois par semaine livrer ses pains à tous les fermiers du coin, qui finissaient par le donner à manger aux poules. Je ne sais comment ma mère a réussi un jour à trouver un très beau pain à la croûte multicolore et à la mie fraîche, humide et bien alvéolée. Posé à côté, sur la table de la cuisine, il y avait une motte de beurre au lait cru et salé. J’avais une dizaine d’années et cette simple tartine s’est inscrite dans mon occiput avec la force d’une émotion proustienne, la rondeur et la fraîcheur du beurre venant souligner les notes de noisette, de foin et de miel du pain bien cuit et croustillant. Aucun de tous les grands chefs cuisiniers qu’il m’a été donné de rencontrer n’a jamais égalé l’harmonie de cet accord parfait ! Du pain et du beurre… Ces deux denrées « de base » sont un festin à elles seules quand elles sont d’une qualité parfaite.
Si la qualité moyenne du pain est bien supérieure à ce qu’elle était il y a cinquante ans, trouver un pain vraiment succulent relève encore de l’exploit. Bien que comestible, il est la plupart du temps parfaitement ennuyeux, surtout dans les campagnes, qui se révèlent être de vrais déserts boulangers (comme en Bourgogne, où les plus grands vignerons n’hésitent plus à commander leurs pains par Chronopost à des boulangers situés à des centaines de kilomètres de chez eux). Ainsi, la qualification courante de « pain de campagne », qui désignait autrefois une belle miche goûteuse, devrait laisser place à celle de « pain de ville », car c’est dans les villes que le pain est aujourd’hui le meilleur.