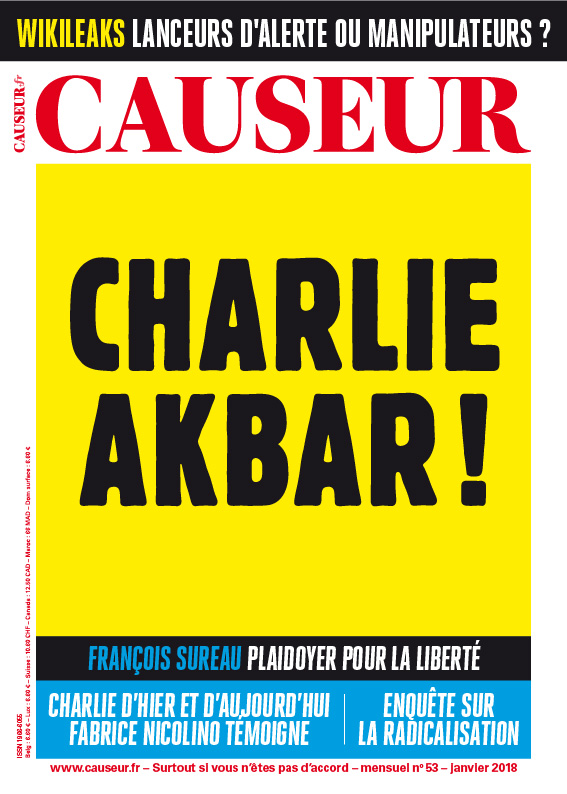La décision prise par Trump de déménager l’ambassade américaine à Jérusalem ne favorise pas le règlement du conflit israélo-arabe. Pas plus qu’elle ne le rend impossible…
Le 4 juin 2008, un futur président des États-Unis affirmait : « Jérusalem restera la capitale d’Israël, et elle restera unifiée. » Il s’appelait Barack Obama. Bien évidemment, comme tous ses prédécesseurs, il s’empressera de changer de position dès son élection. Depuis 1998, les présidents américains successifs ont tous, deux fois par an, mis leur veto au transfert de l’ambassade de Tel Aviv à Jérusalem exigé par le Jerusalem Embassy Act voté à une très large majorité par le Congrès en 1995.
A contre-courant de ses prédécesseurs
Trump avait averti qu’il cesserait cette pratique. Il était d’autant plus déterminé que l’immense majorité des chrétiens évangélistes – dont le vice-président Mike Pence est très proche – a voté pour lui. Mais c’est d’abord et avant tout pour le président américain une question de principe, dans le droit fil de sa décision de retirer les États-Unis de l’Unesco à la suite, justement, des résolutions adoptées sur Jérusalem, qui semblaient en nier l’identité juive du mont du Temple. C’est une manière de dire : « Je tiens mes promesses. » D’autant qu’il avait été agacé d’avoir dû, sur la pression de ses conseillers, renoncer une première fois, en juin, à cette décision. Certes, le transfert de l’ambassade ne sera pas concrétisé avant deux à trois ans, mais c’est parce que les contraintes juridiques et sécuritaires américaines sont très strictes. (Quelques pays suivront Washington : après tout, certains avaient leur chancellerie sur place jusque dans les années 1980.)
Comme on pouvait s’y attendre, il n’y a pas eu de grand soulèvement en dépit