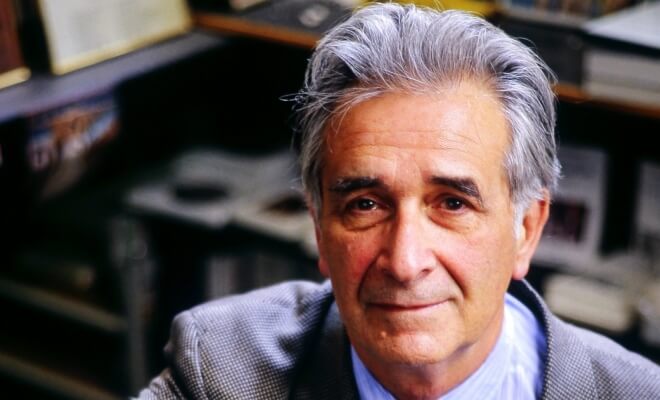
Cachée dans un recoin du quartier latin, une petite librairie a longtemps fait office de thébaïde aux réfractaires du monde moderne. Maison d’édition et librairie, l’Âge d’homme, naguère sise 6 rue Férou, entre la place Saint-Sulpice et le musée du Luxembourg, ressemblait à son fondateur Vladimir Dimitrijevic : ployant sous les livres, spirituellement orthodoxe, culturellement slavophile, tout à la fois enraciné et cosmopolite. Celui que ses proches surnommaient affectueusement Dimitri s’en est allé à soixante-dix-sept ans dans un accident de voiture voici six ans, laissant des milliers de lecteurs orphelins et des employés inconsolables, quand bien même les payait-il au lance-pierres et partait-il dans des colères homériques.
Un orthodoxe hétérodoxe
Dans quelle autre maison le commissaire aux Affaires étrangères de Lénine, auteur d’un remarquable essai sur Mozart, aurait pu voisiner avec Chesterton, Caraco ou Grossman ? A la mort de Dimitri sa fille Andonia a tant bien que mal repris l’affaire. Passées l’euphorie et la manne du succès de Joël Dicker, l’héritière a transformé l’Âge d’homme en maison spécialisée dans le vegan (son dada !) puis fermé la boutique parisienne. Reste la librairie lausannoise.
Et un livre d’entretiens mémorable où le vieux compagnon de route de Dimitri, Gérard Conio, ressuscite tant son verbe que son esprit à travers une série d’entretiens menés pendant plusieurs années : Béni soit l’exil ! (Editions des Syrtes/L’Âge d’homme, 2017). Je ne m’explique pas la conjuration du silence qui entoure cette passionnante conversation, où les aficionados reconnaîtront l’accent, les intonations et la profondeur du dernier grand éditeur européen. Conio, traducteur du russe du polonais, révèle au grand public un homme passionné, au sens quasi-christique du terme. Sa vision peu orthodoxe de l’orthodoxie s’étale au fil des pages : à l’instar du personnaliste russe Nicolas Berdaïev, dont il a édité les œuvres, Dimitri considérait le Jugement dernier comme le moment suprême de la liberté, si bien qu’il écartait toute idée de damnation. « L’homme est seul » au monde, sans dieux ni esprits adjuvants, répétait-il à l’envi, non sans récuser l’illusion moderne d’un individu auto-fondé.
Parole de Zincar !
Par son sens de la maïeutique, Conio accouche Dimitri de réflexions essentielles sur l’égalitarisme de notre temps : « À notre époque, on peut encore comprendre la fraternité, mais ce qu’on ne comprend plus, c’est la paternité ». Chez cet admirateur de Poutine, « on retrouve l’idée de Nikolaï Fiodorov (1829-1903) selon laquelle il ne peut y avoir de fraternité que s’il y a d’abord une paternité. L’œuvre de Fiodorov est fondée sur le culte des pères et des ancêtres. » m’indique Conio. D’ailleurs, l’expression même d’âge d’homme renvoie à l’idée orthodoxe d’un stade avancé de l’humanité où l’animalité aurait reculé au profit d’un humanisme greffé sur le divin. Une perspective dans laquelle ce double déraciné s’est toujours reconnu.
Arrêtons-nous sur son itinéraire. Né à Skopje en 1934, Dimitri appartenait à l’ethnie zincar, peuplade disséminée entre la Macédoine, la Roumanie et la Yougoslavie. Enfant, le petit Vladimir suit son père commerçant à Belgrade, son premier exil. Jamais pleinement serbe, sinon lors de l’agression de l’Otan contre son pays en 1999, toute sa vie durant, Dimitri a gardé une haute conscience de sa singularité ethnique.
Les Zincars se pensent les descendants d’anciens colons romains restés dans les Balkans après la chute de l’Empire, autrement dit des latins égarés en Europe de l’Est ! Dimitrijevic expose d’ailleurs à Conio les dissensions qui minaient la future Yougoslavie dès l’époque austro-hongroise : alors que les Croates catholiques lorgnaient vers Vienne, ils considéraient les Serbes comme des Levantins orthodoxes, trop rudes et orientaux pour former d’authentiques Européens.
Un Serbe d’adoption
Par adhésion, le petit Dimitri est devenu Serbe lors de son déménagement à Belgrade que les bombes de la Wehrmacht arroseront bientôt, avant que Tito n’impose son joug sur le pays. Après-guerre, il réunit un cercle de lecteurs parmi ses condisciples de lycée dont Thomas Wolfe est le saint patron. Ces esthètes le lisent en anglais dans le texte, anticipant l’esprit cosmopolite qui présidera aux destinées de l’Âge d’homme. Jeune adulte, Dimitrijevic se débat avec le pouvoir communiste qui a jeté son père en prison pour délit d’opinion et doit se résoudre à l’exil pour assouvir sa passion : l’édition. On se reportera à un premier livre d’entretiens, Personne déplacée, pour connaître les détails du périple qui l’a mené de la Yougoslavie à la Suisse par l’entremise de contrebandiers italiens.
Personne déplacée
Après quelques travaux manuels, Dimitri atterrit dans une librairie de Neuchâtel. Il y déploie tous ses talents de vendeur lettré auprès de la fine fleur de l’intelligentsia mondiale, de Chaplin à Nabokov. De libraire, le passionné passe progressivement au métier d’éditeur dont il apprend les rudiments auprès d’une association de lecteurs helvètes qui publie quelques ouvrages par souscription. Puis Dominique de Roux, le gentleman-éditeur de l’Herne, le repère et l’aide à lancer son premier livre à l’Âge d’homme au début des années 1970 : Petersbourg d’Andreï Biély, chef d’œuvre du symbolisme russe dont l’onirisme a rendu fou plus d’un traducteur. Chipant ce projet à Gallimard, Dimitri entre dans la carrière sous le patronage de deux immenses auteurs slaves injustement connus en Occident : le Polonais Witkiewicz, dont il édite d’abord L’inassouvissement, et le Serbe Milos Tsernianski.
Ce dernier, génial écrivain du déracinement, amène Dimitri à se définir comme une « personne déplacée », à l’instar du prince Repnine, héros tragique du Roman de Londres. Au cœur de cette intrigue poignante jusqu’aux larmes, le protagoniste Russe blanc réfugié à Londres souffre doublement : du dénuement qu’il inflige à sa femme, et du déchirement de l’exil. Comme par un fait exprès, on croirait lire le portrait-robot de Dimitrijevic dans cette description du prince : « Ce qui frappait le plus dans le visage de cet homme, étaient deux grands yeux sombres qui brillaient comme des fragments de charbon incandescent ou de diamant noir. » C’est avec ironie et sincérité mêlées que Dimitri a intitulé son livre d’entretiens Béni soit l’exil !. Certes, son départ de Serbie lui avait offert l’occasion de bâtir la maison d’éditions dont il rêvait mais la douleur de l’émigré n’a jamais cessé de le tirailler.
Des écrivains qui mangent avec leurs doigts
Vu de l’extérieur, on peut se demander quel dénominateur commun réunit tous les auteurs de l’Âge d’homme, sinon la subjectivité d’un seul homme. Mais je vous vois venir. Gare à ne pas tout politiser. Depuis la controverse des années 1990 entre pro et antiserbes[1. Quel paradoxe s’agissant du seul peuple qui s’est libéré du nazisme sans aide extérieure et de la maison d’éditions qui compte probablement le plus grand nombre de livres antitotalitaires (Wat, Grossman, Zinoviev…)!], les seconds ont tôt fait de fasciser les premiers, quitte à jeter aux orties l’Âge d’homme, au catalogue pléthorique pourtant unanimement apprécié. À Conio, Dimitri dit publier les écrivains « qui mangent avec les doigts ». Mais qu’ont de commun Haldas et Zinoviev, Weininger et Wolfe ? Même son ami de quarante ans Gérard Conio peine à le cerner : « Il était critique envers ce qu’on pouvait appeler « la religion de l’art » et considérait que les idées étaient plus importantes que les formes. », ce qui l’a fait vomir le Nouveau Roman mais apprécier Proust, tout en concédant que La Recherche n’aurait pas trouvé sa place à l’Âge d’homme.
Sa prédilection pour les originaux et les gens simples, conjuguée à une érudition littéraire hors du commun, l’a fait abhorrer le philistinisme. Au point que cet anticommuniste farouche n’a pas de mots assez durs contre l’Autriche-Hongrie et la Russie tsaristes finissantes, poussant le paradoxe jusqu’à s’enamourer du grand cinéma et de la littérature soviétiques, du moins de sa partie la moins bureaucratisée. Sur la fin de sa vie, à Saint-Sulpice, alors qu’il fuyait les soirées mondaines et tirait le diable par la queue, son grand ami du quartier n’était autre que… le clochard du coin, fort cultivé et bienvenu à la librairie.
Son Jugement dernier
Les dernières lignes de Béni soit l’exil ! composent un testament spirituel bouleversant. Se souvenant de son père qui l’intimait en Serbe de « se dépenser », c’est-à-dire d’aller au bout de ses idées sans rien laisser d’inaccompli, le Vladimir Dimitrijevic de l’âge mûr s’ouvre au lecteur : « Ce que j’ai senti dans l’appel de ma religion et de mon Dieu, c’est la nécessité de me dépenser. La passion est quelque chose qui brûle, une dépense. Pour moi, la charrue est une image d’enfant qui dit bien ce qu’elle veut dire : « Dépense-toi ! » Les apôtres se sont dépensés. Ils ont témoigné, ils ont écrit des livres, des épîtres. C’est cela notre vision du monde et c’est cela notre vision de la fin du monde. Parce qu’il y aura une fin, il y aura un jugement. »
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !








