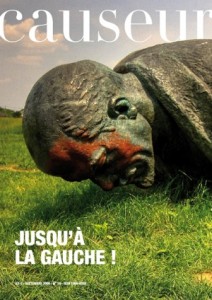« Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres. » Ce lieu commun inhabitable, vaguement issu de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, est censé exprimer la sagesse de l’autolimitation. Mon propos ne sera nullement de récuser cette sagesse de l’autolimitation, qui m’est très chère, mais de critiquer la forme de cette maxime, afin de mettre au jour les contenus implicites antipathiques qu’elle véhicule dans les soutes de son méchant langage.
« Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres. » Le premier inconvénient de cette maxime est qu’elle implique une conséquence fâcheuse : « La liberté des autres s’arrête là où commence la mienne. » Cette proposition en implique donc une autre qui résonne comme une condamnation de toute espèce d’autolimitation. Les malheureux qui se réclament de la première proposition sont contraints de se réclamer aussi de la seconde. Ils seront donc en devoir de proclamer à l’automobiliste adverse à qui ils viennent de couper le passage salement ou au mari de leur maîtresse les surprenant au cours de leurs ébats : « Ta liberté s’arrête là où commence la mienne, connard ! » Et ils pourront rajouter : « C’est dans la Déclaration des droits de l’homme ! » Si leur adversaire proteste, il leur sera même loisible de le dénoncer à Human Rights Watch.
[access capability= »lire_inedits »]Le second inconvénient rédhibitoire de la formule « Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres » réside dans le verbe « s’arrêter », dans l’idée stupide que la liberté s’arrête, que l’on retrouve également dans sa variante tout aussi indéfendable : « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. »
Procédons sans plus attendre à l’examen d’un exemple concret, pour ne pas nous noyer dans les eaux glaciales de la spéculation. Je n’hésiterai pas à utiliser ce prétexte pour révéler ici quelques éléments croustillants de ma vie familiale, à l’instar des écrivains branchés des cent dernières années. Les lecteurs réactionnaires et sans cœur que cet étalage malsain de détails intimes incommoderait sont invités à sauter le paragraphe qui suit.
Un jour, il y a une quinzaine d’années, alors que j’habitais en Catalogne française, à Thuir, au 18 rue San Ferréol, nous dînions en famille par un beau soir d’été dans notre idyllique jardinet. Alors que nous mâchions innocemment de délectables poivrons, tomates et aubergines farcis, nous ignorions encore combien cet instant de grâce, cette joie commune d’un soir d’été, étaient éphémères et fragiles. Nous ignorions qu’une ombre malfaisante épiait derrière la haie séparant notre riant jardinet de son jardinet triste. Notre machiavélique voisine, Véronique Pierre, sise au 16 rue San Ferréol, qui habitait une maison absolument identique à la nôtre et nous haïssait depuis de nombreuses années – notamment pour une sombre affaire de têtards ramassés en masse par mes frères et moi-même et dont elle soutenait, de façon parfaitement fantasque, qu’ils étaient la seule explication plausible au prodigieux pullulement de rainettes dans son propre jardin –, Véronique Pierre avait donc choisi cet instant précis pour arroser son décourageant jardinet. Lorsqu’elle s’avisa d’abreuver la haie de cyprès qui nous séparait de son regard, elle fut soudain traversée par l’idée étrange de diriger le jet de son tuyau d’arrosage – parfaitement identique au nôtre – non vers le pied de ses cyprès lugubres, mais vers leur faîte. Traversant la haie, le jet d’eau atteignit avec précision la joue de ma tante Claire (qui est aussi ma marraine) à l’instant précis où celle-ci mâchait voluptueusement sa dernière bouchée d’aubergines farcies.
La maxime « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » m’évoque irrésistiblement cette vision : une triste vitre de plexiglas s’élevant lentement entre nos deux jardins et interceptant le jet d’eau avant qu’il n’atteigne la joue de ma marraine. Une mécanique sans joie rendant impossible tout événement, toute rencontre jaillissante d’une altérité véritable – fût-ce celle de Véronique Pierre. A l’instant précis où l’eau atteignit la joue de ma marraine, il me semble insensé d’affirmer que sa liberté s’arrêta. Tout au contraire, la liberté de ma marraine, tout comme celle de Véronique Pierre, naquirent à l’instant même où le jet d’eau, franchissant avec la même audace que les bondissantes rainettes la limite des espaces séparés de nos jardinets, atteignit la joue de ma marraine. La liberté ne s’arrête jamais. Elle n’est pas là pour ça. En revanche, elle commence. C’est son boulot de liberté. Ma liberté commence là où commence celle des autres. La liberté de ma marraine commence là où commence celle de Véronique Pierre. La liberté est imprévisible, elle fait voler en éclats le registre du calcul, de la maîtrise. Comme le Christ, dont elle est l’un des noms, elle « rend toutes choses nouvelles ». Comme l’eau vive de Véronique Pierre, elle fait jaillir la présence et le présent.
La maxime « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » est mensongère en raison de l’aberrante métaphore spatiale qu’elle fait passer en loucedé. Elle veut nous faire croire que deux libertés humaines sont identiques à deux propriétés foncières et que la condition humaine se résume à la guéguerre de deux propriétaires de jardinets.
La liberté des comptables, connue encore dans nos contrées sous le nom de liberté des propriétaires de possibles, imagine l’existence humaine comme une somme de possibles calculables et dénombrables, qui pourraient êtres répartis équitablement (ou non) comme des parts de gâteau. Selon la mathématique foireuse de la liberté des propriétaires de possibles, l’homme qui a accès à quatre mille chaînes de télévision est deux fois plus libre que celui qui doit, morne, se restreindre à deux mille chaînes. Et celui qui possède une femme et quarante-sept maîtresses est quarante-huit fois plus libre que le malheureux qui a pris la décision incompréhensible de rester fidèle à son épouse.
La liberté des comptables repose sur un double calcul utilitariste. Sur un premier versant, elle prêche la maximisation des possibles dont je suis le propriétaire, la maximisation de mes jouissances et de mes droits. Dans un premier temps, cette maximisation prétend se connaître une limite, à travers ce principe de réciprocité cher aux comptables de la Révolution française, formulé dans le déplorable article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. » Puis, dans un second temps, dont ce méchant langage utilitariste rendait la venue très prévisible, ce principe de maximisation des jouissances devient de plus en plus explicitement illimité, à mesure que mon prochain devient celui qui me vole des parts de jouissance. C’est ainsi que le principe censé nous transmettre la sagesse de l’autolimitation nous conduit marche après marche jusqu’au désespoir de la « jouissance sans entraves ».
Avec ce second temps intervient le second versant du calcul utilitariste de la liberté des comptables : la maximisation de la désaffiliation, la maximisation de la non-appartenance. Ou encore : la minimisation des dettes envers les autres. C’est le point où culmine l’absurdité de cette conception de la liberté. « Moins j’ai de dettes, moins je prononce de promesses, moins je tiens ma parole, plus je suis libre ! » La liberté des comptables atteint ici son but : la maximisation du non-rapport entre êtres humains et, en conséquence, la maximisation du non-rapport de chaque être humain avec soi-même.
À chacun sa vérité, à chacun sa liberté, à chacun son jardinet.
Ainsi résonne le dernier râle des propriétaires de possibles.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !