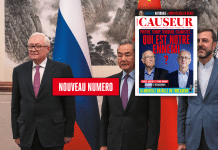Un livre, un film pour saluer le monstre sacré.
C’est le plus grand acteur du monde. Il sait tout jouer, tout. Du loubard Jean-Claude, dans Les Valseuses, à Robert Taro, maire de Marseille, en passant par Danton, Rodin, Staline, Cyrano, Obélix, Marin Marais, l’abbé Donissan, etc. Plus de 220 films. Vertigineux. Il n’a aucune limite. Une scène est une scène, on la joue, voilà. Il ne faut pas être hanté par le personnage, sinon on va dans le mur. Jouer un suicidé ne signifie pas qu’il faille passer à l’acte. Il doit y avoir une sortie de secours.
Instinctif
Depardieu est un instinctif. Il sent. Il se moque d’analyser. Son corps ne le trahit jamais. Dans son nouveau livre, Ailleurs, il écrit : « Un bon acteur, c’est quelqu’un qui n’a pas peur. La peur a une odeur. Ça pue un acteur qui pense. » La peur qui nous domine, et nous empêche de vivre. Nous y sommes, au cœur de l’époque, avec des dirigeants politiques qui entretiennent au quotidien cette peur paralysante pour mieux nous asservir. C’est pour ça que Depardieu va voir ailleurs, pour échapper à ce qui gâche notre envie de vivre. Il se rend en Éthiopie, découvre un « pays merveilleux », où se résume « toute l’histoire de l’humanité ». Ce pays n’a jamais été colonisé. Les Italiens ont pourtant essayé, en vain. Depardieu : « Aucune greffe n’a pris. » L’acteur recherche un « Ailleurs proche de l’origine. » Il fustige la colonisation qui, sous prétexte de civiliser, a corrompu les hommes. Il s’en prend au passé colonial de la France. Il rappelle les monstruosités perpétrées en Algérie.
À lire aussi, Bérénice Levet : Cinéma: le festival des cons
Il revient de la ville d’El Djamila, souligne sa beauté, les fruits et les légumes qui se développent sous le ciel bleu, « sans une merde de glyphosate dessus. » Les paysans connaissent tout, ils se souviennent des leçons de la nature. Il les admire. Comme il admire ceux de Tchétchénie, du Kazakhstan, ou encore d’Ouzbékistan. Mais il ne peut oublier que dans sa ville natale, Châteauroux, où il fut voyou, il a vu « des gamins revenir de la guerre avec des colliers d’oreilles d’Arabes ».
En attendant Des hommes de Lucas Belvaux
Depardieu refuse l’amnésie collective de la France. Début novembre sort le film Des hommes, de Lucas Belvaux, sur la guerre d’Algérie. Depardieu incarne Feu-de-Bois, un appelé, devenu sexagénaire raciste. De quoi en déranger plus d’un dans sa petite mort à crédit.
La France est vieille et se veut jeune. C’est terrible
L’acteur envoie un uppercut à la bien-pensance. Il est ami avec Poutine, il aime l’homme, connaît son passé, ses failles, ses douleurs. Il sait que sa mère a failli mourir sous les décombres, à Léningrad, en 1943. Elle fut sauvée in extremis par le courage et l’amour de son mari. Depardieu, bourré, a chassé le lion avec Fidel Castro, il lui a donné la recette des rillettes au lapin. Il a passé des nuits entières à converser avec François Mitterrand, à l’Élysée. Le président lui avait conseillé de lire les mémoires de Casanova. Il n’a de compte à rendre à personne. Cet homme, dont la tête ressemble de plus en plus à l’immense écrivain Joseph Kessel, est furieusement libre. Il dit ce qu’il pense et ses vérités sont salutaires. Comme ses coups de gueule dans un pays « cassé », proche du chaos, hors de l’Histoire. « La France est vieille. Très vieille, écrit-il. Elle pourrait profiter des leçons de son ancien temps. Mais non. La France est vieille et se veut jeune. C’est terrible. »
Un regard étrangement neuf
Sa curiosité demeure pourtant celle de l’enfant qu’il n’a jamais été. Sa quête est celle des prophètes. Il cherche la façon dont « la vie, la matière et l’énergie » sont liées. Il se méfie en revanche du pouvoir politique et des religions, qui « chacune prêche une idée d’une foi qui toutes les dépasse. » C’est un animal aux aguets dans la jungle des hommes. Il fuit ceux qui veulent dicter leur loi. Il déteste les écolos, par exemple, qui se foutent de sauver la planète. Il tempête : « Ce sont des inquisiteurs, des ayatollahs, des Hitler du bien, les totalitaires de demain. »
Depardieu continue de promener sa silhouette épaissie sur des chemins de hasard. Son regard reste étrangement neuf, son esprit ouvert à l’impossible. Fils d’un père analphabète et alcoolique, le Dédé, il a quitté l’école très jeune, n’est pas baptisé, et possède aujourd’hui une culture encyclopédique. C’est qu’il a été épargné par les radiations idéologiques de l’Éducation nationale. Il a lu seul. « Un livre, note-t-il, c’est une porte sur la vie. » Il aime Michel Houellebecq, « dandy magnifique ». Depardieu : « J’ai passé quelques semaines avec Houellebecq, je l’ai vu amoureux, je l’ai vu pervers, je l’ai vu manipulateur, je l’ai vu insupportable, je l’ai vu engoncé, mais je l’ai toujours vu honnête. Jamais il ne se ment. Sinon tu ne peux pas écrire ce qu’il écrit. » Depardieu a raison, on devient vite un fonctionnaire du culturel. Ils grouillent sur le cadavre du style.
Cet excessif sans surmoi est encore debout à chanter Barbara, il vagabonde dans le désert, pleure devant un troupeau de chevaux sauvages dans la steppe d’Asie centrale. Il a connu le pire drame qu’un père puisse connaître : la mort de son fils, Guillaume. Guillaume, cet écorché vif, détruit d’avoir porté le nom de Depardieu, à qui les juges n’ont laissé aucune chance — trois ans de prison ferme pour deux grammes d’héro. L’acteur est allé le voir en taule. Les prisonniers, dans leur cellule, gueulaient : « On va l’enculer, ton fils ! »
Depardieu continue, malgré tout, d’aimer la vie. Sa mère, la Lilette, a tenté de se débarrasser de lui à l’aiguille à tricoter. Il a survécu, aidé la Lilette à accoucher de ses frères et sœurs. Il a coupé le cordon, tapé sur le corps du nouveau-né pour « ouvrir » les poumons. Comme le font les paysans. Depardieu, c’est un « acteur agricole », a dit un jour Bertrand Blier. Il a pardonné à sa mère, il est passé à autre chose, ne regardant jamais derrière lui. Il y avait un secret de famille : le père de la Lilette avait une liaison avec la mère du Dédé. Lilette, en l’apprenant, avait voulu faire passer celui qui ne s’appelait pas encore Gérard. « Quand je suis arrivé, elle allait se barrer à cause de ça, confie Depardieu. Je lui ai coupé les jambes. » Il a pris, en effet, les jambes de sa mère. Quant à ce lourd secret, il l’a inhibé très longtemps devant les femmes.
À lire aussi, Jean Chauvet : « Un pays qui se tient sage »: la violence policière en cliché
Ailleurs, composé de courts chapitres, nerveux, avec des phrases parfois paradoxales, recèle une sagesse solaire. L’Ailleurs doit nous amener à « la beauté de la vie. À ne plus juger. À aimer tout simplement. » Il doit nous inviter à voyager là où personne ne va, sans bagage, la tête vidangée. Il doit nous permettre de rencontrer des hommes qu’on comprendra d’un simple regard.
Un rêve ouzbek
Dans le très beau film d’Arnaud Frilley, Mon rêve ouzbek, Depardieu marche sur le sable blanc de la mer d’Oural asséchée par « un abruti de politique, Khrouchtchev ». Il est au milieu d’immenses épaves de bateaux, rouillées. Il parle. Sa voix grave nous touche. Il suit sa nature de nomade. Les paysages sont grandioses. Le vent souffle comme au premier matin du monde. Plus loin, dans le film, Depardieu se met à prier, lèvres salées, cheveux en désordre, bras tendus vers le ciel. Il dit, de cette façon de dire si particulière : « Désert, il faut tout le silence des mots pour dire ton nom. » À cet instant, l’homme semble en paix avec lui-même.
Depardieu, Ailleurs, Le Cherche-Midi.
Arnaud Frilley, Mon rêve ouzbek, B-Tween production. Diffusé sur Paris Première.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !