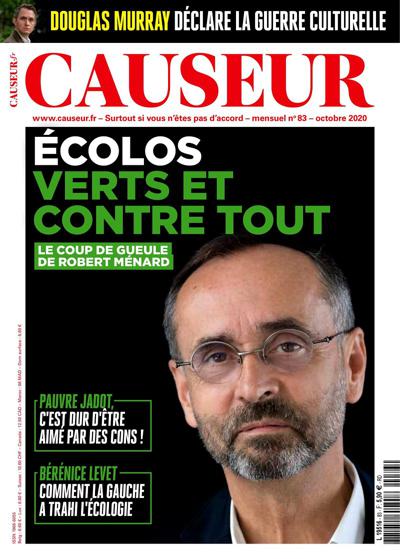Bérénice Levet adresse un dernier au revoir à Denis Tillinac
Denis Tillinac, l’homme qui aimait les femmes, la France, la littérature, le football, la peinture aussi. Ou qui aimait la France parce qu’elle comprenait tout cela. Un homme qui aimait. Si l’on devait garder une image de Denis, ce serait celle-ci : inaccessible au ressentiment, à la haine, à la jalousie, à ces passions viles qui corrodent et rabougrissent l’homme. Il fuyait les êtres et les choses qui alourdissent et enténèbrent l’existence.
J’ai fait la connaissance de Denis alors qu’il dirigeait les Éditions de la Table Ronde et publiait la revue L’Atelier du roman. J’avais adressé à Lakis Proguidis,