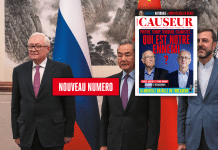C’est peut-être la seule idée universellement révérée, y compris par ceux qui la bafouent. Les peuples qui en sont privés en rêvent, les monarques et tyrans la promettent tout en la craignant. On salue ses avancées, on déplore ses revers, on recense ses bienfaits, on énumère ses ratés. De Pyongyang où elle est dite « populaire », à Téhéran où on l’aime « islamique », de Londres où on ne l’imagine pas autrement que « libérale », à Paris où on la veut « sociale », de Tunis où elle est un espoir, à Washington où elle fait partie des meubles, la démocratie est une proposition que personne ne peut refuser. Le nom de l’avenir radieux qui sera un jour le présent de l’humanité entière.
Cette victoire sans appel – du mot, sinon de la chose – a son revers, c’est que l’idée démocratique est devenue insaisissable. Même si on limite l’observation aux contrées que nous tenons pour démocratiques – dont, faut-il le préciser, l’Iran ou la Corée du Nord ne font pas partie -, elle est si diverse dans ses modalités concrètes et dans l’esprit qui l’anime qu’on finit par douter de la pertinence du concept.
Dans ces conditions, il peut sembler absurde de s’inquiéter de son éventuel délitement. Est-ce jouer à se faire peur ? Après tout, puisque nous ne savons pas la définir, il devrait nous suffire de savoir ce que c’est de vivre sans elle. Pire, n’est-ce pas le privilège d’enfants gâtés de la critiquer dans son principe même, voire, comme le fait Rémi Lélian, de l’accuser des crimes les plus abominables ? Commençons par évacuer cette objection qui revient à peu près à engueuler Tocqueville, l’un des premiers à avoir pressenti que le « pire des régimes à l’exception de tous les autres », comme on ne disait pas à son époque, n’était pas seulement porteur des multiples et incontestables bienfaits que nous lui connaissons, mais aussi de mutations beaucoup moins enthousiasmantes : l’égalité peut accoucher de la médiocrité, la fraternité d’un étouffant collectivisme et la liberté du narcissisme généralisé.[access capability= »lire_inedits »]
Il y a quelques années, dans son indigent opuscule sur les néo-réactionnaires, Daniel Lindenberg ne s’attaqua pas à Tocqueville mais à Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, Pierre Manent, Philippe Muray, Philippe Raynaud et quelques autres – parmi lesquels je m’honore de compter nombre d’amis. Il finissait par lâcher le morceau : ce qu’il reprochait aux suspects dont il dressait scrupuleusement la liste à défaut d’avoir lu ou compris leurs œuvres, c’était précisément de « critiquer la démocratie ». L’ennui, en tout cas pour Lindenberg, c’est que le droit à la critique fait partie du noyau dur : le propre de la démocratie, c’est précisément d’admettre et même de requérir sa propre contestation. La récuser dans son principe même, pointer, dans ses modalités concrètes, ses insuffisances ou ses renoncements, ce n’est pas se comporter en enfants gâtés mais en héritiers fidèles.
Difficile de nier, pourtant, qu’il y a, comme le dit Philippe Raynaud, un « malaise dans la démocratie ». Le sentiment que nous ne vivons plus en démocratie est de plus en plus répandu. Comme le dit d’emblée Marcel Gauchet dans l’entretien qu’il nous a accordé, nos libertés ne sont nullement menacées, au contraire elles n’ont jamais été aussi grandes. Nous pouvons professer des opinions inconvenantes sans être inquiétés – sinon par le tribunal médiatique, ce qui est fâcheux mais supportable -, aller et venir comme bon nous semble, choisir les gens que nous fréquentons et la vie que nous menons – et bientôt peut-être les voies par lesquelles nous fabriquerons les enfants. Cette extension du domaine de la démocratie à tous les aspects de la vie humaine et des relations sociales, nous l’avons désirée avec acharnement. Sophie Flamand raconte avec drôlerie comment l’école et la famille se mettent au goût du jour en remplaçant les hiérarchies du mérite, de l’âge ou de l’autorité, par des procédures égalitaires et participatives : par exemple, on demandera aux enfants ce qu’ils souhaitent apprendre (question posée il y a quelques années dans un questionnaire aux élèves concocté par l’Education nationale). On peut gager que l’armée sera prochainement sommée de s’adapter – est-il bien démocratique qu’un soldat soit obligé de saluer un officier ? Enfin, si la culture est tenue pour un instrument d’oppression et non de libération, c’est parce qu’elle est suspectée de ne pas être naturellement démocratique, voire d’être anti-démocratique. Non sans raison d’ailleurs. Bref, plus que d’un déficit démocratique, nous jouissons – ou souffrons – d’hyper-démocratie.
Il n’empêche. Si la démocratie, c’est le « pouvoir du peuple », le compte n’y est pas, ni du côté du manche, ni de celui de la lame.
Commençons par la lame – le pouvoir. Sur ce front, c’est la double-peine : non seulement le pouvoir s’exerce sans le peuple et parfois contre lui, mais ce n’est même pas un pouvoir. Ils n’ont pas de mains et elles ne sont pas très propres.
Ils ne nous demandent pas notre avis ou, bien pire, ils nous le demandent et s’assoient dessus. L’Europe devait être notre rédemption et notre nouvelle Frontière. Elle est la première cause et le visage détesté de la mise en congé d’une certaine idée de la démocratie, l’autoroute de contournement de la volonté des peuples. Du reste, l’idée de ce dossier est née lorsque Nicolas Sarkozy a annoncé son intention de faire adopter un nouveau traité. Le Président peut bien penser, comme il l’a déclaré dans Le Monde, qu’on « conforte sa souveraineté et son indépendance en l’exerçant avec ses amis, ses alliés, ses partenaires » – la bonne blague. Il n’en a pas moins reconnu que ce traité constituerait « une étape décisive vers l’intégration européenne ». Or, cette étape décisive, il entend bien nous la faire franchir sans nous demander notre avis. Le seul pouvoir du peuple serait-il celui de dire « oui » ?
Admettons cependant pour les besoins du raisonnement que conformément à la théorie – et à la pratique – de la démocratie représentative, le peuple exerce son pouvoir par le seul truchement de ses représentants. Qu’advient-il de la démocratie quand les commandes ne répondent plus à ceux à qui nous les avons confiées ? Que peuvent prétendre gouverner des gouvernants quotidiennement contraints d’expliquer qu’ils n’ont pas le choix et que leur politique leur est dictée par les exigences des marchés ou des agences de notation ? Certains voient dans cet aveu de faiblesse du politique la preuve que nous sommes sortis de la démocratie pour entrer en oligarchie, la réalité des décisions étant accaparée par quelques groupes et individus. Même si elle est partiellement opérante, cette analyse néglige une donnée fondamentale : sans légitimité, le pouvoir n’est que l’autre nom de la force. Et l’histoire enseigne que la force change souvent de camp, et souvent brutalement.
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de pouvoir du peuple s’il n’y a pas de pouvoir. L’effectivité de celui qu’exercent nos dirigeants est pour le moins sujette à caution. Cela dit, si comme le pense Marcel Gauchet, cette apparente impotence s’explique par l’incompétence et le manque de courage intellectuel d’élites qui, depuis trente ans, multiplient « les choix désastreux et tendent à persévérer dans l’erreur avec une constance remarquable », alors, elle est en grande partie conjoncturelle, donc réversible.
Le processus qui semble beaucoup moins facilement réversible, c’est la désagrégation de l’autre élément constitutif de la démocratie – le peuple. S’il y a malaise dans la démocratie, il y a psychose dans le collectif. Marcel Gauchet, Philippe Raynaud et, d’un certain point de vue Basile de Koch, observent, chacun à sa façon, les symptômes de la déréliction. Les individus tout-puissants que nous sommes devenus sont incapables de former un peuple, mais les animaux politiques que nous sommes restés sont incapables de s’en passer. Bref, nous sommes atteints de schizophrénie.
En attendant que l’histoire se charge de nous réveiller, il nous faut vivre avec cette « démocratie sans demos ni cratos » (expression pêchée dans un livre de Pierre-André Taguieff). Reconnaissons-le, il y a pire. D’accord, cette démocratie qui se contente de laisser chacun faire ce qui lui plait n’est pas très exaltante. On se voit mal mourir pour elle. Mais, justement, nous avons cette chance qu’on ne nous le demande pas – c’est l’heure de la séquence « pense aux enfants qui meurent de faim ». Aussi faut-il, en conclusion, écouter André Senik qui rappelle que cette démocratie imparfaite, injuste, inefficace et parfois même un peu pourrie sur les bords, nous offre un confort moral et matériel inimaginable il y a quelques générations et encore inconnu dans bien des contrées. N’oublions jamais tous ceux qui n’ont pas le droit de se plaindre.[/access]
Acheter ce numéro / Souscrire à l’offre Découverte (ce n° + les 2 suivants) / S’abonner à Causeur
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !