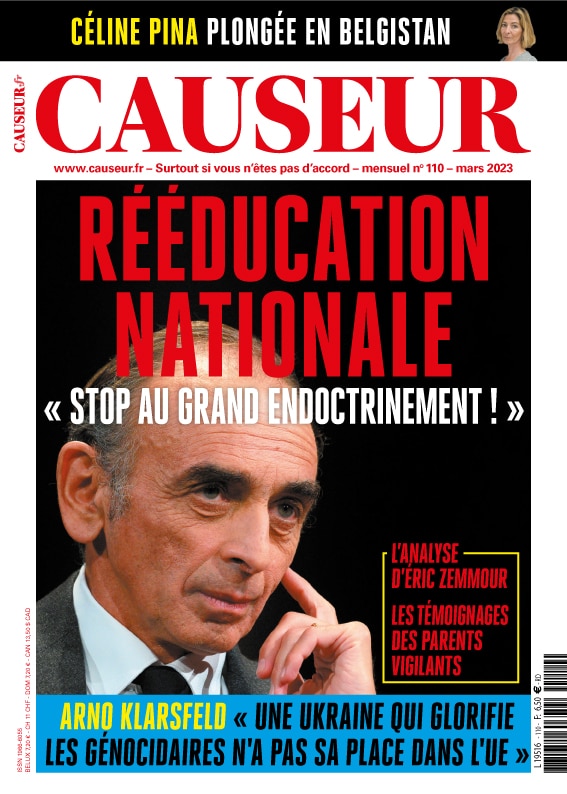L’universitaire américain Bruce Gilley s’est lancé dans une entreprise périlleuse : la défense du colonialisme européen ! Il démontre les bienfaits de l’impérialisme en comparant le développement des pays qui ont renoncé aux legs de leurs anciens occupant à ceux qui les ont conservés. Dans son nouveau livre, notre contributeur et ami Driss Ghali construit, pour sa part, un récit dépassionné de la colonisation.
« Ceux qui creusent des fondations profondes / Sur lesquelles des royaumes stables peuvent se construire / Récoltent peu d’honneurs… » Ces vers du poète impérialiste anglais Rudyard Kipling, écrits en 1905, présagent du sort des administrateurs coloniaux européens qui, à cette époque, œuvraient tant bien que mal pour introduire des méthodes de la bonne gouvernance moderne dans des sociétés n’ayant pas connu le développement accéléré des pays occidentaux. Aujourd’hui, ces fonctionnaires ne sont pas l’objet de reconnaissance, mais de condamnations sans appel. Dans nos universités et nos médias, le colonialisme incarne le Mal absolu. Il se réduit à quatre mots : déprédation, esclavage, racisme et génocide. Comment défendre un tel phénomène ? En France, on se souvient du tollé scandalisé qui, en 2005, a accueilli la loi préconisant, entre autres choses, la reconnaissance dans les programmes scolaires du « rôle positif de la présence française outre-mer ». L’alinéa en question a été supprimé l’année suivante.
Ne désespérons pas. Un nouveau champion du colonialisme a surgi : Bruce Gilley, professeur de science politique à l’université de Portland aux États-Unis. En 2017, il a publié dans une revue universitaire une plaidoirie pour les empires européens, « The case for colonialism ». Dès sa parution en ligne, les réactions horrifiées se multiplient autour de la planète. Trois pétitions sont lancées contre Gilley, chacune par un professeur – de danse contemporaine, de littérature anglaise et enfin d’histoire. On exige qu’il soit déchu de son doctorat, « ostracisé » et « humilié publiquement ». On l’accuse d’encourager la violence contre les non-Blancs et d’être coupable de « déni d’holocauste ». Sur les 34 membres du conseil de rédaction, 15 démissionnent en guise de protestation. Quand le rédacteur en chef reçoit des menaces de mort de la part d’internautes indiens, Gilley retire volontairement son article qui sera republié par une autre revue défendant la liberté intellectuelle.
En effet, la grande majorité de ses détracteurs, qu’ils soient chercheurs ou non, ne lui répondent pas par des arguments, mais lui contestent