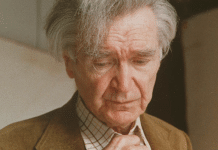1. Un portrait de Schopenhauer
Une anecdote sur Cioran que j’ignorais : dans la chambre de l’hôtel parisien où il écrivait son Précis de décomposition (dans les années 1940), Cioran avait accroché un portrait de Schopenhauer. « C’est la photo de monsieur votre père ? » lui avait demandé un jour la femme de chambre… Elle avait visé juste.
Clément Rosset, lui aussi, a découvert Schopenhauer à l’âge de quatorze ans, alors qu’il était en plein désespoir amoureux. La lecture de l’oncle Arthur a rendu ses déboires insignifiants. Après l’avoir lu, tout devenait au choix dérisoire ou absurde. L’ami Clément reproche à Cioran d’avoir rendu le pessimisme chic. Je me suis toujours senti en accord avec ce pessimisme chic – qui va de pair avec le refus de la vie –, alors que Clément, lorgnant du côté de Nietzsche, succombe à une joie de vivre qui procède d’une acceptation totale du réel, aussi absurde et tragique soit-il. Question de tempérament sans doute et de sensibilité à la musique et à l’alcool, deux baumes divins pour Rosset.
2. Le thé vert de Beigbeder
Rien ne ressemble moins au roman de Romain Debluë Les Solitudes profondes, qui s’inscrit dans la ligne d’un Bernanos qui écrivait « On ne comprendra absolument rien à la civilisation moderne, si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure », que les vagabondages tantôt cyniques, tantôt amers, d’Arnaud Le Guern avec Frédéric Beigbeder, l’incorrigible. D’un côté, un jeune[access capability= »lire_inedits »] Vaudois catholique de vingt-quatre ans qui cite saint Thomas d’Aquin et Hegel, de l’autre un James Boswell en espadrilles à l’écoute d’un Samuel Johnson germanopratin qui manie l’humour macabre et la provocation stylée avec un chic sans égal.
Automne 2016. Frédéric Beigbeder ne joue plus à être le compagnon irrésistiblement drôle qu’il a toujours été. Il a passé le cap de la cinquantaine, il s’est marié pour la deuxième fois (c’est ce qu’on désigne comme le triomphe de l’espérance sur l’expérience) et son film L’Idéal a été un flop. Il confie à son ami Arnaud : « Mon nom est synonyme de loser, c’est une grosse erreur d’écrire ma biographie, à la sortie ce sera un massacre. » Et, sur fond d’amertume, il égrène des petites phrases, drôles et perfides, pieusement recueillies par Arnaud. Par exemple : « Je deviens encore plus détesté que mon frère. Et pourtant, Charles, politiquement, y met du sien. » Ou encore : « Je ne vais plus boire que du thé vert. » Et celle-ci, plus amère encore que le matcha : « Je suis devenu le loser qu’on aime haïr. Je vais finir comme Sagan : vieux, malade, ruiné, sans amis. »
Bon, vous me direz qu’il exagère, qu’il joue la comédie, qu’il n’a pas encore connu la geôle de Reading, qu’il est définitivement un enfant gâté… Oui, mais avec quel panache ! Et s’il était, en dépit de tout, notre Oscar Wilde français ? Ce serait bien la seule bonne nouvelle de ce pays en déliquescence, qui préfère Annie Ernaux ou Camille Laurens, voire Éric-Emmanuel Schmitt, à Frédéric Beigbeder. Quelle tristesse !
« Et Romain Debluë, qu’avez-vous à en dire ? », me demande son éditeur, Michel Moret. « Que pour un auteur d’une vingtaine d’années, il m’impressionne en dépit d’une écriture un peu trop précieuse à mon goût, mais parfois tellement contournée qu’elle en devient jouissive. » Si Frédéric Beigbeder a le charme fitzgéraldien qui émane des fêlures et des existences brisées, Romain Debluë, lui, arrive de contrées lointaines – enfin, géographiquement pas tant que cela : Montreux –, avec un roman philosophique d’une ambition démesurée : traquer les faux-semblants de ce que nous croyons être notre culture et qui n’est qu’une gigantesque manipulation de décervelage. Des jeunes filles à la grâce hamiltonienne traversent son récit, ce qui ne gâche rien. Je vois un fil rouge entre Frédéric Beigbeder et Romain Debluë.
3. Jean Richepin, l’insolent.
Je me sentirais coupable de ne pas mentionner la réédition de ce chef-d’œuvre d’humour noir que sont Les Morts bizarres de Jean Richepin (1849-1926), une suite de nouvelles qui flirtent avec l’épouvante et l’inanité des ambitions ratées. Léon Bloy, dont il était proche, lui disait : « En réalité, vous vous foutez de tout, excepté de deux choses : jouir le plus possible et faire du bruit dans le monde. Votre rôle est d’épater le bourgeois. L’ignoble claque du public imbécile, voilà le pain quotidien qu’il faut à votre âme fière. » C ‘est tellement vrai que Richepin fera carrière dans l’insolence, comportement et œuvre mêlés. Ce qui le conduira aussi bien en prison qu’à l’Académie française.
Jean Richepin avait un génie très particulier : celui de saisir en quelques lignes le grotesque des situations dans lesquelles, presque malgré nous, nous nous projetons dans l’unique but de parvenir à assouvir nos misérables rêves de gloire. François Rivière, qui le préface, montre bien comment, dans son conte très borgésien Le Chef-d’œuvre du crime, il exprime le sentiment que nous éprouvons tous de n’être que de pauvres humains jetés dans l’existence comme des prisonniers sur la paille humide d’un destin abject, tout en soulignant le comique irrésistible de cette situation. Il le fait sur un ton si vif et avec une telle allégresse qu’effectivement il nous épate aujourd’hui encore. Une lecture à conseiller dans leurs moments de spleen à Romain Debluë et à Frédéric Beigbeder. Clément Rosset, lui, peut s’en passer : il n’a plus rien à apprendre des jouissances que procure cette forme d’ironie nihiliste et de pessimisme chic.
[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !