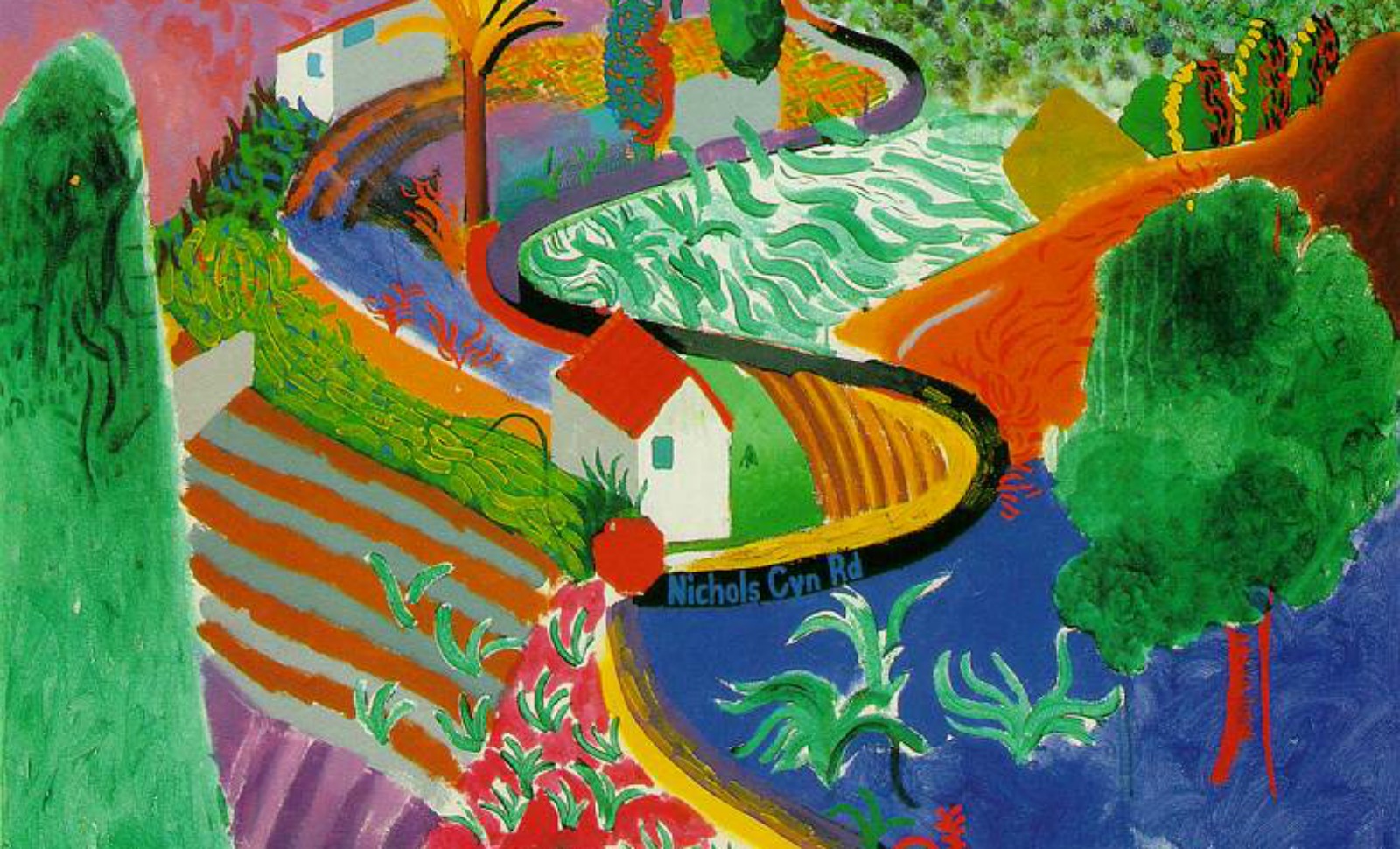Le centre Pompidou célèbre les 80 ans du peintre britannique avec une retrospective spectaculaire de son oeuvre. On y découvrira notamment une composition récente de 56 mètres carrés sur les paysage de son Yorkshire natal. Minimalistes, passez votre chemin…
Ce n’est pas parce qu’il s’est mis à dessiner sur iPad ou à utiliser des caméras HD pour créer des « tableaux vivants », projetés sur des « écrans-toiles », comme la sublime composition The Four Seasons (2010), que David Hockney prend son travail moins au sérieux. Au contraire. À presque 80 ans, ce jeune garçon aux cheveux décolorés continue, avec l’obstination et l’entrain d’un débutant, à exploiter les trouvailles des maîtres anciens. « L’invention de la caméra remonte à bien plus loin que celle de la photographie et domine l’art occidental depuis plus de trois cent cinquante ans, autrement dit depuis l’apparition de la camera obscura. Canaletto, Vermeer et tant d’autres artistes l’utilisaient parce qu’ils étaient fascinés par ses moyens », confiait-il en 1982 à Paul Joyce, au cours d’entretiens réunis dans un livre remarquable, paru chez Little, Brown and Company.
« Le cubisme a été mal compris comme étant une abstraction, ce qu’il n’est pas »
À l’époque, le peintre britannique, qui est aujourd’hui l’un des plus en vogue et des plus chers (après Peter Doig et Glenn Brown), a commencé à travailler au Polaroïd, sans se laisser démonter par le peu de succès rencontré quelques années plus tôt par ses photographies