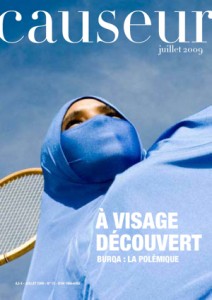Caracalla ! C’est sous ce nom que Roger Vailland, dans son roman Drôle de jeu, masque l’un de ses amis, Daniel Cordier. Né à Bordeaux, en 1920, celui-ci rencontra Jean Moulin, et le cours de sa vie en fut bouleversé. Le premier volume de ses mémoires, Alias Caracalla, vient de paraître. On est à mille lieux des témoignages à mâchoire serrée, des humeurs d’ancien combattant moralisateur. En hôte d’une ancienne politesse, il nous ouvre les portes de sa mémoire et retrouve, pour nous accompagner dans cet « immense édifice », la grâce d’un « adolescent d’autrefois », féru d’idées et de littérature.
Le récit porte sur sa période de « formation », c’est-à-dire le temps précédent sa rencontre avec Jean Moulin, puis sur celle de sa « conversion » auprès de ce guerrier silencieux. Où l’on voit comment un grand jeune homme d’Action française fut attiré par la lumière qu’irradiait Jean Moulin, comment il le servit et, avec lui, de Gaulle et la France. Daniel Cordier avait consacré une véritable somme à l’action de Jean Moulin. Toute sa « manière » était d’un historien, il exposait les faits, analysait les situations, reformait la perspective des lignes fuyantes. Il révélait les affrontements souvent très durs, les conflits d’analyses et de personnalités, et fracassait ainsi le mythe d’une Résistance unie. Et, surtout, il répondait aux accusations d’Henri Fresnay, d’après lesquelles Jean Moulin était le représentant du parti communiste dans la Résistance, l’agent actif de Moscou, le stipendié tout à la fois de Staline et des vieux partis de la IIIe République.
Alias Caracalla n’est pas écrit avec la même encre. C’est de mémoire qu’il s’agit ici, de l’effort que font les âmes claires pour ramener vers elles l’immense filet où sont mêlées les émotions lointaines mais toujours vives.
Le beau-père de Daniel, professeur de philosophie, l’initie au maurrassisme et lui enseigne en même temps les quatre piliers de sa sagesse : dégoût de la République, de la banque protestante, des métèques et des juifs. Ce bagage encombrant fut commun à bien des jeunes gens de l’entre-deux guerres. Il conduisit certains à collaborer, il n’empêcha pas d’autres de résister. Le jeune Cordier se persuade sans état d’âme que Dreyfus est coupable. Il crie « Vive le Roi » dans les manifestations, mais voit sans déplaisir les trois « usurpateurs » à vocation fasciste, Salazar, Franco et Mussolini, s’installer durablement dans le paysage européen. Maurras vilipende l’hédonisme et la célébration du moi, mais Daniel ne s’interdit pas de lire André Gide, dont « l’amoralisme d’esthète » le séduit au delà de tout, et ne le dissuade évidemment pas d’éprouver un trouble presque brutal dans la compagnie des garçons, ni d’envisager des fiançailles avec une charmante jeune fille…
Arrive la guerre. Il la voit comme une épreuve nécessaire, un rite d’initiation qui transforme un jeune adulte en citoyen. Révolté par le discours du maréchal Pétain, le 17 juin 1940, il embarque, le 21 juin, à Bayonne, à bord du Léopold II, vers Londres. En Angleterre, il suit une dure préparation militaire. Jeune nationaliste, il a la tête épique, le patriotisme à fleur de peau et veut connaître le feu. Il rêve d’affrontements dans les paysages de France, de commando infiltré derrière les lignes ennemies, enfin, de bouter le « Boche » hors du royaume. Convoqué par le colonel Passy, le 13 juillet 1941, il apprend qu’on lui confie des missions d’un genre très différent : « La guerre clandestine que nous menons en métropole n’est pas celle pour laquelle vous avez été préparé. Elle se vit seul et sans uniforme. […] la police et la Gestapo vous traqueront jour et nuit. […] votre mission aggrave l’isolement puisque vous serez en exil dans votre pays. » On lui remet une ampoule de cyanure, dans le cas où il serait arrêté… Il a 21 ans.
Le 25 juillet 1942, vers 2 heures du matin, il saute en parachute quelque part dans la campagne de Montluçon. Il n’a pas touché terre, qu’il est déjà pris en charge par un réseau : des filles, des garçons banals, des couples paisibles, des gens ordinaires, tranquillement héroïques. Trente mille personnes au début, trois cent mille à la fin, trente mille morts, cent mille emprisonnés composent le peuple obscur, la minorité vigilante de la France fidèle à tous les serments qui l’ont rendue unique, universelle, et qu’on oublie injustement…
Quelques jours après, il est à Lyon, recueilli par le directeur du service étranger de la Société générale, M. Moret, sa femme et sa fille, à la taille si bien prise que Caracalla en est ému. Contraints d’abandonner leur bel appartement du boulevard Malesherbes, à Paris, ils vivent dans un deux-pièces sans confort, et n’oublient pas, ces grands bourgeois, d’être patriotes et de courir des risques. La France fidèle…
On lui a désigné son patron : Georges Bidault, dont il doit devenir le secrétaire. Mais voici que s’avance Rex, en veste de tweed, pantalon de flanelle, et le visage hâlé, si charmeur. De Rex, il ne connaîtra l’état civil qu’à la Libération : Jean Moulin. Auprès de lui, il accomplira chaque jour les menus faits et gestes qui permettent la circulation des hommes, des ordres et des fonds jusqu’au plus lointain maquis, malgré les innombrables difficultés, malgré l’hostilité de presque tous à de Gaulle.
Rex disposait du pouvoir de l’argent, qu’il distribuait aux trois principaux réseaux : la plus grosse part à Combat, une moindre portion à Libération, et le reste à Franc-Tireur. C’était d’ailleurs son unique sceptre, car son autorité était âprement combattue. L’entreprise d’unification des forces tient du travail herculéen, et le contraint, lui et Cordier, à une routine harassante, où l’on s’en remet souvent à « l’imprudence et à la chance ». Pour mieux comprendre l’extravagante entreprise que représente l’Armée secrète, il suffit d’évoquer la première conversation entre ces deux hommes. Cela se passe dans un restaurant de Lyon, le 13 juillet 1942. Le chef de « l’armée des ombres » n’en impose pas seulement par l’âge (43 ans ; les légionnaires gaullistes avaient entre 18 et, comme Raymond Aron que Cordier a bien connu à Londres, 35 ans), mais aussi par l’aspect : le regard perçant, les lèvres pleines, le beau visage immortalisé par la fameuse photographie de Marcel Bernard (hiver 1940). Avec cela, des attitudes de félin guettant non sa proie mais ses chasseurs : la séduction masculine incarnée ! Face à lui, notre jeune homme est d’Action française, antisémite, il vitupère la « gueuse », fréquentait naguère les banquets où éructaient Philippe Henriot et Darquier de Pellepoix ! Moulin, toujours à voix basse, lui oppose son enfance républicaine, évoque l’affaire d’un certain capitaine condamné à tort pour haute trahison, sa fierté d’avoir assister à sa réhabilitation. Notre maurrassien écoute, et pense à part lui : « C’est curieux, il n’a pas l’air de savoir que Dreyfus est un traître ! » Peut-on imaginer plus différents que ces deux là, en cet été lyonnais torride, dans une France si occupée ? Quel génie malicieux souffla son inspiration au roi des Ombres ? Après le dîner, avant de disparaître dans la nuit, Jean Moulin, pressé, déclare : « Je vous garde avec moi : vous serez mon secrétaire. Bonsoir. »
L’intérêt du livre ne tient pas seulement au magnétisme de Rex. On y trouvera la chronique minutieuse des heures et des jours de la Résistance, la rude besogne quotidienne ; agir en tout avec une méfiance de chat, espérer, se désoler au gré des informations, des humeurs. De Gaulle pourra-t-il maintenir sa « légitimité républicaine », contre Fresnay et d’Astier-de-la-Vigerie (plein d’une morgue déplaisante) ? Au passage, Caracalla balaye les médisances : Jean Moulin naquit républicain par son père, artiste par sa mère, devint gaulliste par conviction, et demeura hétérosexuel par nature. C’est Henri Fresnay qui fit courir la rumeur de l’homosexualité de Jean Moulin, se fondant sur celle, assumée, de Daniel Cordier. Au reste, homo, nul ne lui en eût tenu rigueur. En revanche, il ne lui sera pas pardonné d’avoir été gaulliste…
Daniel Cordier nous livre le « récit secret » de la puissante séduction qu’exerça sur lui un « homme pour l’éternité », auprès duquel il accepta la modestie du courage dissimulé. Voici ce que fut la guerre souterraine : le sentiment de vivre, la routine du courage simple et organisé, et, au final, la suprême élégance d’un seigneur de la République, trahi, martyrisé, son beau visage abominablement déformé sous les coups, les poumons noyés de sang, puis consentant à une longue agonie mutique. Jusqu’à ce funeste 22 juin 1943, où, par l’un de ses « correspondants », sur le quai de la station de métro Saint-Michel, il apprit que Rex avait été arrêté.
Voilà pourquoi, aujourd’hui encore, lorsqu’il évoque cette tragédie, des larmes viennent brouiller les traits pourtant pacifiés du secrétaire Caracalla.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !