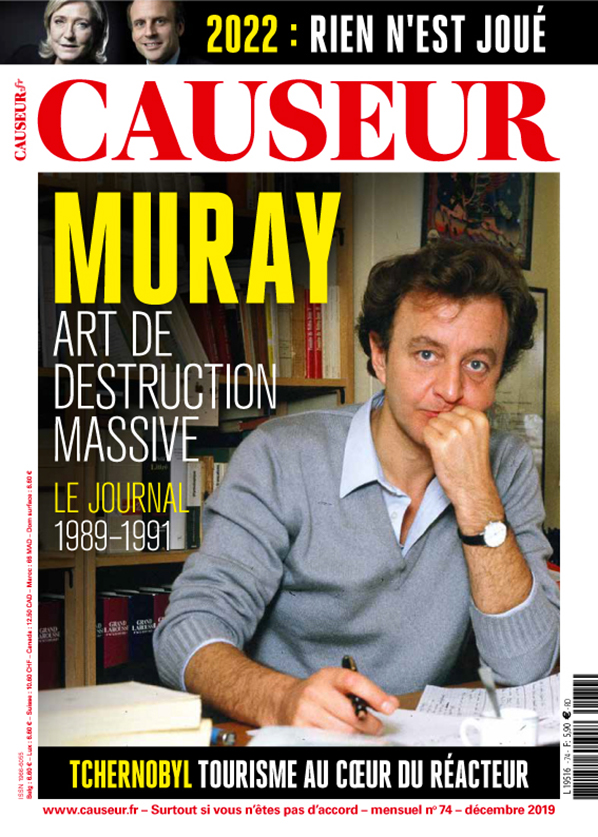Au siècle dernier, tous les grands chefs étaient des hommes tandis que les femmes se cantonnaient à une cuisine de ménagère. Depuis la vague féministe post-Mai 68, la situation s’est inversée : aux femmes les grandes tables, aux hommes les fourneaux familiaux.
L’histoire de la cuisine française concentre d’une façon presque paroxystique les problématiques des relations hommes-femmes auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés. Ainsi, le tableau que les historiens de la cuisine dressent de la France de la Belle Époque, il y a un siècle, nous raconte une autre civilisation, beaucoup plus dure et socialement compartimentée.
La cuisine, d’abord, ne jouissait pas du statut prestigieux qui est le sien aujourd’hui dans notre imaginaire. En 1920, le grand Auguste Escoffier (1846-1935), pape de la cuisine française, soupire en voyant à quel point les grands de ce monde (qui sont pourtant ses clients à l’hôtel Savoy de Londres) ignorent et méprisent l’art qui est le sien : « Que veut dire après tout le mot de “cuisinier” que l’on a l’air de tant dédaigner, quoique l’on soit toujours heureux de pouvoir savourer les mets délicats préparés par lui ? Ce mot désigne l’artisan de l’art d’apprêter les mets servant à la nourriture de l’homme et la cuisine est une science qu’il ne peut posséder qu’après de longues années d’études et un travail constant. Je demande s’il existe au monde un sujet plus important que celui-ci et n’y a-t-il pas à s’étonner que l’homme à qui journellement on s’adresse pour alimenter et restaurer ses forces reste ignoré ou mal connu ? Pour conserver le prestige de notre cuisine française, il est urgent de rompre avec les vieilles légendes, de mieux considérer le cuisinier et se dire que savoir préparer les aliments est une science que chacun ne peut posséder. »
Cuisine d’hier et d’aujourd’hui
Au xixe et au début du xxe siècle, les restaurants tels que nous les connaissons n’étaient pas encore médiatisés, le Guide Michelin n’était pas encore allé les recenser au cœur de nos provinces. Cuisiniers et cuisinières originaires de la campagne ne savaient pour la plupart ni lire ni écrire et apprenaient leur métier sur le tas, sans passer par des écoles d’apprentissage (puisqu’elles n’existaient pas).
Ce que les historiens considèrent comme l’« âge d’or » de la cuisine française était alors incarné par les cuisiniers des maisons bourgeoises où se rendait le « gratin » de la société de l’époque. En 1911, à Paris, on recensait ainsi plus de 4 000 cuisiniers œuvrant pour le compte de grandes maisons : celles du baron