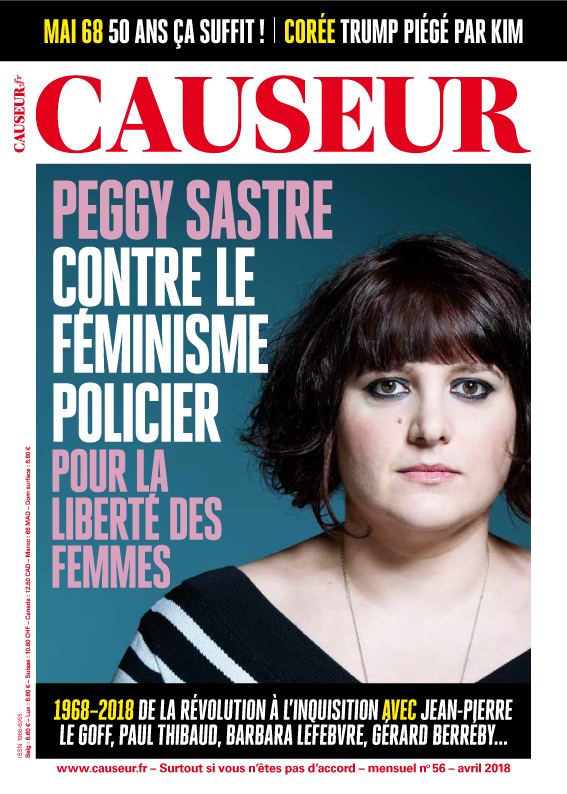Le lieutenant-colonel Thierry Forest, auteur de la Gendarmerie mobile à l’épreuve de mai 68 (SHD, 2017) évoque le face-à-face des barricades. D’un côté, des étudiants insouciants qui n’avaient jamais connu la guerre. De l’autre, des vétérans de 40, de l’Indochine et de l’Algérie qui en avaient vu d’autres.
Causeur. À partir de fin mars 1968, les tensions montent à l’université de Nanterre. Pourtant, les autorités et les forces de l’ordre, préfecture comprise, ont été prises de court par le déclenchement de la révolte à la Sorbonne et au Quartier latin.
Thierry Forest. Exactement. Personne n’avait envisagé que le foyer allumé à Nanterre en mars-avril se propage à la Sorbonne – notamment après la décision de fermer la fac de Nanterre et l’affaire des conseils de discipline. La surprise a donc été donc double : d’abord que les événements se soient déclenchés au cœur de la capitale autour de la Sorbonne, ensuite qu’ils aient pris une telle ampleur.
Ainsi, le 3 mai 1968, quand l’agitation à la Sorbonne débute, le préfet de police de Paris n’a pas grand-chose sous la main pour maintenir l’ordre dans la capitale. Il dispose essentiellement des policiers et de la Garde républicaine, qui, comme aujourd’hui, a la charge des palais nationaux, mais aussi une mission de maintien de l’ordre qu’elle ne remplit plus depuis des décennies. Mises à part quelques unités, les CRS et la gendarmerie mobile se trouvent en province.
Comment les forces de l’ordre ont-elles géré les premiers incidents ?
Dès le début, il y a une grande prudence de la part des autorités, et