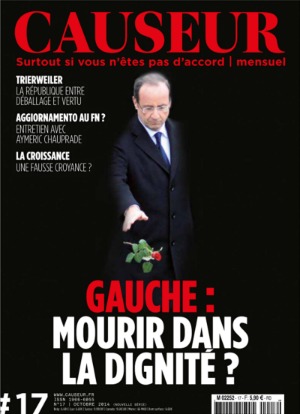« Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste » : si l’auteur de cette formule, l’économiste anglo-américain Kenneth Boulding, a raison, alors, depuis plus de deux siècles, notre planète est un gigantesque asile. Même aujourd’hui, pour la plupart d’entre nous, le débat économique se résume au choix suivant : Valls ou Montebourg, Keynes ou Friedman, modèle allemand ou scandinave ? Autrement dit, à gauche comme à droite, chez les capitalistes comme chez les marxistes, de Mélenchon à Marine Le Pen, l’absence de croissance est communément considérée comme une panne, une « crise », une parenthèse entre deux périodes « normales ». La croissance, c’est la règle, l’environnement naturel de l’homme. Pour les citoyens, un dû de leurs gouvernants, et pour les gouvernants, l’horizon de toute politique.
Cependant, ce paradigme universel ne relève pas tant de la folie que de la croyance. La croissance s’apparente à une religion, ancrée dans la grande promesse des Lumières : le Progrès. Le crédo est simple : le paradis est possible sur terre, grâce à l’accumulation de biens et de services, elle-même rendue possible par des machines et procédés inventés par la science et la technique. Attention, l’objectif est noble : il s’agit d’encourager l’otium du peuple, ce temps libre consacré à l’amélioration de soi, qui est l’opposé du negotium, racine de notre « commerce », qui désigne toutes les activités nécessaires à notre survie matérielle. Dans l’avenir radieux du progrès, les machines remplaceront les domestiques et esclaves de l’Antiquité pour que chacun, et non seulement une infime minorité, puisse accéder à ce luxe.
Dans « Des progrès futurs de l’esprit humain », Condorcet promettait à l’humanité qui s’engageait dans la voie de la science et de la technique une expansion des richesses dont l’unique limite serait la capacité d’innover : en un mot, la croissance perpétuelle. Condorcet était-il fou ?[access capability= »lire_inedits »]
Il est vrai que, dans sa première acception, la croissance n’était pas un choix, mais une nécessité : il fallait produire plus pour nourrir plus d’humains. Irréfutable. Si nous sommes de plus en plus nombreux, il faut de plus en plus pour que chacun ait autant. Seulement, la machine s’est emballée, et la croissance est devenue la loi du « toujours plus » pour tout le monde : plus pour chacun tout au long de sa vie, plus pour les enfants que pour les parents. On en a presque oublié qu’il n’y aurait pas plus d’air, d’eau, de pétrole, bref, que la planète, elle, était limitée. Le bonheur a été définitivement associé au confort et à la possession. D’une croissance simple qui court après la démographie, on est ainsi passé à une croissance exponentielle qui court après les résultats trimestriels des entreprises.
Or pour les enfants de l’après-guerre, le fantasme d’une croissance illimitée s’est réalisé. « Illimitée », c’est un bien grand mot pour trente malheureuses années – 1945-1974. Mais en à peine une génération nous avons pris des habitudes. Jean Fourastié, l’auteur des Trente Glorieuses, un livre qui a donné son nom à l’époque, n’y voyait pas autre chose qu’une transition entre deux phases de très faible croissance : la première, allant de 1800 à 1945, est celle de la double révolution – agricole d’abord et industrielle ensuite ; la seconde, la nôtre, qui a commencé dans les années 1970, annonçant l’âge postindustriel dans lequel l’essentiel de la force de travail et de la consommation serait concentré dans le secteur tertiaire.
Cependant, ces dernières décennies ont mis à mal la vision idyllique d’un avenir toujours plus abondant. Pour la majorité des Occidentaux, principaux bénéficiaires du progrès et de la croissance d’après-guerre, le premier des trouble-fête a été l’écologie : on s’est inquiété de la dégradation de l’environnement – pollution des mers, des rivières et de l’atmosphère –, qui menaçait la santé et la qualité de la vie, avant de découvrir avec un effroi pénitentiel les risques autrement plus graves que l’homme faisait courir à l’homme – réchauffement climatique, disparition accélérée des espèces, catastrophes nucléaires. Sont ensuite venues les critiques du tourbillon de la consommation, d’autant plus bruyantes que les gagnants étaient moins nombreux. Technologie, décoration, vêtements, voitures, alimentation, voyages : la classe moyenne occidentale, à la suite de son homologue américaine, a adopté un mode de vie dont on perçoit instinctivement qu’il n’est pas « universalisable sans contradictions », selon la formule de Michéa, qui démontre l’impossibilité d’un monde dans lequel il y aurait la même proportion de piscines privées qu’aux États-Unis. Mais après tout, selon certaines prévisions de la fin du xixe siècle, le problème majeur du xxe devait être les gigantesques quantités de crottes de cheval qu’allait produire le transport urbain en plein boom…
Les prophètes occidentaux de la fin de la croissance sont-ils affligés d’un pessimisme culturel qui leur fait redouter à tort le déclin économique de leur civilisation et la montée en puissance des nouveaux acteurs asiatiques et africains ? Sont-ils des Malthus du xxie siècle, constatant, à partir d’une extrapolation du passé, l’impossibilité de « continuer comme ça » ou des esprits lucides qui tentent de nous ramener à la raison ? Et, finalement, le pasteur britannique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe a-t-il eu tort ou raison trop tôt ?
Pour essayer d’apporter des éléments de réponse à des questions qui dessinent notre futur, j’ai rencontré trois penseurs qui conjuguent enseignement, réflexion économique et participation active au débat public, et dont les positions sur le sujet permettent de faire une sorte de tour d’horizon. Jean-Hervé Lorenzi, professeur émérite en économie à Dauphine, se situe plutôt dans le camp de Condorcet : il pense qu’une « croissance durable » est non seulement possible, mais aussi souhaitable. Pour Aurélien Bernier, intellectuel et militant appartenant à la gauche radicale, non seulement la croissance n’est plus possible, mais elle n’est pas souhaitable. Enfin, l’économiste et mathématicien Gaël Giraud estime qu’il faut carrément abandonner ce critère et cesser de penser en termes de PIB.
Lorenzi, qui est également président du Cercle des économistes (qualifiés d’officiels par les courants critiques), est convaincu que le système a les moyens de sortir du marasme actuel : « La situation est grave, dit-il, mais le monde ne va pas s’effondrer. » Le titre de son dernier ouvrage (écrit avec Mickaël Berrebi), Un monde de violences, 2015-2030, n’est pourtant pas d’une folle gaieté. Il se dit convaincu qu’on trouvera de nouveaux moteurs de croissance durable, en même temps que le moyen d’atténuer les tensions qui caractérisent la période actuelle – comme le chômage ou la rareté de certaines ressources. « De plus, rappelle-t-il, nous vivons une nouvelle révolution démographique : en 1980, les démographes prédisaient que la Terre compterait 30 milliards d’humains en 2050 tandis que, selon les prévisions les plus récentes, nous ne serons que 9.5 milliards. » Même pas 10 milliards…Excellente nouvelle certes, bien qu’on ne sache pas comment on nourrira toutes ces bouches.
Jean-Hervé Lorenzi invite par ailleurs ses collègues à faire preuve de prudence dans leurs prédictions, car « les économistes n’ont jamais été confrontés à des incertitudes aussi lourdes ». Auteur de Comment la mondialisation a tué l’écologie (2012), Aurélien Bernier ne le contredira pas sur ce point.
Sans surprise, cet ancien militant d’Attac ne croit pas que le capitalisme soit le seul et inéluctable horizon de l’humanité. Avec un peu de retard sur les prévisions de Marx et de ses multiples disciples, il pense que les contradictions inhérentes au capitalisme sont en train de l’achever. D’après ce décroissant marxien, ce qui change radicalement la donne, c’est la double question de la dépendance à l’énergie fossile et de l’environnement. Il observe qu’il y a de plus en plus de pauvres, qui ne cessent de s’appauvrir, et de moins en moins de riches, qui ne cessent de s’enrichir. En supposant que cette concentration de la richesse soit une réalité (le débat sur le livre de Thomas Piketty montre que ce diagnostic n’est pas unanimement partagé), Bernier reconnaît que, contrairement aux prédictions de Marx, elle n’est pas – encore ? – venue à bout du capitalisme. En revanche, toujours selon Bernier, celui-ci n’a aucune chance d’échapper au péril mortel de la dégradation de l’environnement. Sa logique profonde, dans laquelle les intérêts privés – les « eaux boueuses du calcul égoïste »… – l’emportent sur l’intérêt général, le mène à sa perte. Dans les années 1920, les principaux fabricants d’ampoules s’étaient mis d’accord pour réduire la durée de vie de leurs produits de façon à pouvoir en vendre plus : ils ont inventé l’obsolescence programmée ! Presque un siècle plus tard, 60 % des marchandises consommées aux États-Unis sont produites en Chine par des multinationales américaines délocalisées. On ralentit la pollution en Occident, mais à l’échelle de la planète son augmentation est dramatique ! En somme, on a déplacé le problème. Or il arrivera un moment où on ne pourra plus le déplacer, car la planète entière aura été arraisonnée par l’industrie.
Plus radical encore d’une certaine façon, Gaël Giraud, mathématicien, économiste et membre de la Compagnie de Jésus, conteste la base matérialiste de ces analyses avec une question aussi faussement simple que celle posée jadis par l’abbé Sieyès : Qu’est-ce que la croissance ? Pour lui, le PIB (produit intérieur brut), qui permet de la mesurer, est un très mauvais indice. Développé dans les années 1930 – grâce notamment à une importante contribution française – cet indicateur visait alors à mesurer l’aptitude des nations – surtout l’Allemagne – à faire la guerre. C’est pour cette raison qu’il n’inclut pas le travail domestique des femmes : il ne permet pas de faire la guerre (encore qu’on pourrait le discuter !). De plus, le PIB ignore les nuisances et les dégâts écologiques. Si vous polluez une rivière, vous accroissez deux fois le PIB : la première en rendant les riverains malades, ce qui augmente l’activité du secteur de la santé, la deuxième en finançant la dépollution. À la place de cet outil dépassé, Giraud propose de mesurer la qualité du lien social, qui est, selon lui, un bien meilleur indicateur du développement et de la prospérité. Comme le dit l’adage populaire, « l’argent ne fait pas le bonheur ». Sans doute, mais cela n’empêche pas la plupart des humains d’en vouloir toujours plus. Le travail de Giraud n’est malheureusement pas d’un très grand secours pour comprendre et peut-être combattre cet universel anthropologique.
En attendant, si nos villes n’ont pas été envahies par le crottin au début du xxe siècle, qui nous dit que nous n’aurons pas tous des piscines à la fin du xxie ? Sans dénier aux travaux de ces estimables chercheurs leurs qualités scientifiques, la réponse à cette question repose in fine sur un noyau dur indécidable – donc sur un acte de foi. Il y a en effet une inconnue qui, jusque-là, a toujours donné tort à Malthus. Pour sortir d’une situation inextricable, le théâtre italien de la Renaissance a inventé le deus ex machina. Depuis trois siècles, en Occident, le rôle du deus ex machina est assigné à l’innovation technologique. De la machine à vapeur au téléphone intelligent (plus que nous ?), en passant par le moteur à essence, l’informatique et le nucléaire, de multiples inventions ont permis à l’homme de sortir des pétrins où il s’était fourré.
Étant admis que c’est l’innovation qui rend la croissance possible, reste une question de taille qui divise les chercheurs : relève-t-elle, cette innovation, du hasard ou de la nécessité ? Peut-on la provoquer ou faut-il se contenter de l’invoquer ? Pour Jean-Hervé Lorenzi, il n’y a pas de mystère : l’innovation est une question d’argent. On investit, on gagne. Si, aujourd’hui, « malgré les apparences, l’innovation est en baisse », c’est à cause du manque de financement, lui-même imputable au vieillissement de nos sociétés. « Nous avons de plus en plus de rentiers et de moins en moins d’investisseurs, poursuit-il. Or, le progrès technique dépend de l’investissement, c’est-à-dire de la possibilité de prendre des risques. À 50 ou à 60 ans, un individu cherche à sécuriser l’épargne pour s’assurer sa retraite et préfère des placements peu risqués. » Pour résoudre ce problème, il faut trouver des formes innovantes de financement qui garantissent le niveau de vie des retraités tout en drainant leur épargne vers les investissements à haut risque aptes à encourager les ruptures technologiques porteuses de croissance. Facile, dirait-on. Sauf que, jusqu’à présent, nul n’a trouvé le moyen de miser l’épargne d’honnêtes retraités à la roulette du progrès sans risquer de la voir disparaître en fumée – ou plutôt en vapeur dans l’explosion de mémorables « bulles ».
Gaël Giraud est plus sceptique : pour notre Jésuite, l’innovation relève du miracle. On ne sait pas d’où ça vient. Ce sont les banquiers qui veulent nous endormir en nous racontant qu’il suffit d’injecter de l’argent dans la machine pour fabriquer du progrès. Et puis, si on vide les océans de leurs poissons, si les abeilles disparaissent, le fait de pouvoir rouler mille kilomètres en consommant un verre d’eau sera une faible consolation. L’image est un peu facile. De toute façon, Giraud pense que le poids de l’innovation dans la croissance est largement surestimé. Il faut, selon lui, inverser les proportions : deux tiers de la croissance dépendent de l’énergie, et un tiers seulement dépend des innovations. Depuis le xviiie siècle, l’expansion économique repose sur l’exploitation croissante des énergies fossiles. Or, s’agissant du pétrole, avant même l’épuisement des réserves, la consommation mondiale approche la capacité maximale d’extraction : 90 millions de barils par jour. Le pétrole et le gaz de schiste constituent-ils le miracle énergétique qui permettrait d’échapper à cette équation implacable ? Aujourd’hui, on ne conseillera à personne de miser sa retraite sur ce tapis.
En réalité, nous n’avons pas le choix : il nous faut apprendre à vivre dans un monde aux ressources limitées. Que ce diagnostic fasse consensus au-delà des profondes divergences d’analyse montre bien que nous entrons, au minimum, dans un nouvel âge de la croissance.
Dans cet environnement proche de la rupture, l’allocation des ressources rares sera nécessairement plus autoritaire, c’est pourquoi elle devra être confiée exclusivement aux acteurs publics. Aussi observe-t-on une convergence politique assez surprenante de nos trois penseurs : nos institutions ne sont pas à la hauteur des choix auxquels nous sommes confrontés. Comment la démocratie libérale tiendra-t-elle le choc si la panne de la croissance se poursuit indéfiniment ou, pire encore, si nous devons entrer dans une période de décroissance qui, en plus de multiples difficultés, exigera une révision radicale de nos cadres de pensée ? Rassurons-nous : aucun de nos interlocuteurs ne propose de renoncer au suffrage universel et à nos libertés. Reste que nous devrons peut-être réinventer – et accepter – des pouvoirs forts.
Aurélien Bernier est – sans surprise – le plus radical. Pour lui, le système actuel tourne en rond, car l’impératif de rentabilité interdit la mise en œuvre de toute solution – technologique ou politique. Le coupable, c’est le libre-échange, qui met en concurrence toutes les économies de la planète et crée les conditions d’un chantage permanent à la délocalisation. Chaque fois qu’un gouvernement essaie d’imposer des contraintes sociales et environnementales, les entreprises américaines et européennes menacent d’aller produire – et embaucher – ailleurs. La seule solution est donc de nationaliser les entreprises et les banques. Quand on lui objecte que qui dit « nationalisation » dit « nation », il convient que la gauche paie au prix fort son erreur d’analyse sur l’État-nation : on ne peut lutter contre le système actuel qu’au niveau planétaire, ce qui est aujourd’hui un pur fantasme, ou à celui de nos chers et vieux pays. Si nous voulons reprendre les commandes politiques aux forces économiques, il faut sortir de l’Union européenne et imposer une politique protectionniste dans des frontières clairement définies et reconnues – bref, agir à l’échelle de la France.
À l’écouter, on se demande ce qu’il restera de nos libertés individuelles de peuples riches. Aurions-nous le choix entre Soleil vert et 1984 ? Bernier se récrie : pour peu que l’on admette que la possession d’une grosse cylindrée ou d’un sac Louis Vuitton ne fait pas partie des droits de l’homme inaliénables, la politique qu’il appelle de ses vœux est, assure-t-il, parfaitement démocratique. Il est légitime d’obliger l’industrie automobile à se réorienter vers le transport public, ou d’exploiter le savoir-faire exceptionnel de l’industrie du luxe pour produire des biens utiles et durables destinés à tous et pas seulement aux plus riches. Ainsi pourra-t-on faire la révolution écologique et sociale dans un seul pays – avant de l’étendre à l’humanité tout entière.
Pour Gaël Giraud, le nécessaire changement de donne politique passe en premier lieu par une conversion collective à l’« économie de circularité », qui repose sur la réutilisation de l’énergie perdue dans le processus de production. Les gros producteurs de gaz à effet de serre, les transporteurs aériens, mais aussi les gigantesques data centers informatiques sont à l’origine d’énormes déperditions de chaleur. Tôt ou tard, il faudra obliger Air France, Google, Facebook et les autres à recycler cette chaleur, et ce n’est pas le marché qui le fera !
Giraud va plus loin et prône une rupture presque anthropologique qui permette de repenser la propriété en dehors du couple binaire « public-privé », par exemple en développant les biens communs pour lesquels ce n’est pas la propriété qui importe mais le droit d’usage – c’est le modèle Vélib. À en croire Giraud, le succès d’entreprises comme BlaBlaCar montre que beaucoup de jeunes sont prêts pour cette révolution. Il faut alors espérer qu’elle saura acclimater la démocratie libérale. Gaël Giraud veut le croire.
Jean-Hervé Lorenzi ne croit pas, pour sa part, que le salut viendra de la nationalisation. Le rôle de l’État, rappelle-t-il, est de créer les conditions de l’innovation en prenant une partie du risque. À cette fin, il faut penser et imposer un mode de régulation qui (re)connecte le secteur financier à l’économie réelle.
Cette rapide incursion dans la fabrique des idées contemporaines montre que, pendant que nos gouvernants continuent de psalmodier le mantra de la croissance, les intellectuels prennent la mesure du changement en cours, à défaut de pouvoir rendre lisible le monde qui vient. Il ne suffit pas de briser les idoles d’hier pour faire advenir de nouveaux dieux.
À l’issue de ces trois passionnantes conversations, la conclusion qui s’impose est que nous ne savons rien, en tout cas pas grand-chose, de ce qui nous arrive. Les vieilles cartes correspondent de moins en moins aux territoires qui se déploient sous nos yeux, les commandes ne répondent plus. Que faire ? Se fier à la voix rassurante du pilote ? Exiger un changement de cap ? Saisir un parachute et courir vers l’issue de secours – mais où se trouve-t-elle ? Plutôt que d’avoir à répondre à ces questions vertigineuses, on aimerait continuer à regarder le film en attendant l’atterrissage.
Pour conclure cette réflexion sur le présent, il faut revenir au moment où nous avons mis le doigt dans cet engrenage de la croissance. Notre espèce a-t-elle franchi ce cap décisif il y a dix ou quinze milliers d’années, quand nos ancêtres chasseurs et cueilleurs sont devenus agriculteurs ?
Le premier chapitre de la Genèse conserve peut-être un écho lointain de ce passé dans lequel des hommes habitués à cueillir des fruits cultivés par Dieu durent s’adapter à la pénible existence de laboureurs et pasteurs, marquée par la jalousie et la violence meurtrière. D’après les archéologues, nos premiers ancêtres sédentaires travaillaient plus, souffraient de plus nombreuses pathologies et jouissaient d’un régime alimentaire moins varié que les derniers chasseurs-cueilleurs, sans pour autant bénéficier de plus de sécurité face à la violence et à la famine. La raison en est simple : l’humanité était tombée dans le piège démographique. L’enchaînement est connu : le rendement de l’agriculture s’améliore ; très vite, une petite vallée capable de soutenir quelques dizaines de chasseurs-cueilleurs voit sa population augmenter, les nouvelles bouches à nourrir absorbant le surplus initialement créé, ce qui impose une nouvelle augmentation de la production. C’est ainsi que, dans cette course sans fin entre la population et les ressources, l’homme est devenu esclave des techniques qui étaient supposées le libérer, sans avoir jamais la possibilité d’un retour en arrière – pour retrouver l’équilibre perdu des chasseurs-cueilleurs, il aurait fallu tuer neuf personnes sur dix…
C’est ce passage à une économie de surplus (donc au principe même de la croissance) qui a donné naissance à la politique, c’est-à-dire à l’ensemble de principes, de règles et d’usages qui permettent de gérer des communautés humaines sédentaires de plus en plus complexes. Cela signifie que, loin d’être une donnée technique, le paradigme de la croissance imprègne nos représentations et nos modes de vie. On a longtemps pu croire, en tout cas en Occident, que l’abondance de ressources avait libéré l’humanité du spectre de la pénurie et de l’impératif du partage. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons plus éluder les choix fondamentaux. Malgré nos impressionnantes capacités, pour la première fois de l’histoire, nous sommes obligés de répondre à la question : « Où voulons-nous aller ? ».[/access]
*Photo: Flickr/Colectivo Desazkundea
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !