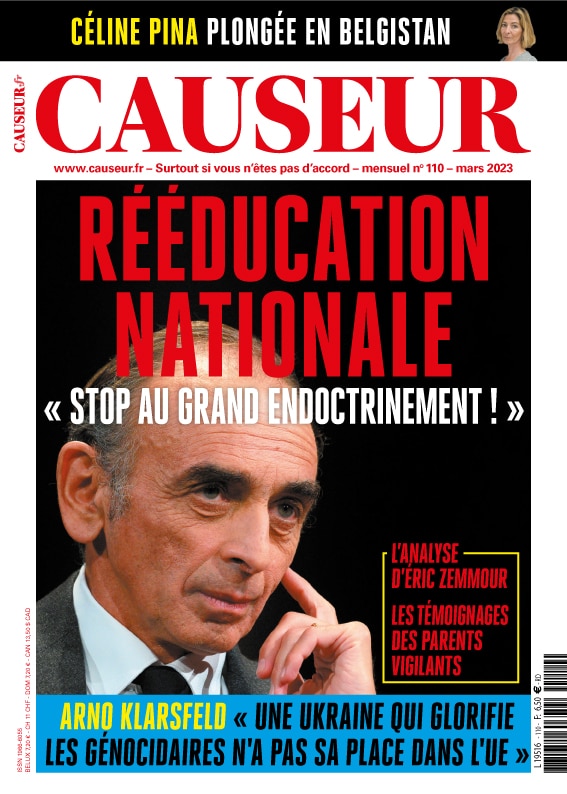Au lieu d’encourager nos enfants à acquérir les connaissances qui leur permettront de comprendre le monde, les programmes scolaires les invitent à le « questionner ». Les adultes de demain sont confortés dans leur ignorance et incités à entretenir leur nombrilisme.
« La compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres, mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. Vis-à-vis de l’enfant, c’est un peu comme s’il était un représentant de tous les adultes qui lui signaleraient les choses en lui disant : “Voici notre monde”. » C’est en ces termes simples, clairs et incisifs, que la philosophe Hannah Arendt (1906-1975) résume, dans La Crise de l’éducation (1958), la grandeur de l’école et le rôle du professeur. Pour Hannah Arendt, l’école est un lieu à part, qui s’intercale entre le foyer familial et le monde, permettant à l’enfant de devenir cet être humain « qui n’a jamais existé auparavant », un être unique capable d’entreprendre quelque chose de neuf dans un monde plus vieux que lui, qu’il doit connaître, aimer, et dont il devra à son tour assumer la responsabilité.
À lire aussi : Élisabeth Lévy: “L’Éducation nationale est un désastre”
Aujourd’hui, l’école n’est plus un lieu à part. C’est un lieu comme les autres, perméable à la sphère familiale et à la sphère publique, dont il est le double