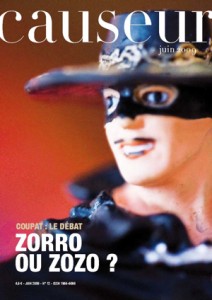Pour comprendre les ravages du virage financier pris par l’économie mondiale, Continental est un cas d’école. Cet acteur majeur de l’industrie de pneus – le quatrième fabricant mondial – souffre bien entendu de la chute brutale de ventes de voitures mais, à elle seule, celle-ci n’explique ni l’ampleur de la crise que traverse Continental ni la violence de la réaction des ses employés français face à une probable fermeture des sites. Ce que les « Contis » ont vécu depuis deux ans, la façon dont ils se sont faits trimballer pour dire les choses clairement, explique aussi leur relatif scepticisme face à la perspective d’un rachat par l’équipementier MAG d’Abu-Dhabi – ces histoires de fusions, acquisitions et consolidations, ils les connaissent par cœur.
La tendance générale dans l’automobile est à la concentration – nombre décroissant d’acteurs de taille croissante. Continental a essayé de jouer le jeu et a déboursé en 2007 11,4 milliards d’euros pour acheter une division de Siemens VDO spécialisée dans l’électronique pour l’automobile. Parallèlement, Continental a proposé à ses employés français de passer de 35 à 40 heures par semaines par diminuer le coût de travail de ce site, le plus élevé dans le groupe, histoire d’éviter la délocalisation de cette activité. Une offre qu’on ne peut pas refuser, en tout cas par gros temps. Les salariés ont dit oui. On comprend qu’ils aient aujourd’hui le sentiment de s’être fait avoir.
Le problème, c’est que pour financer l’achat de VDO, une entreprise qui avait à peu près la même taille qu’elle, Continental s’est lourdement endetté, ce qui a pesé sur le cours de son action, rendant l’entreprise vulnérable à une tentative de prise de contrôle hostile. Continental est devenue une proie.
À première vue, le coup de Madame Schaeffler force l’admiration. La discrète milliardaire allemande, redoutable femme d’affaires qui dirige le groupe familial fondé par feu son mari en 1946, a mené un raid financier pour prendre le contrôle de l’équipementier automobile allemand Continental, une société trois fois plus importante que son groupe en termes de chiffre d’affaires. Il y a à peine un an, quand le prix du baril s’acheminait doucement vers le sommet historique des 150 dollars, l’équipe de Schaeffler, poussée et inspirée par la veuve ambitieuse et astucieuse, a réalisé un exploit que seul le dessin de Saint-Exupéry peut illustrer : un boa avalant un éléphant.
Chez Continental, on a dû être aussi surpris que le pauvre éléphant de Saint-Ex, car Maria Elisabeth Schaeffler et son équipe ont agi discrètement et patiemment, profitant de la faiblesse de la valeur boursière. Quand les dirigeants de Continental ont compris qu’ils étaient tombés dans une embuscade financière, ils n’ont pas caché leur colère. Manfred Wennemer, P-DG de Continental à l’époque, a qualifié Schaeffler « d’opportuniste, égoïste et irresponsable », amabilités qui devaient lui coûter son job quelques semaines plus tard, lorsque l’équipementier finit par accepter une offre améliorée. Fin août 2008, le communiqué annonçant à la fois l’acquisition par Schaeffler et la « démission » de Wennemer. « Continental ouvre un nouveau chapitre de son histoire », peut-on y lire. On ne saurait mieux dire.
Schaeffler et son équipe auront peu de temps pour savourer leur triomphe. Trois semaines plus tard, l’administration Bush laisse tomber la banque Lehman Brothers et la veuve Schaeffler découvre que le jeu dans lequel elle excellait est terminé, ou, en tout cas, suspendu pour une période non déterminée.
Ce qui est fâcheux, c’est que plusieurs milliers de ses salariés l’ont découvert en même temps qu’elle et que pour eux, les conséquences sont infiniment plus douloureuses. L’OPA lancée par Schaeffler sur une proie bien plus grosse qu’elle illustre à la perfection les défaillances d’un système de plus en plus détaché des réalités économiques.
Certes, l’opération avait le mérite de la cohérence. Fabricant de roulements mécaniques, le groupe Schaeffler avait élargi ses activités jusqu’à devenir un équipementier automobile et aéronautique. Même si la phase d’expansion avait commencé à la fin des années 1990, après la mort du fondateur Georg Schaeffler, véritable chevalier d’industrie, la logique qui a guidé le groupe n’a pas été financière mais industrielle. Il s’agissait de s’adapter au processus de consolidation du secteur de l’automobile.
Le problème, c’est que cette stratégie industrielle a été mise en œuvre grâce à une tactique largement financière puisque la croissance devait venir de l’achat de sociétés concurrentes et/ou complémentaires. Pendant une bonne dizaine d’années, Madame Schaeffler y est allée hardiment. Il est vrai qu’elle n’a pas été la seule, car ce fut la décennie des fusions acquisitions – et, accessoirement, le triomphe des banques d’affaires chargées de les mener à bien. Mais si la première grande opération de Schaeffler, en 2001, concernait une société de 730 millions d’euros, sept ans plus tard, le projet était de débourser 12 milliards d’euros pour prendre le contrôle de Continental – à ce niveau là de LBO (acquisition à effet de levier, ou un petit qui achète un gros avec beaucoup de crédit) cela ressemble surtout à la grenouille et au bœuf.
Pour trouver un financement, Schaefller a monté ce qu’en termes financiers on qualifierait de « montage compliqué et audacieux » et en simple français un pari fou. L’idée était d’acheter 49,9 % des actions Continental avec une offre savamment calculée pour ne pas attirer trop de monde. Sauf qu’entretemps la crise boursière avait commencé. Résultat, beaucoup de porteurs ont été trop contents de se débarrasser de leurs actions. À avoir voulu la jouer trop fine, le groupe Schaeffler se retrouve maintenant endetté jusqu’au cou alors que son secteur d’activité est en pleine crise. Autrement dit, il doit rembourser beaucoup plus avec beaucoup moins de recettes.
Ceux qui paient les pots cassés de ce pari que The Economist a qualifié de « dément » sont les employés de sites « restructurés ». Il est vrai que la crise aurait heurté de plein fouet le secteur de l’automobile même si Madame Schaeffler avait décidé de se consacrer à la charité publique ou à l’art premier. En tout état de cause, Continental serait très probablement dans une situation difficile. Reste que la gravité de la situation de l’entreprise ne s’explique ni par la dette de Continental (préalable à l’OPA), ni par la chute des ventes de voitures, mais par la situation très grave des finances de Schaeffler, elle-même due à une grosse erreur de ses dirigeants. La rage et le désespoir des « Conti » de Clairoix, invités à payer les pots cassés, sont donc plus que compréhensibles.
Le comportement du gouvernement allemand est plus mystérieux. Angela Merkel se targue d’avoir été le premier chef d’Etat à comprendre la gravité de la situation du système financier mondial : comment se fait-il donc qu’une telle opération financière ait pu être lancée et aboutir quand les clignotants étaient tous au rouge et qu’elle avait été qualifiée d’égoïste et d’irresponsable par le P-DG de la société achetée ?
Schaeffler n’a pas été seule à analyser l’opération, son prix et ses risques. Des cabinets d’audit et de comptabilité l’ont jugée raisonnable et des banques l’ont financé – bref, tout un système avait permis à l’ambitieuse Madame Schaeffler, de réaliser son exploit. Et le plus triste est qu’on n’y peut pas grand-chose. En l’absence d’alternative raisonnable à la loi du marché, il faut peut-être parfois se résigner à ce que le marché fasse la loi.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !